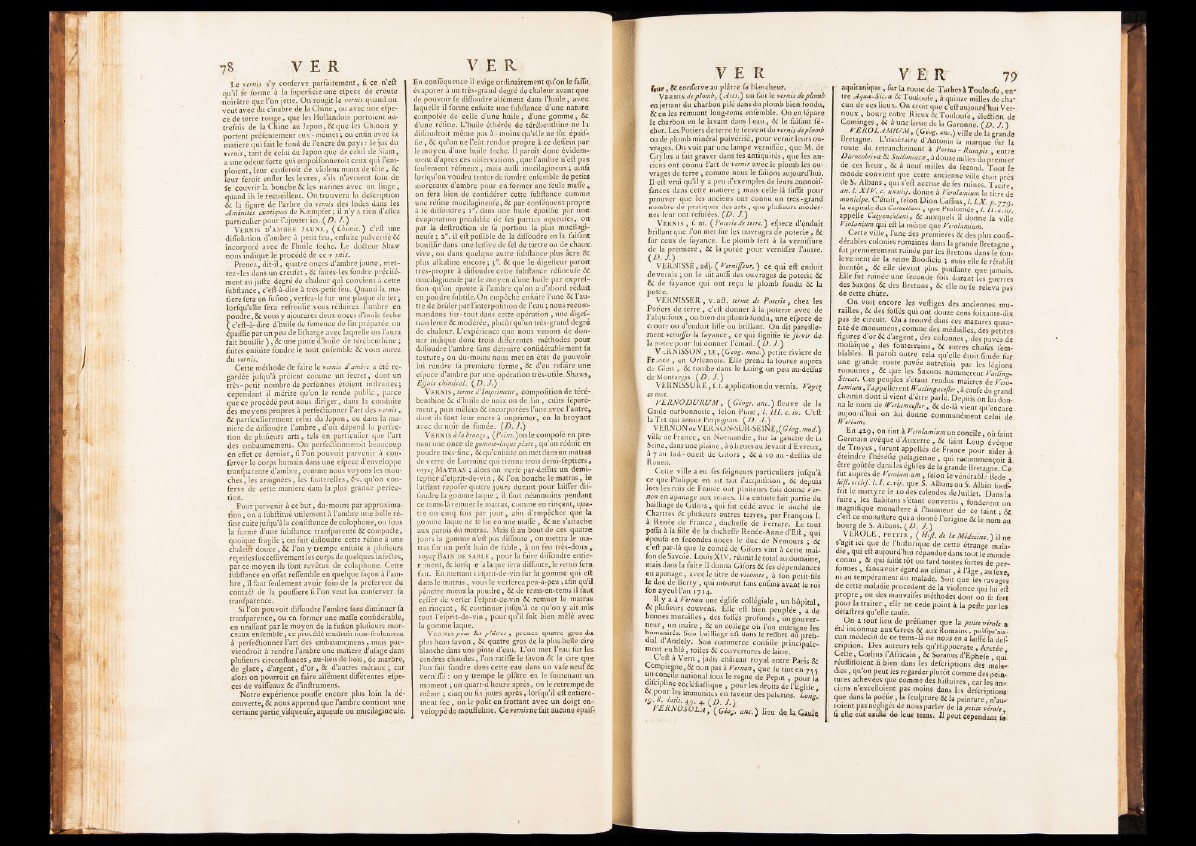
Le vernis s’y conferve parfaitement, fi ce n'eft
qu’il fe forme à la fuperficie une efpece de croûte
•noirâtre que l’on jette. On rougit le vernis quand .on
veut avec du cinabre de la Chine, ou avec une efpece
de terre rouge , que les Hollandois portoient autrefois
de la Chine au Japon, 6c que les Chinois y
portent préfentement eux-mêmes; ou enfin avec la
matière qui fait le fond de l’encre du pays : le jus du
vernis, tant de celui du Japon que de celui de Siam,
a une odeur forte qui empoifonneroit ceux qui l’emploient
, leur cauferoit de violens maux de tête, 6c
leur feroit enfler les levres, s’ils n’avoient foin de
fe couvrir la bouche & les narines avec un linge,
quand ils le recueillent. On trouvera la defcription
& la figure de l’arbre du vernis des Indes dans les
Aménités exotiques de Kæmpfer ; il n’y a rien d’affez
particulier pour l’ajouter ici. (D . J . )
V e r n i s d ’ a m b r e j a u n e , ( Chimie. ) c’eft une
diffolution d’ambre à petit feu, enfuite pulvérifé&
incorporé avec de l’huile feche. Le doêteur Shaw
nous indique le procédé de ce v rnis.
Prenez, dit-il, quatre onces d'ambre jaune, met-
tez-les dans un creufet, 6c faites-les fondre précifé-
ment au jufte degré de chaleur qui convient à cette
fubftance, c’eft-à-dire à très-petit feu. Quand la matière
fera en fufion, verfez-la fur une plaque de fer ;
lorfqu’élle fera refroidie vous réduirez l’ambre en
poudre, & vous y ajouterez deux onces d’huile ieche
f c’eft-à-dire d’huile de femence de lin préparée ou
epaiflie par un peu de litharge avec laquelle on l’aura
fait bouillir ) , 6c une pinte d’huile de térébenthine ;
faites enfuite fondre le tout enfemble 6c vous aurez
du vernis.
Cette méthode de faire le vernis d'ambre a été regardée
jufqu’à préfent comme un fecret, dont un
très-petit nombre de perfonnes étoient inftruites;
cependant il mérite qu’on le rende public, parce
que ce procédé peut nous diriger, dans la conduite
des moyens propres à perfectionner l’art des vernis,
& particulièrement celui du Japon, ou dans la maniéré
de difloudre l’ambre , d’où dépend la perfection
de plufieurs arts, tels en particulier que l’art
des embaumemens. On perfe&ionneroit beaucoup
en effet ce dernier, fi l’on pouvoit parvenir à con-
ferver le corps humain dans une efpece d’enveloppe
franfparente d’ambre, comme nous voyons les mouches
, les araignées, les fauterelles, &c. qu’on conferve
de cette maniéré dans la plus grande perfection.
Pour parvenir à ce but, du-moins par approximation
, on a fubftitué utilement à l’ambre une belle réfine
cuite jufqu’à la confiftence de colophone, ou fous
la forme d’une fubftance tranfparente 6c compare,
quoique fragile ; on fait difloudre cette réfine à une
chaledt douce, 6c l’on y trempe enfuite à plufieurs
reprifesfucceflivementles corps de quelques infeûes,
par ce moyen ils font revêtus de colophone. Cette
fubftance en effet reffemble en quelque façon à l’ambre
, il faut feulement avoir foin de la préferver du
contaft de la poufliere fi l’on veut lui conferver fa
tranfparence.
Si l’on pouvoit difloudre l’ambre fans diminuer fa
tranfparence, ou en former une maffe confidérable,
en unifiant par le moyen de la fufion plufieurs morceaux
enfemble, ce procédé tendroit non-feulement
à perfectionner l’art des embaumemens, mais par-
viendroit à rendre l’ambre une matière d’ulage dans
plufieurs circonftances , au-lieu de bois, de marbre,
de glace, d’argent, d’or, & d’autres métaux ; car
alors on pourroit en faire aifément différentes efpe-
ces de vaiffeaux 6c d’inftrumens.
Notre expérience pouffe encore plus loin la découverte,
6c nous apprend que l’ambre contient une
certaine partievifqueufe, aqueufe pu mucilagineufe.
En conféquence il exige ordinairement qu’on lefaffè.
évaporer à un très-grand degré de chaleur avant que
de pouvoir fe difloudre aifément dans l’huile, avec
laquelle il forme enfuite une fubftance d’une nature,
compolée de celle d’une huile, d’une gomme, 6c
d’une réfine. L’huile éthérée de térébenthine ne l.i
difloudroit même pas à - moins qu’elle ne fut épaif-
iie , 6c qu’on ne l’eût rendue propre à ce deffein par
le moyen d’une huile feche. Il paroît donc évidemment
d’après ces obfervations, que l’ambre n’eft pas
feulement réfineux, mais aufli mucilagineux ; ainfî
lorfqu’on voudra tenter de fondre enfemble de petits
morceaux d’ambre pour en former une feule maffe,
on fera bien de confidérer cette fubftance comme
une réfine mucilagineufe, & par conféquent propre
à fe difloudre; i ° . dans une huile épaiflie par une
évaporation préalable de fes parties aqueufes, ou
par la deftruftion de fa portion la plus mucilagineufe
; z°. il eft poflible de la difloudre en la faifant
bouillir dans une leflîve de fel de tartre ou de chaux,
v iv e , ou dans quelque autre fubftance plus âcre 6c
plus alkaline encore ; 30. & que le digefteur paroit
très-propre à difloudre cette fubftance réfineufe 6c
mucilagineufe par le moyen d’une huile par expref-
fion qu’on ajoute à l’ambre qu’on a d’abord réduit
en poudre fubtile. On empêche enfuite l’une & l’autre
de brûler par l’inrerpofition de l’eau ; nous recommandons
fur-tout dans cette opération , une digefl-
tion lente 6c modérée, plutôt qu’un très-grand degré
de chaleur. L ’expérience que nous venons de donner
indique donc trois différentes méthodes pour
difloudre l’ambre fans détruire confidérablement fa
texture, ou du-moins nous met en état de pouvoir
lui rendre fa première forme, 6c d’en refaire une
efpece d’ambre par une opération très-utile. Shaws,
E J/dis chimical. (Z ) ./.)
V e r n i s , terme d'imprimeur, compofition de térébenthine
6c d’huile de noix ou de lin , cuits féparé-
ment, puis mêlées 6c incorporées l’une avec l’autre,
dont ils font leur encre à imprimer, en la broyant
avec du noir de fumée. (D . J . }
V e r n i s à la bronze, ( Peint.)on le compofe en prenant
une once de gomme-laque plate, qu’on réduit en
poudre très-fine, & q u ’enfuite onmetdansunmatras
de verre de Lorraine qui tienne trois demi-feptiers ,
voye^ Ma TR AS ; alors on verfe par-deffus un demi-
feptier d’efprit-de-vin , 6c l’on bouche le matras, le
laifl’ant repofer quatre jours durant pour laiffer dil-
foudre la gomme laque ; il faut néanmoins pendant
ce tems-là remuer le matras, comme en rinçant, quatre
ou cinq fois par jo u r , afin d’empêcher que la
gomme laque ne le lie en une maffe , 6c ne s’attache
| aux parois du matras. Mais fi au bout de ces quatre
jours la gomme n’eft pas difloute , on mettra le matras
fur un petit bain de fable , à un feu très-doux ,
voye[ B a in d e s a b l e , pour la faire difloudre entie-
r .ment, 6c lorfq. e '.a laque fera diffoute, le vernis fera
fait. En mettant l elprit-de-vin fur la gomme qui eft
dans le matras, vous le verferez peu-à-peu, afin qu’il
pénétré mieux la poudre, & de tems-en-tems il faut
ceffer de verfer l’efprit-de-vin 6c remuer le matras
en rinçant, 6c continuer jufqu’à ce qu’on y ait mis
tout l’efprit-de-vin, pour qu’il foit bien mêlé avec
la gomme laque.
V e r n i s pour les plâtres , prenez quatre gros du
plus beau fàvon, 6c quatre gros de la plus belle cire
blanche dans une pinte d’eau. L’on met l’eau fur les
cendres chaudes, l’on ratifie le favon 6c la cire que
l’on fait fondre dans cette eau dans un vafe neuf 6c
vernlffé : on y trempe le plâtre en le foutenant un
moment ; un quart-d'heure après, on le retrempe de
même ; cinq ou fix jours après, lorfqu’il eft entièrement
fe c , on le polit en frottant avec un doigt enveloppé
de mouffeline. Ce verni*ne fait aucune épaiffou
r, & conferve au plâtre là blancheur.
Vernis de plomb, (Arts.) on fait le vernis de plomb
en jetraot du charbon pilé dans du plomb bien fondu,
ôc en les remuant long-fems enfemble. On en fépare
le charbon en le lavant dans l'eau, 6c le faifant flécher.
Les Potiers de terre fe fervent du vernis de plomb
ou de plomb minéral pulvérifé, pour vernir leurs ouvrages.
On voit par une lampe verniffée, que M . de
Çaylus a fait graver dans lès antiquités, que les anciens
ont connu l’art de vernir avec le plomb les ouvrages
de terre , comme nous le fai Ions aujourd’hui.
Il eft vrai qu’il y a peu d’exemples de leurs connoif-
fances dans cette matière ; mais celle-là fuffit pour
prouver que les anciens ont connu un très-grand
nombre de pratiques des arts, que plufieurs modernes
leur ont refulëes. (Z), J . }
Vernis, f. m. (Poterie de terre.} efpece d’enduit
brillant que l’on met fur les ouvrages de poterie, 6c
fur ceux de fayance. Le plomb ferr à la verniffure
de la première, 6c la potée pour verniffer l’autre.
m H ■ 11, ■ ■. VERNISSE, adj. ( ^ermjjeur. ) ce qui eft enduit
de vernis ; on le dit aufli des ouvrages de poterie 6c
6c de fayance qui ônt reçu le plomb fondu 6c la
potée.
VERNISSER , v. aft. terme de Poterie , chez les
Potiers de terre, c’eft donner à la poterie avec de
l’alquifoux, ou bien du plomb fondu, une efpece de
croûte ou d’enduit liflè ou brillant. On dit pareillement
verniffer la fayance, ce qui fignifie le J'ervir de
la potée pour lui donner l’émail. (O . J . }
ViRNISSON , le, (Gêog. mod.} petite riviere de
Frmce , en Orléanois. Elle prend là fource auprès
de Gien , 6c tombe dans le Loing un peu au-deffus
de Montargis. (D . J . J
V ERN1SSURE, f. f. application du vernis, Voyc{
ce mot. ,
V E RN O D U RUM , ( Géogr. anc.} fleuve de la
Gaule narbonnoilè , félon Pline, l. I I I . c. iv. C’eft
la Tet qui arrole Perpignan. (D . /.)
VERNON ou VERNON-SUR-SEINE,(Gêog. mod.)
ville de France, en Normandie, lur la gauche de la
Seine, dans une plaine, à 6 lieues au levant d'Evreux,,
à 7 au fud-oueft de Gilors , à 10 au-dellus de
Rouen.
Cette ville a eu fes feigneurs particuliers jufqu’à
ce que Philippe en ait fait i’acquifition, 6c depuis
lors les rois de France ont plufieurs fois donné t'er-
non en apanage aux reines. Il a enluite fait partie du
bailliage de Gilbrs , qui fut cédé avec le duché de
Chartres 6c plufieurs autres terres, par François I.
à; Renée de France, ducheflè de Ferrare. Le tout
paffa à la fille de la ducheflè Renée-Anne d’Eft , qui
époufa en fécondés noces le duc de Nemours ; 6c
c’eft par-là que le comté de Gifors vint à cette mai-
fon de Savoie. Louis XIV. réunit le total au domaine,
mais dans la fuite il donna Gifors 6c fes dépendances
en apanage, avec le titre de vieomte, à Ion petit-fils
le duc de Berry , qui mourut fans enfans avant le roi
fon ayeull’an 1714.
Il y a à Fer non une églife collégiale, un hôpital,
oc plufieurs couvens. Elle eft bien peuplée , a de
bonnes murailles, des fbffés profonds, un gouverneur
, un maire, 6c un college où l’on enleigne les
humanités. Son bailliage eft dans le reffort du préfi-
dial d’Andely. Son commerce confifte principalement
en blé, toiles 6c couvertures de laine.
C’eft à Vern , jadis château royal entre Paris &
Compiegne, 6c non pas à Per non, que fe tint en 7 ç ç
c.°^.c^e national tous le régné de Pépin , pour la
mlciplme eçcléfiaftique , pour les droits de l’Eglilè
OC pour les; immunités en faveur des pèlerins. Loue.
i $ . 8. latit.A9y ^ (D . J . ) ■
I'E R N O SO L a , ( Gèog. anc.) lieu delaCaift^
■ aquit*nique ,.fur .Ia route de TarbesiToulOufe, entre
&c Touloufe, à quinze milles de chacun
de ces iieuïo On croit que ce fi aujourd’hui Ver-
noux , bourg entre Rieux ScTouIoufe, é’leaion de
Corning es, St à1 une lieue de la Garonne. ( D J 1
J-E liO L A M IU H , anc,) ville de la grande
Bretagne. L itinéraire d’Antonio la marque fur la
route du retranchement à Portas - Pumpis , entre
Daropohiv*&LS_ulfomat!Z;,Zt douze milles du premier
de, ces heux, Sc à neuf milles du fécond. Tout le
monde convient que cette ancienne ville étoit près
de S. Albans , qui s’eft accrue de fes ruines. Tacite,
art, l- JC ly . c, x x x iij, donne k Pirolamium ie titre dé
municipe. C’étoit, félon Dion. Çaffius, I. L X . p. yys ,
la capitale des CatueUani, que Ptolomée , /. //. c.iiï,
appelle CpfypnçUani, & auxquels 11. donne la ville.
Vtflanutni qui eû la même que ycroUmiutn.
^ Cette ville, 1 une des premières & des plus eonli-
derables colonies romaines dans la grande Bretagne ,,
fut premièrement ruinée par les Bretons dans le fou-
levemen* de la reine Boodicia ; mais elle fe rétablit
bientôt, & elle devint plus puilTante que jamais.
Elle fut ruinée une fécondé fois durant les guerres
des Saxons 6c des Bretons, 6c elle ne le releva pas
de cette chute.- , r
On voit encore les velîiges des anciennes mu.
railles, 6ç des foffés qui ont douze cens foixante-dix
pas de circuit. On a trouve dans ces mazures quantité
de raonumens, comme des médailles, des: petites;
figures d’or 6c d’argent, des colonnes, des pavés de
roofaïque, des fouterreins, 6c autres choies fem-
blables, Il paroit outre cela qu’elle étoit fituée fur
une grande route pavée autrefois par les légions
romaines , & que les Saxons nommèrent VotUno-
Strcat, Ces peuples s’étant rendus maîtres de Vcm-
lamtttm, l’app.ellerent JPatlingacefit, , à caufe du grand
chemin dont il vient d’être parlé. Depuis on lui donna
le nom de Wtrlamctfit,■, & de-là vient qu’encore.
aujourd'hui on lui donne communément celui de
Wirlatn.
de 1 royes, Jurent appelés de France pour aider i
eteindre 1 heréfie pélagienne , qui rocommençoit l
etre goutee dans les ég lifes. de la grande Bretagn e. C e
fut auprès, de ^trolcim um , félon le vénérable Bede .
hjfl. tcttlef. t. I , c, vij. que S. Albans ou S. Albin foufl
frit le martyre ie 10 des calendes de Juillet. Dans la
lutte, les babi'tans s'étant convertis , fondèrent un
magnifique monartere à l’honneur de ce laint 1 6e
1 ffe” ce monaftere qui a donné l’origine & le nom au
bourg de 3 - Albans. (D . / . }
Iy.ÉR?LE, petite , ( B Je U Médecine. ) il ne
s agit ici que de l’biflorique de cette étrange maladie,
qui eu aujourd’hui répandue dans tout le monde
connu, & qui laifit tôt ou tard toutes fortes de per-
tonnes, fansavoir égard au climat, à l’âge, au fixe
ni au tempérament du malade. Soit que les ravages
de cette maladie procèdent de la violence qui lui efl
propre, ou des mauvaifes méthodes dont on fe ferl
pour la traiter , elle ne cede point à la pelle par les
defaftresqu’elle.caufe,,. ,
y On a tout lieu de préfumer que la pttiu virole a
ete inconnue aux Grecs 6c aux Romains, pnifquW
cun médecin de ce tems-1 4 ne nous en a laifle la def-
cripiion. Des auteurs tels qu’Hippocrate , Aretée
Celte, Coelius l’Africain , 6c Soranus d’Ephefe qui
reufiiffoient & bien dans les deferiptions des male.-
dies, qu’on peut les regarder plutôt comme des peintures
achevées que comme des hifloires, car les an,
tiens o’excelloient pas moins dans les deferiptions
que dans la poéfie, la fculpture 6c la peinture, nW
I oient pas négligés de nous parler de fa pttiu virole
fi. elle «ûbexiflé de leur teoes. JJ peut cependant fe