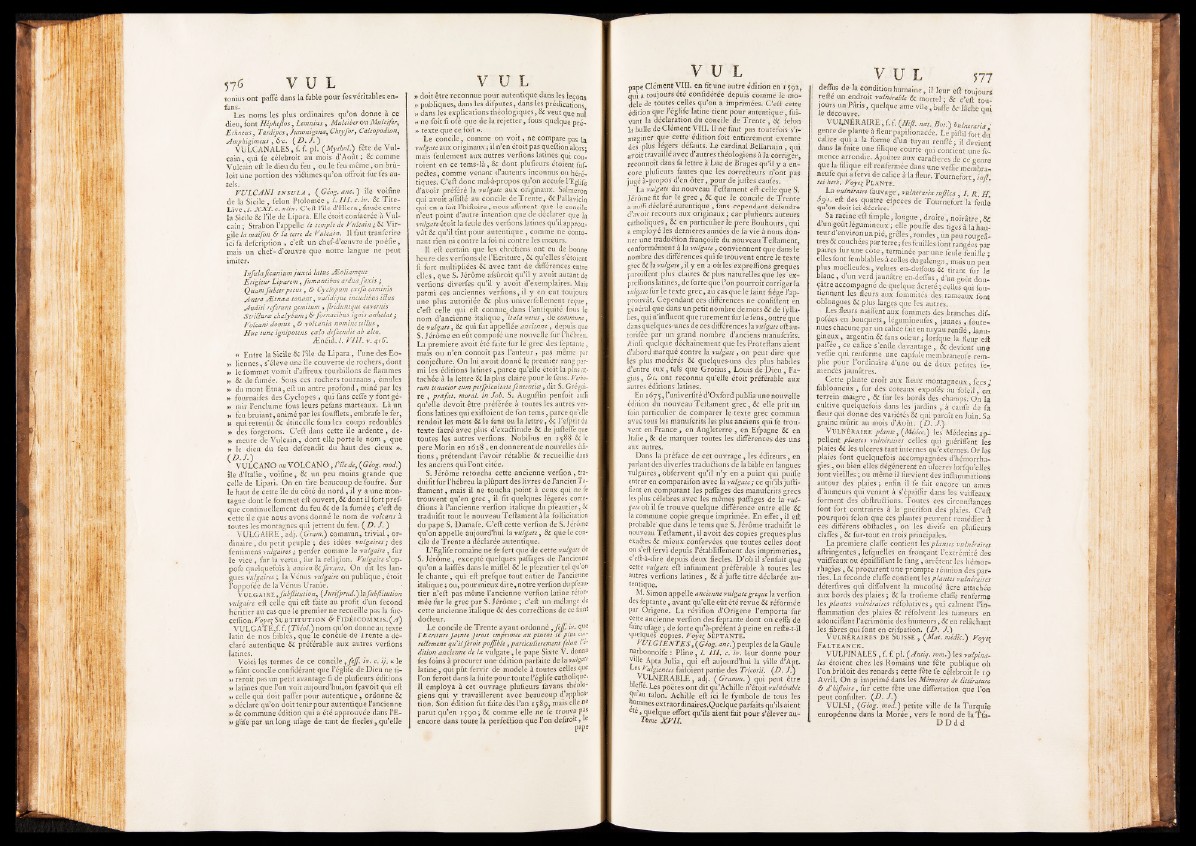
sonius ont paffé dans la fable pour fes véritables en-
fans. ^
Les noms les plus ordinaires qu’ on donne à ce
dieu, font Héphejlos, Lernnius , Mulciber ou Mulcifer,
Ethneus, Tardipes, Junonigcna, Chryfor, Caleopodion,
Amphigimeus , &c. { D . J . )
VU LCANA LE S , f. f. pl. (Mythôl.) fête de Vulcain
, qui fe célebroit au mois d’Août ; 8c comme
Vulcain eft le dieu du feu , ou le feu même, on brû-
loit une portion des victimes qu’on offroit fur fès autels:
. '••• i
VULCA N I in s u l a , ( Gèog. anc.') île voifine
de la Sicile , félon Ptolomée, L. I I I . c. iv. 8c Tite-
Live L. X X I . c. x lix. C’eft l’île d’Hiera, fituée entre
la Sicile 8c l*île de Lipara. Elle étoit confacrée à Vulcain
; Strabon l’appelle le temple de Vulcdin ; 8c Virgile
la maifon & la terre de Vulcain. Il faut tranfcrire
ici fa defcription , c’eft un chef-d’oeuvre de poéfie,
mais un chef- d’oeuvre que notre langue ne peut
imiter.
Infula ficanium ju xtà laïus Æoliamque
Erigitur Liparem, fumantibus arduafaxis ;
QuamJubterpecus, & Cyclopum exefa caminis
Antra Ætncea tonant, validique incudibus ictus
Auditi referunt gemitum , Jlriduntque cavernis
S inclura chalybum; & fornacibus ignis anhelat ;
Volcani donnes , & volcania nomine tellus,
Hue tune ignipotens coelo defeendit ab alto.
Ænéid. /. V II I . v. 41 (f.
« Entre la Sicile 8c 111e de Lipara, l’une des Eo-
» bennes, s’élève une île couverte de rochers, dont
» le fommet vomit d’affreux tourbillons de flammes
» & de fumée. Sous ces rochers tournans , émules
» du mont Etna, eft un antre profond, miné par les
» fournaifes des Cyclopes , qui fans ceffe y font gé-
» mir l’enclume fous leurs pefans marteaux. Là un
» feu bruiant, animé par les foufflets, embrafe le fer,
» qui retentit 8c étincelle fous les coups redoublés
» des forgerons. C’eft dans cette île ardente, de-
» meure de Vulcain ,. dont elle porte le nom , que
» le dieu du feu defeendit du haut des deux ».
{ D . J . )
VULCANO ou VO LCANO, Vile de, {Gèog. mod.')
île d’ Italie, voifine, 8c un peu moins grande que
celle de Lipari. On en tire beaucoup de foufre. Sur
le haut de cette île du côté du n ord , il y a une montagne
dont le fommet eft ouvert, & dont il fort pref-
que continuellement du feu 8c de la fumée ; c’eft de
cette île que nous avons donné le nom de volcans à
toutes les montagnes qui jettent du feu. { D . J . )
VU LG A IR E , adj. (Gram.) commun, tr ivia l, ordinaire
, du petit peuple ; des idées vulgaires; des
fentimens vulgaires ; penfer comme le vulgaire , fur
le vice , fur la vertu, fur la religion. Vulgaire s’op-
pofe quelquefois à ancien 8cJavant. On dit les langues
vulgaires ; la V énus vulgaire ou publique, étoit
l ’oppofée de la Vénus Uranie.
VULGAIRE,fubflitution, {Jurifprud.) lafubfiitution
vulgaire eft celle qui eft faite au profit d’un fécond
héritier au cas que le premier ne recueille pas la fuc-
ceflïon. Voyc^Su btitu tion & Fidéicommis. ( ^ )
VULG A T E ,f. f. {Théol.) nom qu’on donne au texte
latin de nos bibles, que le concile de Trente a déclaré
autentique 8c préférable aux autres verfions
latines.
Voici les termes de ce concile ,feff. iv. c. ij. « le
» faint concile confidérant que l’églife de Dieu ne ti-
» reroit pas un petit avantage fi de plufieurs éditions
» latines que l’on voit aujourd’hui,oh fçavoit qui èft
» celle qui doit paffer pour autentique , ordonne 8c
» déclare qu’on doit tenir pour autentique l’ancienne
» & commune édition qui a été approuvée dans PE-
» glife par un long ufage de tant de fieeles, qu’elle
» doit être reconnue pour autentique dans les leçons
» publiques, dans les difputes, dans les prédications
» dans les explications théologiques, 8c veut que nul
» ne fo itfio fé que de larejetter, fous quelque pré-
» texte que ce foit ».
Le concile, comme on v o i t , ne compare pas là
vulgate aux originaux ; il n’en étoit pas qu eft ion alors*
mais feulement aux autres verfions latines qui cou-
roient en ce tems-là, 8c dont plufieurs étoient fuf-
peftes, comme venant d’auteurs inconnus ou hérétiques:
C’eft donc mal-à-propos qu’on accufe l ’Eglife
d’avoir préféré la vulgate aux originaux. Salmeron
qui avoitaflifté au concile de Trente, &PaIlavicin
qui en a fait l’hiftoire, nous affurent que le concile
n’eut point d’autre intention que de déclarer que la
vulgate étoit la feule des verfions latines qu’il.approuvât
8c qu’il tînt pour autentique , comme ne contenant
rien ni contre la foi ni contre les moeurs.
Il eft certain que les chrétiens ont eu de bonne
heure des verfions de l’Ecriture, 8c qu’elles s’étoient
fi fort multipliées 8c avec tant de différences entre
e lle s, que S. Jérôme afsûroit qu’ il y avoit autant de
verfions diverfes qu’il y avoit d’exemplaires. Mais
parmi ces anciennes verfions, il y en eut toujours
une plus autorifée 8c plus univerfellement reçue,
c’eft celle qui eft connue dans l’antiquité fous le
nom d’ancienne italique, itala vêtus, de commune,
de vulgate, 8c qui fut appellée ancienne , depuis que
S. Jérôme en eût compofé une nouvelle fur l’hébreu.
La première avoit été faite fur lé grec des feptante,
mais 011 n’en connoît pas l’auteur, pas même par
conje&ure. On lui avoit donné le premier rang parmi
les éditions latines, parce qu’elle étoit la plus attachée
à la lettre 8c la plus claire pour le fens. Verbo-
rum tenacior curn perfpicuitate fententioe, dit S. Grégoire
, preefat. moral, in Job. Si Auguftin penfoit aufli
qu’elle devoit être préférée à toutes les autres verfions
latines qui exiftoient de fon tems, parce qu’elle
rendoit les mots 8c le fens ou la lettre, 8c l ’efprit du
texte facré avec plus d’exaâitude 8c de jufteffe que
toutes les autres verfions. Nobilius en 1588 & le
pere Morin en 1628 , en donnèrent de nouvelles éditions
, prétendant l’avoir rétablie 8c recueillie dans
les anciens qui l’ont citée.
- S. Jérôme retoucha cette ancienne verfion , traduifit
fur l’hébreu la plupart des livres de l’ancien Te-
ftament, mais il ne toucha point à ceux qui ne fe
trouvent qu’en grec , il fit quelques légères corre-
ûions à l’ancienne verfion italique du pfeautier, &
traduifit tout le nouveau Teftamentàla follicitation
du pape S. Damafe. C’eft cetté verfion de S. Jérôme
qu’on appelle aujourd’hui la vulgate, 8c que le concile
de Trente a déclarée autentique.
L’Eglife romaine ne fe fert que de cette vulgate de
S. Jérôme, excepté quelques paffages de l’ancienne
qu’on a laiffés dans le miffel 8c le .pfeautier tel qu’on
le chante, qui eft prefque tout entier dé l’ancienne
italique ; ou, pour mieux dire, notre verfion du pfeautier
n’eft pas même l’ancienne verfion latine réformée
fur le grec par S . Jérôme ; c’eft un mélange de
cette ancienne italique 8c des correftions de ce faint
doâeur.
Le concile de Trente ayant ordonné ,feff. iv. que
X Ecriture fainte f croit imprimée au plutôt le plus correctement
q u 'ilJ croit pojjible , particulièrement félon l P'
dition ancienne de la vulgate, le pape Sixte V. donna
fes foins à procurer une édition parfaite de là vulgate
latine, qui pût fervir de modèle à toutes celles que
l’on feroit dans la fuite pour toute l’églife catholique.
Il employa à cet ouvrage plufieurs favans théologiens
qui y travaillèrent avec beaucoup d’application.
Son édition fut faite dès l’an 1589, mais elle ne
parut qu’en 15 9 0 ; 8c comme elle ne fe trouva pas
encore dans toute la perfe&ion que l’on defiroit, le
pape
pape Clément V IS . en fit une autre édition en 1Ç92,
qui a toujours été confédérée depuis comme lé modèle
de toutes celles qu’on a imprimées. C’e lf cette
édition- que Féglife latine tient pour autentique-, fui-
vant la déclaration du concile de Trente , 8c félon
là bulle d'e-Clément VIII. Il ne faut pas tôutèfois s’imaginer
que- cette- édition foit entièrement exemte
dès plus légers défauts. Le Cardinal Bellàrmjn , qui
avoit travaillé avec d’autres théologiens à la-corriger,
réconnoît dans fa lettre à Luc de Brugés qu’il y a encore
plufieurs fautes que les correcteurs n’ont pas.
jugé à-propos d’ en ôter, pour de juftes eaufès.
La vulgate du nouveau Teftament eft celle que S.
Jérôme fit fur le grec , & que le concile de Trente
a:auffi déclaré.autentique , fans cependant défendre
d’avoir recours aux originaux; car plufieurs auteurs
catholiques, 8c en particulier le pere Bouhours , -qui
a employé les dernieres années de fa v ie à nous donner
une traduction françoife du nouveau Teftament,
conformément à la vulgate , conviennent que dans le
nombre dès différences qui fe trouvent entre le texte
grec 8c la vulgate, il y en a oit lès expreffîons greques
paroiffent plus claires 8c plus naturelles que les ex-
preflions latines, de forte que l’on pourroit corriger la
vulgate fur le texte grec, au cas que le faint fiége l’approuvât,
Cependant c es différences ne confiftent en
général que dans un petit nombre de mots & de fy liâtes,
qui n’influent que rarement fur le fens, outre que
dans quelques-unes de ees différences la vulgate eft autorifée
par un grand nombre d’anciens manuferirs.
Ainfi quelque déchaînement que les Proteftans aient
d’abord marqué contre la vulgate , on peut dire que
lès plus modérés 8c quelques-uns des plus habiles
d’entre eu x , tels que Grotius, Louis de D ie u , Fa-
gius, ont reconnu qu’elle étoit préférable aux
autres éditions latines.
En 16 7 5, l’univerfité d’Oxford publia une nouvelle
édition du nouveau Teftament grec, 8c elle prit un
foin particulier de comparer le texte grec Commun
avec tous les manuferits les plus anciens qui fe trouvent
en France, en Angleterre , en Efpagne 8c en
Italie, & de marquer toutes les différences des uns
aux autres.
Dans la préface de cet ouvrage, les éditeurs, en
parlant des diverfes traduirions de la bible en langues
vulgaires , obfervent qu’il n’y en a point qui puiffe
entrer en comparaifon avec la vulgate; ce qu’ils jufti-
fient en comparant les paffages des manuferits grecs
lès plus célébrés avec les mêmes paffages de la vul-
ga/e où il fe trouve quelque différence entre elle 8c
la commune copie greque imprimée. En effet, il eft
probable que dans le tems que S. Jérôme traduifit le
nouveau Teftament, il avoit des copies greques plus
exattes 8c mieiix confervées que toutes celles dont
on s’ eft fervi depuis l’établiffement des imprimeries,
c eft-à-dire depuis deux fieeles. D ’où il s’enfuit que
cette vulgate eft infiniment préférable à toutes les
autres verfions latines, 8c à jufte titre déclarée autentique.
M. Simon appelle ancienne vulgate greque la verfion
des fèptante, avant qu’elle eût été revue 8c réformée
par Origene. La révifion d’Origene l’emporta fur
cette ancienne verfion des feptante dont on cefla de
faire ufage ; de forte qu’à-préfent à peine en refte-t-il
quelques copies. Voye^ Septante.
^U L G IEN T E S , {Gèog. anc.) peuples de la Gaule
qarbonnoife : Pline, l. I I I . c. iv. leur donne pour
ydle Apta Ju lia , qui eft aujourd’hui la ville d’Apt.
Les Vulguntes faifoient partie des Tricorii. {D . j l )
VULNÉRABLE, adj- {Gramm.) qui peut être
bleffé. Les poètes ont dit qu’Achille n’étoit vulnérable
| P au taloji. Achille eft ici le fymbole de tous les
/Ommes extraordinaires.Quelque parfaits qu’ils aient
ete 9 quelque effort qu’ils aient fait pour s’elever au-
Tome X V 1L
dtflbs d * la condition humaine, il l'enr eft-toujours
refte un endroit vulnérable & mortel ; & c’eft tou-
joiws un P âtis, quelque ame vile , baffe &• fâché qui
le découvre. ^
V U LN É R A IR E , f. £ m
genre de plante à-fleur papilionacce. Le piftil fort dtt
caliæe qui a la forme dfon tuyau renfle ; il devient
dans la- fuite une ftlique courte qui contient une fe-
mence arrondie. Ajoutez aux carafteres de ce genre
que la. filique eft' rehfërmée dans une veffie foembra.
neule qm a fervi de calice à la fleur. Tournefort, in/l.
reïhwb. Woyt^ P l a n t e . j
La vulnéraire fauvage', vulneraria ruftica , I. R f f
6c, 1. eft des quatre eipeces de Tournefort l’a feulé
qu on doit ici décrire.
Sa racine eft fimple, longue, droite, noirâtre 8c
d’un goût Jégumineux ; elle pouffe des tiges à la Hauteur
d’environ un pié, grêlés, rondes, un peu rougeâtres
8c couchées par terre ; fes feuilles font rangées par
paires fur une côt,e, terminée par une feule feuille ;
e les font femblables. à celles dugalenga', mais un peu
plus moelleufesv, velues en-de flous 8c tirant fur le
blanc, d’un verd jaunâtre en-deffus, d’un goût dou-
çatre accompagné de -quel.que âcreté celles qui fou-
tiennent les fleurs: aux fomnutés. des rameaux font
oblongnes 8c plus larges, que les autres.
Les fleurs naiffentaux fomm.ets des branches diG
pofées en bouquets, légumineufes, jau,nes , foute-
nues chacune par un calice fait en tuyau renflé, lanugineux
, argentin 8c fans odeur.; lorfque la fleur eft
paffëe, ce calice s’enfle, davantage , 8c devient’ une
veffie qui renferme une capfule membraneufç remplie
pour l’Ordinaire d’üne ou dé deux petites fe-
menéès jaunâtres. v
Cette plante croît aux lieux montagneux, fecs ^
fablonneüx , fur des coteaux expofés au foie i l , en
terrein- maigre, 8c fur les bords des -champs.' On la
cultive quelquefois dans lés'jardins , à caii-fé de fa
fleur qui donne des variétés 8c qui pa-roît en Juin. Sa
graine mûrit au mois d’Août. {D . J .)
V u l n é r a i r e plante, {Médec.) les Médecins appellent
plantes vulnéraires celles qui guériffent les
plaies 8c les ulcérés tant internes qu’ex-ternes. Or les
plaies font quelquefois accompagnées d’hémorrhagies
, ou bien elles dégénèrent en ufeeres lorfqu’elles
lont vieilles ; ou même il furvient des inflammations
autour des plaies ; enfin il fe fait encore’ un amas
d’humeurs qui venant à s’épaiflir dans les vaiffeaux
forment des obftru&ions. Toutes ces eirconftances
font fort contraires à la guérifon des plaies. C’eft
pourquoi félon que ces plantes peuvent remédier à
ces différens obftacles, on les divife en plufieurs
claffes , 8c fur-tout en trois principales. '
La première claffe contient les plantes vulnéraires
aftringentes , lefquelles en fronçant l’extrémité des
vaiffeaux ou épaiflïffant le fang , arrêtent les hémorrhagies
, & procurent une prompte réunion des parties.
La fécondé claffe contient les plantes vulnéraires
déterfives qui diffolvent la mucofité âçre attachée
aux bords des plaies ; 8c la trofieme claffe renferme
les plantes vulnéraires réfolutives, qui calment l’inflammation
des plaies & réfolvent les tumeurs en
adouciffant l’acrimonie des humeurs, & en relâchait
les fibres qui font en crifpation. {D . J .)
V u l n é r a i r e s d e Su i s s e , {Mat. mèdic.) Fbyei
F a l t r a n c k .
VULPINALES , f. f, pl. {Antiq. rom.) les vulpind-
les étoient chez les Romains une fête publique où
l’on brûloit dès renards ; cette fête fe célebroit le 1 o
Avril. On a imprimé dans les Mémoires de littérature
& d'hijloire, fur cette fête une differtation que l’on
peut cojifulter. {D . J . )
V U L S I, {Géog^mod.) petite ville de la Turquie
européenne dans la Morée, vers le nord de la Tfa-
D D d d
I