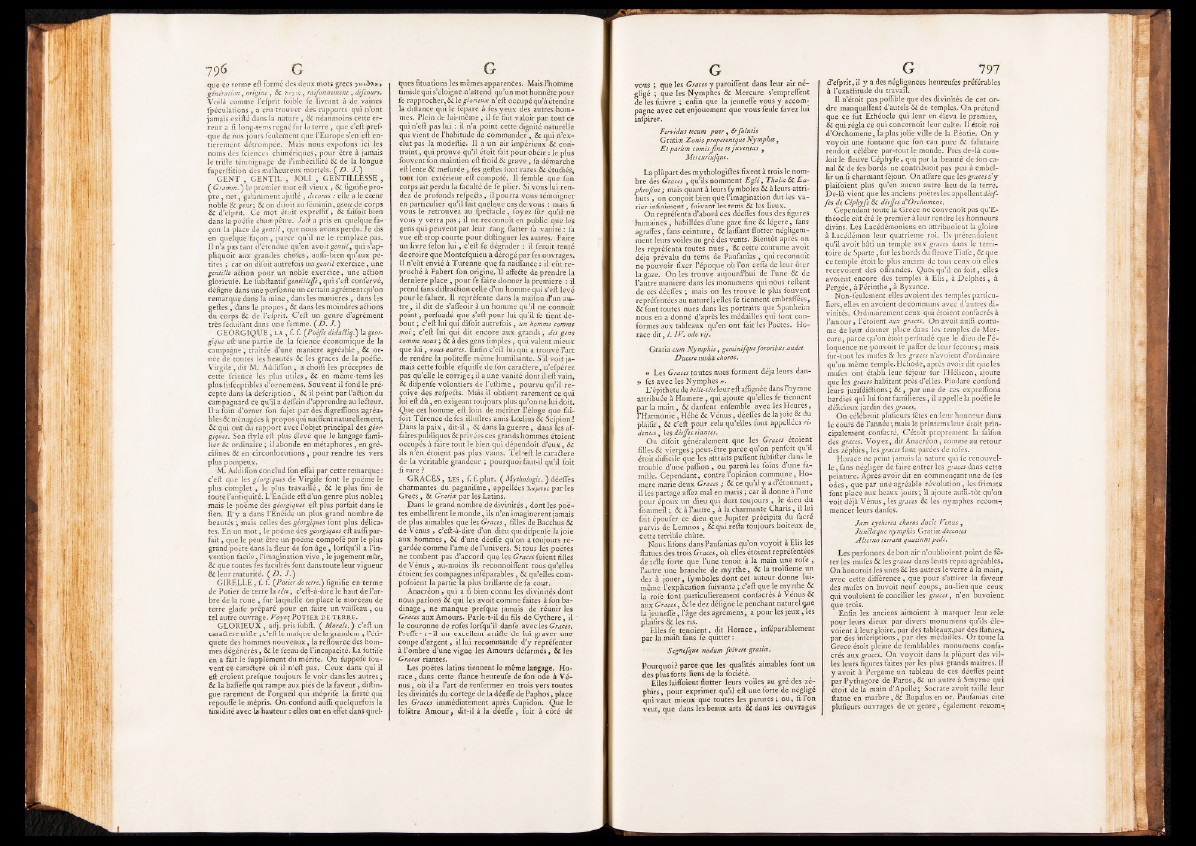
que ce terme eft Formé des deux mots grecs
vénération, origine, & Xoycç, raifonnement, difeours.
Voilà comme l’efprit foible fe livrant à de vaines
Spéculations , a cru trouver des rapports qui n’ont
jamais exifté dans la nature , & néanmoins cette erreur
a fi long-tems régné fur la terre , que c’eft prefque
de nos jours feulement que l’Europe s’en eft entièrement
détrompée. Mais nous expofons ici les
noms des fciences chimériques, pour être à janiais
le trifte témoignage de l’imbécillité & de la longue
fuperftition des malheureux mortels. ( D . /.')
G EN T , G ENTIL , JOLI , GENTILLE SSE ,
( Gramm. ) le premier mot eft vieux , & Signifie propre
, net, galamment ajufté , decorus : elle a le coeur
noble & genr, & o n difoit au féminin, gente de corps
&. d’efpfit. Ce mot étoit e xpreiîif, & faifoit bien
dans la poéfie champêtre. Jo it a pris en quelque faucon
la place de gentil, que nous avons perdu. Je dis
en quetquë'façon , parce qu’ il ne le remplacé pas.
Il n’a pas tant d’étendue qu’en avoiX gentil 9 quis’ap-
pliquoit aux grandes choies, auffi-bien qu’aux petites
; car on difoit autrefois un gentil exercice, une
gentille aftion pour un noble exercice, une aftion
glorieufe. Le fubftantif genùlltffe, qui s’ eft confervé,
défigne dans une perfonrte un certain agrément qu’on
remarque dans la mine, dans les maniérés , dans les
geftes, dans le propos, & dans les moindres aélions
du corps & de l’efprit. C’eft un genre d’agrément
très féduifant dans une femme. (D . J . )
G E 0 R G IQ U E , LA , f. f. (Poéfie didacliqf) la geor-
gique eft une partie de la fcience économique de la
campagne ,• traitée d’une maniéré agréable, & ornée
de toutes Us beautés & les grâces de la poéfie.
Virgile vdit M. Addiffon , a choifi les préceptes dè
cette fcience lés plus utiles, & en même-tems les
plus-liifceptibles d’ornemens. Souvent il fond le précepte1
dans la defeription , & il peint par iaéfion du
campagnard ce qu’il a deffein d’apprendre au letteur.
I l a foin d’orner fon fujet-par des digreffions agréar
blés & ménagées à propos qui naiffent naturellement,
& qui ont du rapport avec l’objet principal des géor-
giques. Son ftyle eft plus élevé que le langage familier
& ordinaire ; il abonde en métaphores, en gré-
cifmes & en circonlocutions, pour rendre fes vers
plus pompeux.
M. Addiffon conclud fon effai par cette remarque :
c’eft que les géorgiques de Virgile font le poëme le
plus complet , le plus travaillé, & le plus fini de
toute l’antiquité. L’Enéide eft d’un genre plus noble;
mais le poëme des géorgiques eft plus parfait dans le
lien. Il* y à dans l’Enéide un plus grand nombre de
beautés ; mais celles des géorgiques font plus délicates.
En un mot, le poëme des géorgiques eft auffi parfait
, que le peut être un poëme compofé par le plus
grand poëte dans la fleur de fon âg e , lorfqu’il a l’invention
facile, l’imagination v iv e , le jugement mûr,
& que toutes fes facultés font dans toute leur vigueur
& leur maturité. (Z>. 7.)
G IR E L L E , f. f. (Potier de terre.) fignifie en terme
de Potier de terre la tête y c’eft-à-dire le haut de l’arbre
de la roue , fur laquelle on place le morceau de
terre glaife préparé pour en faire un vaiffeau, ou
tel autre ouvrage. Voye{ Potier de t e r r e .
G LORIEUX , adj. pris fubft. ( Morale. ) c’eft un
caraâere trifte ; c’eft le mafque de la grandeur, l’étiquete
des hommes nouveaux, la reffource des hommes
dégénérés, & le fceau de l’ incapacité. La fottife
en a fait le fupplément du mérite. On fuppofe fou-
vent ce cara&ere où il n’eft pas. Ceux dans qui il
eft croient prefque toujours le voir dans les autres ;
& la baffeffe qui rampe aux piés de la faveur, diftin-
gue rarement de l’orgueil qui méprife la fierté qui
repouffe le mépris. On- confond auffi quelquefois la
timidité avec 1a hauteur : elles ont en effet dans quelques
fituatxons les mêmes apparences. Mais l’homme
timide qui s’éloigne n’attend qu’un mot honnête pour
fe rapprocher, & le glorieux n’eft occupé qu’à étendre
la diftance qui le fépare à fes yeux des autres hommes.
Plein de lui-même , -il fe fait valoir par tout ce
qui n’eft pas lui : il n’a point cette dignité naturelle
qui vient de l’habitude de commander , & qui n’exclut
pas la modeftie. Il a un air impérieux & contraint
, qui prouve qu’il étoit fait pour obéir : le plus
foüventfon maintien eft froid & grave , fa démarche
eft lente & mefurée, fes geftes font rares & étudiés;
tout fon extérieur eft compofé. Il femble que fon
corps ait perdu la faculté de fe plier. Si vous lui rendez
de profonds refpeûs, il pourra vous témoigner
en particulier qu’il fait quelque cas de vous. : mais fi
Vous le retrouvez au fpeûacle, foyez fur qu’il nè
vous y verra pas ; il ne reconnoît en public: que les
gerfs qui peuvent par leur rang flatter fa vanité : fa
vue eft trop courte pour diftinguer les autres. Faire
un livre félon lu i , c’eft fe dégrader : il feroit tenté
de croire que Montefquieu a dérogé par fes .ouvrages.
Il n’eût envié à Turenne que fa naiffance : il eût re^-
proehé à Fabert fon origine, il affe&e de prendre la
derniere place , pour fe faire donner la première : il
prend fans diftraûion celle d’un homme qui is’eft levé
pour le faluer. Il repréfente dans la maifon d*un ai*-
t r e , il dit de s’affeoir à un homme qu’il ne connoît
oin t, perfuadé que s’ eft pour lui qu’il fe tient de-
out ; c’eft lui qui difoit autrefois, un homme comme
mot ; c’eft lui qui dit encore aux grands ; des gens
comme nous ; & à des gens Amples, qui valent mieux
que lu i, vous autres. Enfin c’eft lui qui a trouvé l’art
de rendre la politeffe même humiliante. S’il voit jamais
cette foible efquiffe de fon caraftere, n’efpérez
pas qu’elle le corrige ; il a une vanité dont il eft vain,
& dilpenfe volontiers de l’eftime , pourvu qu’il re?-
çoive des refpe&Si Mais il obtient rarement ce qui
lui eft d û , en exigeant toujours plus qu’on ne lui doit.
Que cet homme eft loin de mériter. Béloge que fai-
foit Térence de les illuftres amis Loelius &c ScipionJ
Dans la p a ix , d it-il, & dans la guerre , dans les affaires
publiques & privées ces grands hommes étoient
occupés à faire tout le bien qui dépendoit d’eu x , &
ils n’en étoient pas plus vains. Tel-eft le caraâere
de la véritable grandeur ; pourquoi faut-il qu’il foit
fi rare ?
G R A C E S , les , f. f.plur. ( Mythologie. ) déeffes
charmantes du paganifme, appellées xàpnnc par les
G re c s, & Gratine par les Latins,
Dans le grand nombre de divinités, dont les poètes
embellirent le monde, ils n’en imaginèrent jamais
de plus aimables que les Grâces, filles de Bacchus &
de Vénus , c’eft-à-dire d’un dieu quidifpenfe la joie
aux hommes, & d’une déeffe qu’on a toujours regardée
comme l’ame de l’univers. Si tous les poëtes
ne tombent pas d’accord que les. Grâces foient filles
de Vénus, au-moins ils reconnoiffent tous qu’elles
étoient fes compagnes inféparables, & qu’elles com-
pofoient la partie la plus brillante de fa cour.
Anacréon, qui a fi bien connu les divinités dont
nous parlons &c qui les avoit comme faites à fon badinage
, ne manque prefque jamais de réunir les
Grâces aux Amours. Parle-t-il du fils de Cythere, il
le couronne de rofes lorfqu’il danfe avec les Grâces.
Preffe - 1 - il un excellent artifte de lui graver une
coupe d’argent, il lui recommande d’y repréfenter
à l’ombre d’une vigne les Amours défarmes, & les
Grâces riantes.
Les poëtes latins tiennent le même langage. Horace
, dans cette ftance heureufe de fon ode à Vénus
, où il a l’art de renfermer en trois yers toutes
les divinités du cortege de la déeffe de Paphos, place
les Grâces immédiatement après Cupidon. Que le
folâtre Amour, dit-il à la déeffe , loit à côté de
vous ; que les Grâces y paroiffent dans leur air négligé
; que les Nymphes & Mercure s’empreffent
de les fuivre ; enfin que la jeuneffe vous y accompagne
avec cet enjouement que vous feule favez lui
inipirer.
Fervidus tecum puer, & folutis
Gratiæ Zonis properentque Nymphce y
E t paràm comis Jîne te juvtntas
Mercuriufque.
La plûpart des mythologiftes fixent à trois le nombre
des Grâces , qu’ils nomment E g lê , Thalie & Eu-
phrojine ; mais quant à leurs fymboles & à leurs attributs
, on conçoit bien que l’imagination dut les varier
infiniment, fuivant les tems & les lieux.
On repréfenta d’abord ces déeffes fous des figures
humaines , habillées d’une gaze fine & légère, fans
agraffes , fans ceinture, & laiffant flotter négligemment
leurs voiles au gré des vents. Bientôt après on
les repréfenta toutes nues, & cette coutume avoit
déjà prévalu du tems de Paufanias , qui reconnoît
ne pouvoir fixer l’époque'où l’onceffa de leur ôter
la gaze. On les trouve aujourd’hui de l’une & de
l’autre maniéré dans lés monumens qui nous reftent
de ces déeffes ; mais on les trouve le plus fouvent
repréfentées au naturel; elles fe tiennent embraffées,
& font toutes nues dans les portraits que Spanheim
nous en a donné d’après les médailles qui 'font conformes
aux tableaux qu’ en ont fait les Poëtes. Horace
dit, /. IV. ode vij.
Gratia cum N ymphis,- geminifquefororibus audet
Ducere nuda ciioros. •
« Les Grâces toutes nues forment déjà leurs dan-
v fes avec les Nymphes ».
L’épithete de belle-tête leur eft affignee dans l’hymne
attribuée à Homere , qui ajoute qu’elles fe tiennent
par la main, & danfent enfemble avec les Heures,
l’Harmonie, Hébé & V énus, déeffes de la joie & du
plaifir, & c’eft pour cela qu’elles font appellées ri-
dentes, les déejfes riantes.
On difoit généralement que les Grâces etoient
filles & vierges ; peut-être parce qu’on penfoit qu’il
«toit difficile que les attraits puffent fubfifter dans le
trouble d’une paffion , ou parmi les foins d’une famille.
Cependant, contre l’opinion commune, Homere
marie deux Grâces ; & ce qu’il y a d’etonnant,
il les partage affez mal en maris ; car il donne a 1 une
pour époux un dieu qui dort toujours , le dieu du
fommeil ; & à l ’autre, à la,charmante Charis, il lui
fait époufer ce dieu que Jupiter précipita du facre
parvis de Lemnos , & q u i refta toujours boiteux de,
cette terrible chûte. ' r
Nous lifons dans Paufanias qu’on voyoit à Elis les
ftatues des, trois Grâces, où elles étoient repréfentées
de telle forte que l’une tenoit à la main une rofe ,
l’ autre une branche de myrthe, & la troifieme un
dez à jouer, fymboles dont cet auteur donne lui-
même l’explication fuivante ;,c’eft que le myrthe &
la rofe font particulièrement confacrés à Vénus &
autl Grâces, ôde dez défigne le penchant naturel que
la jeuneffe, l’âge des agremens, a pour les jeu x , les
plaifirs & les ris. .
Elles fe tenpient, dit Horace, inféparablement
par la maih fans fe , quitter :
Segnefque nodum folvere gratia.
Pourquoi? parce que les qualités aimables font un
des plus forts liens de la fociété.
Elles laiffoient flotter leurs voiles au gré des zé-
phirs, pour exprimer qu’il eft une forte de négligé
qui vaut mieux que toutes les parures ; ;ou, fi l’on
veut, que dans les beaux arts & dans les ouvrages
d’efpritjil y a des négligences heureufes préférables
à l’exaftitude du travail.
Il n’étoit pas poffible que des divinités de cet ordre
manquaffent d’autels & de temples. On prétend
que ce fut Ethéocle qui leur en éleva le premier,
& qui régla ce qui concernoit leur culte.- Il étoit roi
d’Orchomene, la plus jolie ville de la Béotie. On y
voyo it une fontaine que fon eau pure & falutaire
rendoit célébré par-tout le monde. Près de-là cou-
loit le fleuve Céphyfe, qui par la beauté de fon canal
& de fes bords ne contribuoit pas peu à embellir
un fi charmant féjour. On affure que les grâces s’y
plaifoient plus qu’en aucun autre lieu de la terre.
De-là vient que les anciens poëtes les appellent décf-
fes de Céphyfe & déeffes dyOrchomene.
Cependant toute la Grece ne convenoit pas qu’E-
théocle eût été le premier à leur rendre les honneurs
divins. Les Lacédémoniens en attribuoient la gloire
à Lacédémon leur quatrième roi. Ils prétendoient
qu’ il avoit bâti un temple aux grâces dans le territoire
de Sparte, fur les bords du fleuve T ia fe , & que
ce temple étoit le plus ancien de tous ceux où elles
recevoient des oflrandes. Quoi qu’il en fo it, elles
avoient encore des temples à Elis, à Delphes, à
Pergée, à Périnthe, à Byzance.
Non-feulement elles avoient des temples particuliers,
elles en avoient de communs avec d’autres divinités.
Ordinairement ceux qui étoient confacrés à
l’amour, l’ étoient aux grâces. On avoit auffi coutume
de leur donner place dans les temples de Mercure,,
parce qu’on étoit perfuadé que le dieu de l’ éloquence
ne pouvoit fe paffer de leur fecours ; mais
fur-tout les mufes & les grâces n’avoient d’ordinaire
qu’un même temple. Héfiode, après avoir dit que les
mufes. ont établi leur féjour fur i’Hélicon, ajoute
que les grâces habitent près d’elles. Piadare confond
leurs jurifdi&ions ; & , par une de ces expreffions
hardies qui lui font familières, il appelle la poéfie le
délicieux jardin des grâces.
On célébroit plufieurs fêtes en leur honneur dans
le cours de l’année ; mais le printems leur étoit principalement
confacré, C’étoit proprement la faifon
des grâces. V o ye z, dit Anacréon, comme au retour
des zéphirs, les grâces font parées de rofes.
Horace ne peint jamais la nature qui fe renouvelle
, fans négliger de faire entrer les grâces dans cette
peinture. Après avoir dit en commençant une de fes
odes, que par une agréable révolution, les frimats
font place aux beaux jours ; il ajoute auffi-tôt qu’on
voit déjà V énus, les grâces & les nymphes recommencer
leurs danfes.
Jam cytlierea ckoros ducit Vmus ,
Junclaque nymphis Gratiæ decentes
Alterno terram quatiunt pede.
Les perfonnes de bon air n’oublioient point de fêter
les mufes & les grâces dans leurs repas agréables.
On honorait les unes & les autres le verre à la main,
avec cette différence, que pour s’attirer la faveur
des mufes on buvoit neuf coups, au-lieu que ceux
qui vouloient fe concilier les grâces, n’en buvoient
que trois.
Enfin les anciens aimoient à marquer leur zele
pour-leurs dieux par divers monumens qu’ils éle-
voient à leur gloire, par d es tableaux,par des ftatues,
par des inferiptions, par des médailles. Or toute la
Grece étoit pleine de femblables monumens confacrés
aux grâces. On voyo it dans la plûpart des villes
leurs figures faites par les plus grands maîtres. Il
y avoit à Pergame un tableau de ces déeffes peint
par Pythagore de Paras, & un autre à Smyrne qui
étoit de la main d’Apelle; Socrate avoit taillé leur
ftatue en marbre, & Bupalus en or. Paufanias cite
plufieurs ouvrages de ce genre, également recom