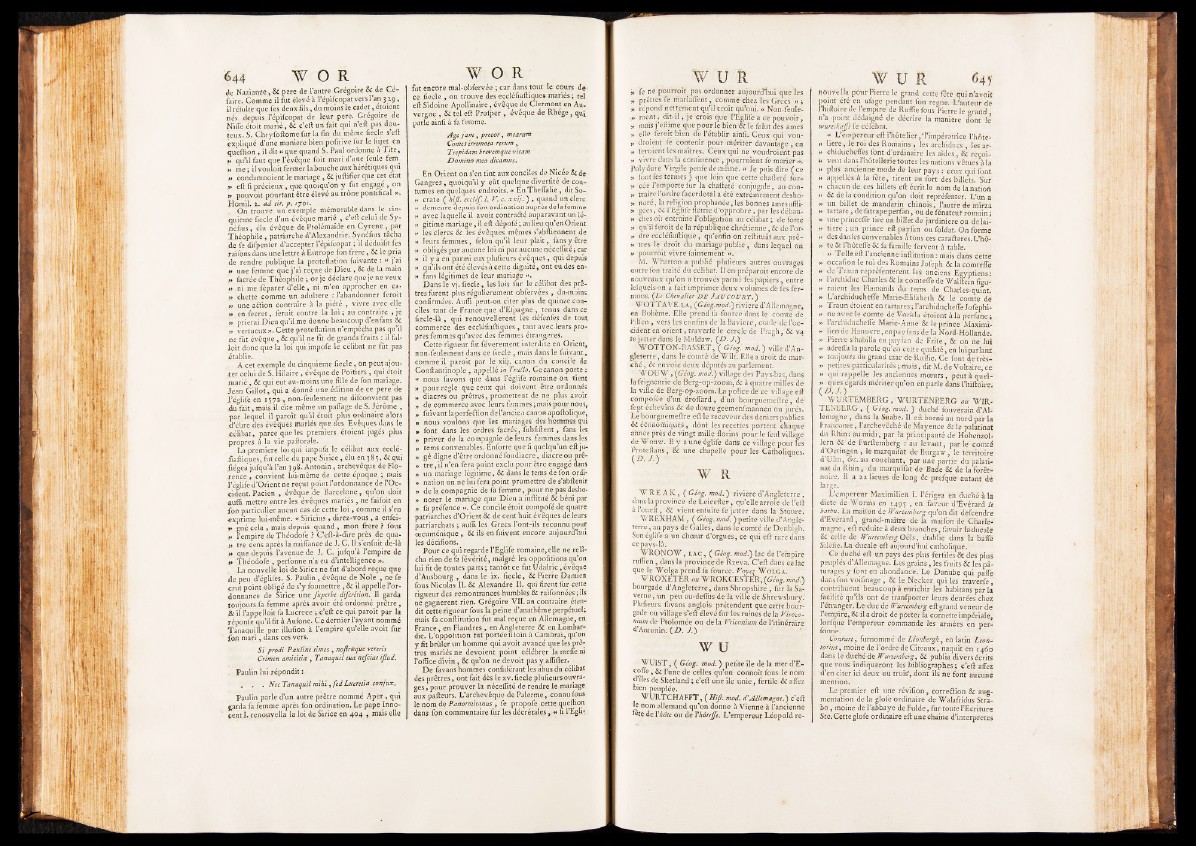
«Je Na2Îanze,& pere de l’autre Grégoire & de Cé-
faire. Comme il fut élevé à l’epifcopat vers l an 3>19 »
il résulte‘que fes deux fils, du moins le cadet, etoient
nés depuis, l’épifeopat de leur pere. Grégoire de
Nifle étoit marié, & c’eft un fait qui n’eft pas douteux.
S. Chryfoftome fur la fin du même fiecle s’eft
expliqué d’une maniéré bien pofitive fur le fujet en
queftion , il dit «que quand S. Paul ordonne à T ite,
w qu’il faut que l’évêque foit mari d’une feule fem
» me ; il vouloit fermer la bouche aux hérétiques cjui
» condamnoient le mariage , & juftifier que cet état
>» eft fi précieux, que quoiqu’on y fut engage , on
w pouvoit pourtant être élevé au trône pontifical ».
Homil. 1 . ad tit. p. rpou f .
On trouve un exemple mémorable dans^ le cinquième
fiecle d’un évêque marié , c’ eft celui de Sy-
néfius, élu évêque de Ptolémaïde en Cyrene , par
Théophile , patriarche d’Alexandrie. Synéfius tâcha
de fe difpenlèr d’accepter l’épifcopat ; il déduifit fes
raifons dans une lettre à Eutrope fon frere, & le pria
de rendre publique la proteuation fuivante : « j ai
» une femme que j ’ai reçue de Dieu , & de la main
» facrée dé Théophile ; or je déclare que je ne veux
» ni me féparer d’e lle , ni m’en approcher en ca-
» chette comme un adultéré : l’abandonner feroit
» une aûion contraire à la piete , viyre avec elle
» en fecret, feroit contre la lo i; au contraire , je
» prierai Dieu qu’il me donne beaucoup d’enfans &
» vertueux ». Cette proteftation n’empêcha pas qu’ il
ne fut évêque , & qu’il ne fit de grands fruits : il fal-
loit donc que la loi qui impofe le célibat ne fut pas
établie. , >
A cet exemple du cinquième fiecle, on peut ajouter
celui de S. Hilaire , évêque de Poitiers , qui étoit
.marié, & qui eut au-moins une fille de fon mariage.
Jean Gillot, qui a donné une édition de ce pere de
i ’églife en 1 5 7 2 , non-feulement ne difeonvient pas
.du fa it, mais il cite même un paffage de S. Jérôme ,
par lequel il paroît qu’il étoit plus ordinaire alors
d’élire des évêques mariés que des Evêques dans le
célibat, parce que lès premiers étoient jugés plus
propres à la vie paftorale.
La première loi qui impofa le célibat aux ecclé-
Jiaftiques, fut celle du pape Sirice, élu en 3 8 5, & qui
iiégea jufqu’ à l’an 398. Antonin, archevêque de Florence
, convient lui-même de cette epoque ; mais
l’églife d’Orient ne reçut point l’ordonnance de l’Occident.
Pacien , évêque de Barcelone, qu’on doit
auffi mettre entre les évêques mariés , ne faifoit en
fon particulier aucun cas de cette lo i , comme il s’eu
exprime lui-même. « Siricius , direz-vous , a enfei-
*» gné cela , mais depuis quand , mon frere ? fous
» l’empire de Théodofe ? C’eft-à-dire près de qua-
» tre cens après la naiffance de J. C. Il s’enfuit de-Ià
» que depuis l’avenue de J. C. jufqu’à l’empire de
Théodofe , perfonne n’a eu d’intelligence ».
La nouvelle loi de Sirice ne fut d’abord reçue que
de peu d’églifes. S. Paulin , évêque de Noie , ne fe
crut point obligé de s’y foumettre , &c il appelle l’ordonnance
de Sirice unt fuperbe diferétion. Il garda
toujours fa femme après avoir été ordonné prêtre,
& il l’appelloit fa Lucrèce ; c’eft ce qui paroît par la
réponfe qu’il fit à Aufone. Ce dernier l’ayant nommé
Tanaquille par illufion à l’empire qu’elle avoit fur
fou mari, dans ces vers.
S i prodi Pauline times , noflrceque vereris
Çrimen amidtice , Tanaquil tua nefeiat iftud.
1 Paulin lui répondit :
, . . Nec Tanaquil mihi, fed Lucretia conjux.
Paulin parle d’un autre prêtre nommé A p e r , qui
garda fa femme après fon ordination. Le pape Innocent
I. renouvella la loi de Sirice en 404 , mais elle
fut encore mal-obfervée ; car dans tout le cours de
ce fiecle , on trouve des eccléfiaftiques mariés ; tel
eft Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont en Auvergne
, & tel eft Profper , évêque de Rhége, qui
parle ainû à fa femme.
Age jam , precor, meartini
Cornes irremota rerurn,
Trep idam brevem que vitam
Domino mto dicamus.
En Orient on s’en tint aux conciles de Nicée & de
Gangres, quoiqu’il y eût quelque diverfité de coutumes
en quelques endroits. « En Theffalie, dit So-
» crate ( hiß. eccléf. I. V. c .x x ij. ) , quand un clerc
» demeure depuis fon ordination auprès de la femme
» avec laquelle il avoit contraâé auparavant un lé-
» gitime mariage, il eft dépofé; aulieu qu’enOrient
» les clercs & les évêques mêmes s’abftiennent de
» leurs femmes, félon qu’ il leur plait, fans y être
» obligés par aucune loi ni par aucune néceffité ; car
» il y a eu parmi eux plufieurs évêques, qui depuis
» qu’ils ont été élevés à cette dignité, ont eu des en-
» fans légitimes de leur mariage ».
Dans le vj. fiecle, les lois fur le célibat des prêtres
furent plus régulièrement obfervées , du-moins
confirmées. Aufli peut-on citer plus de quinze conciles
tant de France que d’Efpagne , tenus dans ce
fiecle-là , qui renouvellerent les défenfes de tout
commerce des eccléfiaftiques , tant avec leurs propres
femmes qu’avec des femmes étrangères.
Cette rigueur fut féverement interdite en Orient,
non-feulement dans ce fiecle , mais dans le fuivant.,
comme il paroît par le xiij. canon du concile de
Conftantinople , appellé in Trullo. Ce canon porte :
« nous favons que dans l’églife romaine on tient
» pour regle que ceux qui doivent être ordonnés
» diacres ou prêtres, promettent de ne plus avoir
„ de commerce avec leurs femmes ; mais pour nous,
„ fuivant la perfection del’ ancien canon apoftolique,
m nous voulons que les mariages des hommes qui
„ font dans les ordres facrés, fubfiftent, fans les
„ priver de la compagnie de leurs femmes dans les
» tems convenables. Enforte que fi quelqu’un eft ju-
» gé digne d’être ordonné foudiacre, diacre ou prê-
» tre , il n’en fera point exclu pour être engagé dans
» un mariage légitime, & dans le tems de fon ordi-
» nation on ne lui fera point promettre de s’abftenir
» de la compagnie de fa femme, pour ne pas desho-
» norer le mariage que Dieu a inftitué & béni par
» fa préfence ». Ce concile étoit compofé de quatre
patriarches d’Orient & de cent huit évêques de leurs
patriarchats ; aufli les Grecs l’ont-ils reconnu pour
oecuménique , & ils en fuivent encore aujourd’hui
les décifions.
Pour ce qui regarde l’Eglife romaine, elle ne relâcha
rien de fa févérité, malgré les oppofitions qu’on
lui fit de toutes parts ; tantôt ce futUdalric, évêque
d’Ausbourg , dans le ix. fiecle, & Pierre Damien
fous Nicolas II. & Alexandre II. qui firent fur cette
rigueur des remontrances humbles & raifonnées ; ils
ne gagnèrent rien. Grégoire VII. au contraire étendit
cette rigueur fous la peine d’anathême perpétuel;
mais fa conftitution fut mal reçue en Allemagne, en
France, en Flandres , en Angleterre & en Lombardie.
L’oppofition fut portée fi loin à Cambrai, qu’on
y fit brûler un homme qui avoit avancé que les prêtres
mariés ne dévoient point célébrer la meffe m
l’office divin, & qu’on ne devoit pas y aflifter.
De favans hommes confidérant les abus du célibat
des prêtres, ont fait dès le xv. fiecle plufieurs ouvrages
, pour prouver la néceffité de rendre le mariage
aux pafteurs. L’archevêque dePalerme, connu fous
le nom de Panormitanus , fe propofe cette queftion
dans fon commentaire fur les décrétales, « fi l’Egli-
>> fe ne pourroit pas ordonner aujourd’hui que les
.» prêtres fe mariaflent, comme chez 'les Grecs » ;
» répond nettement qu’il croit qu’oui. « Non-feule-
» ment, d it-il, je crois que l’Eglife a ce pouvoir,
» mais j’eftime que pour le bien & le feint des âmes
» elle feroit bien de l’établir ainfi. Ceux qui vou-
» droiént fe contenir pour mériter davantage , en
» feroient les maîtres. C èn xq u in e voudroièïit pas
» vivre dans la continence , pourroient fe marier ».
Polydore Virgile penfe de même. « Je puis dire ( ce
v font fes termes ) que loin que cette chafteté for-
•» cce l’emporte fur la chafteté conjugale, au Con-
» traire l’ordre facerdotal a été extrêmement desho’r
» noré, la religion prophanée,les bonnes amesaflli-
» gées, &c l’Eglife flétrie d’opprobre, par les débau-
» ches où entraine l’obligation au célibat ; de forte
» qu’il feroit de la république chrétienne, & de l’or-
» dre eecléfiaftique , qu’enfin on reftituât aux prê-
» très le droit du mariage' public , dans lequel On
» pourroit vivre faintement ».
M. Wharton a publié plufieurs autres ouvrages
outre fon traité du célibat. Il en préparoit encore dè
nouveaux qu’on a trouvés parmi fes papiers, entre
lefquels on a fait imprimer deux volumes dè fes fermons.
(£« Chevalier DE J AV c o u r t .')
WOTTAV E.la, (Géog.mod.) riviered’Allemagne,
en Bohème. Elle prend fa fource dans le comté de
Pilfen , vers les confins de la Bavière, coule del’oc-
cidèhtêh orient, traverfe le cercle de Pragh, & va
fe jetter dans le Mu Ida w. (Z). J .)
VO T TO N -B A S S E T , ( Géog. mod.) ville d’Angleterre
, dans le comté de Wilt. Elle a droit de marché
, & envoie deux députés au parlement.
'\VO U V , (Géog. mod.) village des Pays-bas., dans
la feigneurie de Berg-op-zopm, 6c à quatre milles’de
la ville de Berg-op-zoom. La police de ce village éft
compofée d’un droflard, d’un bourguemeftre, de
fept échevins & de douze geernenfmannen bu jurés.
Le bourguemeftre eft le receveur des deniers publics
& économiques, dont les recettes portent chaque
année près de vingt mille florins pour le feul village
de Wouv. il y a une églife dans ce village pour les
Proteftans, & une chapelle pour les Catholiques.
m m * H
W R
V/ R E A K , ( Géog. mod. ) riviere d’Angleterre ,
dans la province de Leicefter, qu’elle arrofe de l’ eft
à i ’oueft, & vient enfuite fe jetter dans lâ^Stoure.
WREXHAM , ( Géog. mod. ) petite ville «^Angleterre
, au pays de G alles, dans le comté de Denbioh.
Son églife a un choeur d’orgues, ce qui eft rare dans
ce pays-là.
VVRONOW, LAC, ( Géog. mod.) lac de l’empire
niflien , dans la province de Rzeva. C’eft dans ce lac
que le ’Wolga prend fa foürce. Voye{ \Volga.
V /ROXETER ou W O K C E S T E R , (Géog. mod.)
bourgade d’Angleterre, dans Shropshire , fur laSa-
vernè, un peu aii-deflus de la v ille dè Shrewsbury.'
Plufieurs favans anglois prétendent que cette bourgade
ou village s’eft élevé fur les ruines de la Viroco-
nium de Ptolomée ou de la Vriconium de l’itinéraire
d’Antonin. (Z). J . )
W U
■ WUIST,{ Géog. mod. ) petite île de la mer d’E -
coflè , & l’une de celles qu?on connoît fous le nom
d des de Sketland ; c’eft une île unie, fertile & afîez
bien peuplée.
VFURTCHAFFT, (Hijl. mod. d'Allemagne.) c’eft
le nom allemand qu’on donne à Vienne à l’ancienne
fete de Y hôte ou de YhôteJJe, L ’empereur Léopold renative
Ha pour Pierre le grand cette f8te qui n’dvoit
point été en ufage pendant fon régné. L’auteur de
l’hiftoire de l’empire de Ruffie fous Pierre le grand
n’a point dédaigné de décrire la maniéré dont le
wurtchajf't fe célébra.
« L’empereur eft l’hôtelier,‘ l’impératricè l’hôte*
» lie re , le roi des Romains , les archiducs , les ar-^
» chiduchéffes font d’ordinaire les aides, & reçoi-
v> vent dans l’hôtellerie toutes les nations vêtues à la
» plus ancienne mode de leur pays : ceux qui font
» appel lés à la fête, tirent au fort des billets. Süf
» chacun de ces billets eft écrit le nom de lanatioft
» &c de la condition qu’on doit repréfenter. L’un a
» un billet de mandarin chinois, l’autre de mirzà
» tartare, de fatrape perfan, ou de fénateuf romain £
» une princefte tire ùn billet de jardinière ou de lai-
» tiere ; un prince eft payfan ou foldat. On forme
» des danfes convenables a tous ces carafteres. L’hô-
» te & l’hôtéfié & fa famille fervent à table.
» Telle eft l ancienne inftitution: mais dans Cette
» occafion le roi des Romains Jofeph & la comteffe
» de Traun repréfenterent les anciens Egyptiens:
» l’archiduc Gharles & la comteffe de Walftein figu-
» roient les Flamands du tems de Gharles-quint.
» L’archiducheffe Marie-EIifabeth & le comte de
» Traun étoient en tarrares ; l’archiducheffe Jofephi*
» ne avec le comte de Vôrkla étoient à la perfane;
» l’arehiducheffe Marie-Anne & le prince Maximi-
» lien de Hanovre,en payfans'de la Nord-Hollande.
» Pierre s?habilla en payfan de Frife, & on ne lui
» adrefla là parole qu’en cette qualité, en luiparlant
» tou jours du grand czar de Ruffie. Ce font detrès-
» petites particularités ;-mais, dit M. de Voltaire, ce
» qui rappelle les anciennes moeurs, p eutàquel-
» ques égards mériter qu’on en parle dans Thiftoire. WÊm 1
W U R T EM B E R G , W URT ENBERG où WIR-
TEN B ERG ( Géog. mod. ) duché fouverain d’Allemagne,
dans la Suabe. Il eft borné au nord par la
Franconie, 1-archevêché de Mayence & le palatinat
du Rhin: au-midi, par la principauté de Hohenzol-
1-ern & de Furftembetg : au levant, par lé comté
d’Oetingen , lé marquifat de Burgaw , le territoire
d ’U lm, &c. au couchant, par une partie du palatinat
du Rhin , du marquifat de Bade & de la forêt*
noire. Il a n lieues de long & prefque autant dé
large.
L ’empereur Maximilien I. l’érigea eh duché à la
diete de Worms en 1495 ? en faveur d’Evérard le
barbu. La maii'on de Wurtemberg qu’on dit deiFcendre
d’E vérard, grand-maître de la maifon de Charlemagne,
eft réduite à deux branches, favoir la ducale
& celle de Wurtemberg Oëls, établie dans la baffe
Silélie. La ducale eft aujourd’hui catholique.
Ce duché eft un pays des plus fertiles & des plus
peuplés d’Allemagne. Les grains, les fruits & les pâturages
y font en abondance. Le Danube qui paffç-
dansfon voifinage j & le Necker qui les traverfe’
contribuent beaucoup à enrichir les habitans par la
facilité qu’ils ont de tranfporter leurs denrées chez
l’etranger. Le duc de Wurtemberg eft grand veneur de
l’empire, & il a droit de porter là cornette impériale,
lorfque l’empereur commande les armées en perfonne.
Conrart, furnommé de Léoribergh, en latin Leon-
toriüs, moine de l ’ordre de Cîteaux, naquit en 1460
dans le duché de Wurtemberg, & publia divers écrits
que vous indiqueront les bibliographes ; c’ eft affez
d’en citer ici deux ou trbisydont ils ne font aucune
mention.
Le premier eft une révifion, correâion & augmentation
de la glofe ordinaire de Walafridus Stra-
b o , moine de l ’abbaye de Fulde, fur toute l’Ecriture
Ste. Cette glofe ordinaire eft une chaine d’interpretes