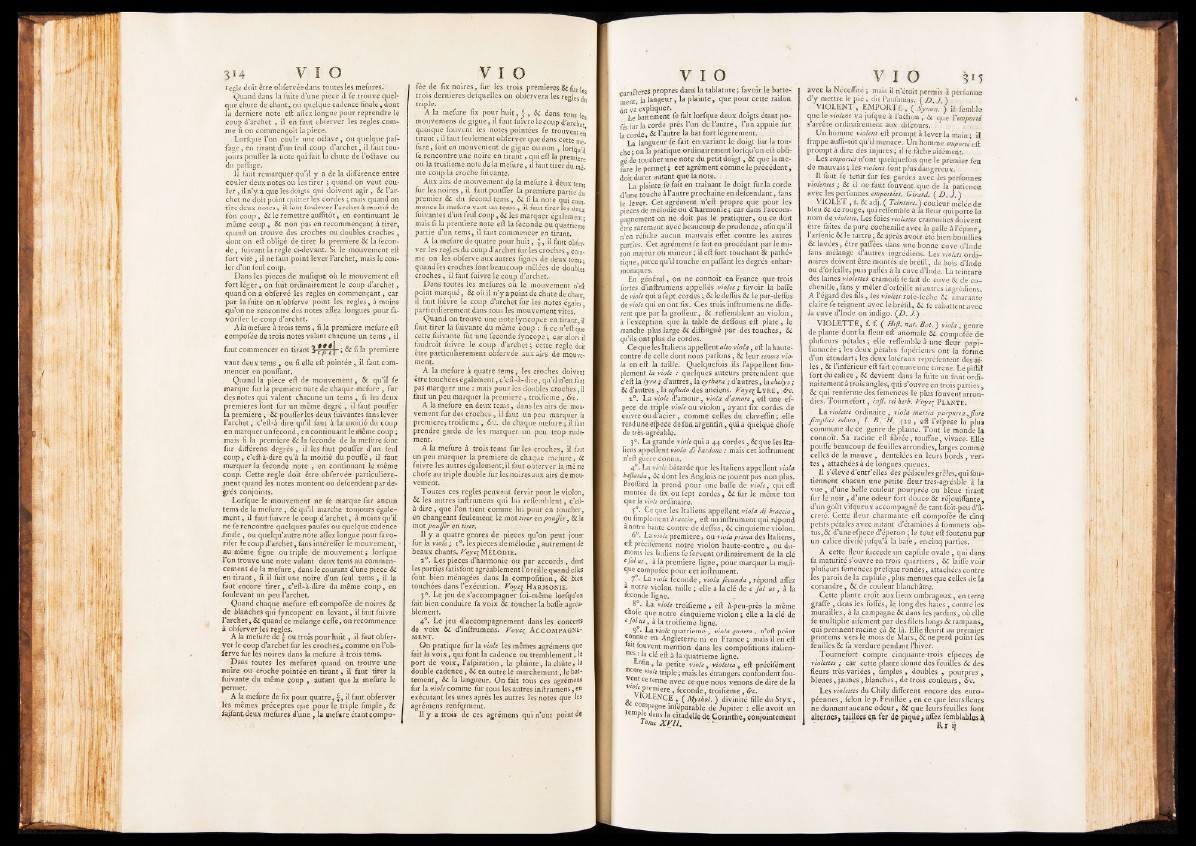
réglé doit être obfervée dans toutes les mêlures* '
Quand dans la fuite d’une piece il fe trouve quelque
chute de chant, ou quelque cadence finale, dont
la derniere note eft allez longue pour reprendre le
coup d’archet , il en faut oblerver les réglés comme
li on commençoit la piece;
: Lorfque l’on coule une oélave, ou quelque paf-
fa g e , en tirant d’un feul coup d’archet, il faut toujours
pouffer la note qui fait la chute de l’o&ave ou
du paffage.
il faut remarquer qu’il y a de la différence entre
couler deux notes ou les tirer ; quand on veut couler
, il n’y. a que les doigts qui doivent a g ir , 6c l’archet
ne doit point quitter les cordes ; mais quand on
l ir e deux notes, il faut foulever l’archet à moitié de
l'on coup, & le remettre auffitôt, en continuant le
meme coup., 6c non pas en recommençant à tirer,
quand on trouve des croches ou doubles croches ,
dont on eft obligé de tirer la première 6c la fécond
é , fuivant la réglé ci-devant. Si le mouvement eft
fort v ite , il ne faut , point lever l’archet, mais le couler
d’un feul coup.
Dans les pièces de mufiqué. oii le mouvement eft
fort lég e r, on fuit ordinairement le coup d’arehet,
quand on à obfervé les réglés en commençant, car
par la fuite on n’obferve' point les réglés, à moins
qu’on ne rencontre des notes; affez longues pour fa-
vorifer le coup d’archet.
A la mefure à trois tems, fi la première mefure eft
compofée de trois notes valant chacune un tems , il
faut commencer en tirant & fi la première
vaut deux tems , ou fi elle eft pointée , .il faut commencer
en pouffant.
Quand la piece eft de mouvemént, & qu’il fe
marque fur la première note de chaque mefure , fur
des notes qui valent chacune un tems , fi les deux
premières font fur un même degré , il faut pouffer
la première, 6c pouffer les deux fuivantes fans lever
l’archet, c’eft-à dire qu’il faut à la moitié du coup
en marquer un fécond, en continuant le riïême coup ;
mais fi la première & la fécondé de la mefure font
fur ditférens- degrés , il les faut pouffer d’un feul
coup, c’eft-à-dire qu’à la moitié du pouffé, il faut
marquer la fécondé note , en continuant le même
coup. Cette réglé doit être obfervée particulièrement
quand les notes montent ou defcendent par degrés
conjoints.
Lorfque le mouvement ne fe marque fur aucun
tems de la mefure , 6c qu’il marche toujours également
, il faut fuivre le coup d’archet, à moins qu’il
ne fe rencontre quelques paufes ou quelque cadence
finale , ou quelqu’autre note affez longue pour favo-
rifer le coup d’archet, fans intéreffer le mouvement, •
au même figne ou triple de mouvement ; lorfque
l’on trouve une note valant deux tems au commencement
de la mefure, dans le courant d’une piece &
en tirant , fi il fuit une noire d’un feul tems , il la
faut encore tire r , c’eft-à-dire du même coup, en
foulevant un peu l’archet.
Quand chaque mefure eft compôfée de noires 6c
de blanches qui fyncopent en levant, il faut fuivre
l’archet, & quand ce mélange ceffe, on recommence
à obferver les réglés.
A la mefure de $ ou trois pour h u it, il faut obferver
le coup d’archet fur les croches, comme oïi l’ob-
ferve fur les noires dans la mefure à trois tems.
Dans toutes les mefures quand on trouve une
noire ou: croche pointée en tirant, il faut tirer la
fuivante du même coup , autant que la mefure le
permet.
A la meûire de fix pour quatre, f , il faut obferver
les mêmes préceptes que pour le triple fimple, &
fanant,deux mefures d’une , la mefure étant compofée
de fix noires, fur les trois premières & filr je
trois dernieres defquelles on obfervera les réglés di
triple. . u
À la mefure fix pour huit, §■ , & dans tous les
mouvemens de gigue, il faut fuivre le coup d’archet
quoique fouvent les notes pointées fe trouvent en
tirant ; il faut feulement obferver que dans cette me.
fure, foit en mouvement de gigue ou non , lorfqu’jj
fe rencontre une noire en tirant, qui eft la première
.ou la troifieme note de la mefure, il ’faut tirer du mê.
me coup la croche fuivante.
Aux airs de mouvement de la mefure à deux tems
fur les noires , il faut pouffer la première partie du
premier 6c du fécond tems, & fi la note qui com.
mence la mefure vaut un tems , il faut tirer les deux
fuivantes d’un feul coup, 6c les marquer également-
mais fi la première note eft la fécondé ou quatrième
partie d’un tems, il faut commencer en tirant.
A la mefure de quatre pour huit, f , il faut obfer.
ver les réglés du coup d’archet fur les croches, com-
me on les obferve aux autres lignes de deux tems •
quand les croches font beaucoup mêlées de doubles
croches, il faut fuivre le coup d’archet.
Dans toutes les mefures où le mouvement n’eft
point marqué, 6c oii il n’y a point de chute de chant
il faut fuivre le »coup d’archet fur les notes égales
particulièrement dans tous les mouvement vîtes.
Quand on trouve une note fyncopée en tirant il
faut tirer la fuivante du même coup : fi ce n’eft que
cette fuivante fut une fécondé fyncope ; car alors il
faudroit fuivre le coup d’archet ; cette réglé doit
être particulièrement obfervée aux airs de mouvement.
A la mefure à quatre tems, les croches doivent
être touchées également, c’eft-à-dire, qu’il n’en faut
pas marquer une : mais pour les doubles croches, il
faut un peu marquer la première , troifieme , 6-c.
A la mefure en deux tems, dans les airs de mouvement
fur des croches , il faut un peu marquer la
première, troifieme , &c. de chaque mefure ; il faut
prendre garde de les marquer un p eu . trop rudement.
A la mefure à trois tems fur les croches, il faut
un peu marquer la première de chaque mefure, &
fuivre les autres également; il faut obferver la même
chofe au triple double fur les boires aux airs de mouvement.
Toutes ces réglés peuvent fervir pour le violon,1
6 c les autres inftrumens qui lui reffemblent, c’eft-
à-dire , que l’on tient comme lui pour en toucher,
.en changeant feulement le mot tirer en pouffer, &le
mot pouffer en tirer.
Il y a quatre genres de pièce s qu’on peut jouer
fu r la v iole ; i° . les pièce s de m é lo d ie , autrement de
be au x chants. Voye{M é l o d ie .
2 ° . Les pièces d’harmonie ou par accords, dont
les parties fatisfont agréablement l’oreille quand elles
font bien ménagées dans la compofition, & bien
touchées dans l’exécution. Foyer H a r m o n ie , ;
3 °. Le jeu de s’accompagner foi-même lorfqu’on
fait bien conduire fa voix 6 c toucher la baffe,agréablement.
4°. Le jeu d’accompagnement dans les concerts
dé voix 6 c d’inftrumens. Voyeç A c c o m p a g n e m
e n t .
On pratique fur la viole les mêmes agrémens que
fait la v o ix , qui font la cadence ou tremblement, le
port de v o ix , l’afpiration, la plainte, la chute, la
double cadence, 6 c en outre le marchement, le battement,
6 c la langueur. On fait tous ces agrémens
fur la viole comme fur tous les autres inftrumens, en
exécutant les unes après les autres les notes que les
agrémens renferment.
Il y a trois de ces agrémens qui n’ont point d$
çara&eres propres danS la tablature; favoir le batte-.'
ment la langeur, la plainte, que pour cette raifon
on va expliquer. f
Le battement fe fait lorfque deux doigts étant po-,
la corde près l’un de L’autre, l’un appuie lur
la corde, ÔC l’autre la bat fort;légerement._.
La langueur fe fait en variant le doigt fur. la touche
oh la pratique ordinairement lorfqu’on eft oblL
gé de toucher une note du petit d o ig t, 6c que la mefure
le permet ; cet agrément comme le précédent,
doit durer autant que la note.
La plainte fe.fait en traînant le doigt fur.la corde
d ’une touche à l’autre prochaine en.defcendant, fans,
le lever. Cet agrément h’eft propre que pour les
pièces de mélodie ou d’harmonie ;, car dans l’accompagnement
on ne doit pas le pratiquer, ou ce doit
être rarement avec beaucoup de prudence; afin qu’il
n’en réfulte aucun mauvais effet contre les autres
parties.: Cet agrément fe fait en procédant par le mi-
ton majeur oti mineur ; il eft fort touchant & pathétique,
parce qu’il toucheen paffant les degrés enharmoniques.
En général, on ne connoît en France que trois
fortes d’inftrumens appellés violes ; favoir la baffe
de viole qui a fept cordes ;.& le deffus 6c le par-deffus
de viole qui en ont fix. Ces trois inftrumens ne different
que par la groffeur, 6c reffemblent au violon,
à l’exception que la table de deffous eft plate!, le
manche plus large 6c diftingué par des touches, 6c
qu’ils ont plus de cordes.
Ce que les Italiens appellent alto viola, eft la haute-
contre de celle dont nous parlons., 6c leur tenore vior
la en eft la.taille. Quelquefois,ils l’appellent Amplement
la viole : quelques auteurs prétendent que
c’eft la lyra ; d’autres, la cythara,‘.d’autres., la chelys;
êtd’autres , \ztefludo des anciens. Voye{ Ly r e , & c.
2°. La viole d’amour, viola d,amore , eft une eï-
pece! de. triple viole ou violon, ayant fix cordes de
cuivre oïld’a c ie r, comme celles, du clavefiin; .elle
rend une efpece de fon argentin, quia quelque chofe
de trèsragréable.
3°. La grande viole qui a 44 cordes, & qu e les Italiens.
appellent, viola di bardone : mais cet inftrument
n’eft guereeônnu.
40. La viole, bâtarde que les Italiens appellent viola
baflarda, 6c dont les Anglois ne jouent pas non plus.
Broffard la prend pour une baffe de viole, qui eft
montée de fix. ou fept cordes, 6c fur le même ton
que la viole ordinaire. -
50. Ce que les Italiens appellent viola di braccio,
Ou Amplement bràccio, eft un inftrument qui répond
ànotre haute contre de deffus, 6c cinquième violon.
6 . La viole, première, on viola prima d e s! ta liens,
eft precifément notre violon haute-contre, ou du-
moins les Italiens fe fervent ordinairement de la clé
<jo lui, à là première ligne, pour marquer la mufique
compofée pour cet inftrument.
7 ■ La viole fécondé, viola feçunda , répond affez
* notre, violon taille ; elle a la clé de c fo l u t, à la
fécondé ligne.
0°. La viole troifieme, eft à-peu-près la même
chofe quç notre cinquième violon ; elle a la clé de
c fol ut , à la troifieme ligne. .
9 - • La viole quatrième , viola quarta, n’eft point
connue en Angleterre ni en France ; mais il en eft
ait fouvent mention dans les compofitions italien-
nep’ £lê eft à la,quatrième ligne.
nfin, la petite viole, violetta, eft précifément
°tre viole triple ; mais les étrangers confondent fou-
ent ce terme avec ce que nous venons de dire de la
m*ere > ^econcle » troifieme , &c.
LENCE , ( Mythol. ) divinité fille du S t y x ,
t COmPagne inséparable de Jupiter : elle avoit un
mp e dans^a citadelle de Corinthe, conjointement
avec la Neceflltc ; mais il n’ito it permis à pérfonne
d’y mettre le p ié , dit Paufaniasv ( D . J , )
V IO L EN T , EMPORTÉ-, (s'ynon..') il..femble
quelle violent va jufque à .l’action,.,& que l’emporté
s’arrête ordinairement aux difçours., . . ;
Un homme violent ^eft prompt à lever la ihain ; il
frappe aulîi-tôt qu’il menace. Unhomme emponleft
prompt à dire des injures ; il fe fâche aifément........
Les emportés n’ont quelquefois que le prèmier feu
de mauvais -, Xts violens.font plus dangereux.'^ .
Il faut fe tenir fur fes gardes avec les perfonnes
violentes ; 6c il ne faut fouvent-que de la patience
avec les perfonnes emportées. Girard. ( D . J , )
VIOLET , f. & adj. ( Teinture. ) couleur mêlée de
bleu 6c de rouge; qui reffemble à la fleur quiporte le
nom de violette. Les foies.violettes cramoifies doivent
être faites de pure cochenille avec la galle à l’épine ,
l’arfenic 6c le. tartre ; & après avoir été bien bouillies
& lavées, être paffées dans une bonne cuve d’Inde
fans mélange. d’autres ingrédiens. Les violets ordi-
naires doivent être montés de bréfil, dë bois d’Indé
ou" d’qrfeille, puis paffés à la cuve d’Inde. La teinture
des laines violettes cramoifi fe fait' de cuve & de cochenille
, fans y mêler d’orfeillè ni autres ingrédiens*.
A l’égard des hls , les violets rofe-feche 6c amarante
claire fe teignent avec lebré lil, & fe rabattent avec
la cuve d’Inde on indigo. (D . / .) .
V IO L E T T E , f. f. ( Hiß, nat. B o t.') viola y genre
de plante dont la fleur eft anomale 6c compôfée de
plufieurs pétales ; elle reffemble à une fleur papi-
lionacée ; les deux pétales fupérieurs ont la forme
d’un étendart; les deux latéraux repréfentent des ai*
le s , & l’inférieur eftfait comme une caréné. Lepifti!
fort du calice , & devient dans la fuite un fruit ordinairement
à trois angles;'qui s’ouvre en trois parties ,
6c qui renferme des femences le plus fouvent arrondies.
Tournefbrt, inß. rei herb. Voye1 PLANTE.
Là violette ordinaire , viola martia purpurea,flore
fimplici odoro, I. R . H. 4 2 a ,‘ eft l’efpèce la plus
commune de ce genre de plante. Tout le monde la
connoît. Sa racine eft fibrée , touffue, vivace. Elle
pouffe beaucoup de feuilles arrondies, larges comme
celles de la mauve, dentelées en leurs bords, Vertes
, attachées à de longues queues.
Il s’élève d’entr’elles dés pédicules grêles, qui fou-
tiennent chacun une petite fleur très-agréable à; la
vue , d’une belle couleur pourprée ou bleue- tirant
fur le noir , d’une odeur fort douce 6c réjouiffante,
d’un goût vifqueux accompagné dè tant-foit-peu d’â-
creté. Cette fleur charmante eft compoféë de cinq
petits pétales avec autant d’étamines à fommets obtus,
& d’une efpece d’éperon ; le tout eft foutenu par
un calice divifé jufqu’à la bafe, en cinq parties.
A cette fleur fuccede un capfule o vale , qui dans
fa maturité s’ouvre en trois quartiers , 6c laiffe voir
plufieurs femences prefque rondes, attachées contre
les parois de la capfule, plus menues que celles de la
coriandre, & de couleur blanchâtre.
Cette plante croît aux lieux ombrageux, en terre
graffe , dans les foffés, le, long des haies , contre les
murailles, à la campagne & dans les jardins, où elle
fe multiplie aifément par des filets longs & rampans,
qui prennent racine çà 6c là. Elle fleurit au premier
printems vers le mois de Mars, 6c ne perd point fes
feuilles 6c fa verdure pendant l’hiver.
Tournefort compte cinquante-trois efpeces de
- violettes ; car cette plante donne des feuilles 6c des
fleurs très-variées, fimples , doubles , pourpres ,
bleues, jaunes, blanches, de trois couleurs, &c.
Les violettes du Chily different encore des européennes
, félon le p. Feuillée , en ce que leurs fleurs
ne donnent aucune odeur, 6c que leurs feuilles font
alternes, taillées en fer de pique> affez femblablçs à
R r ij