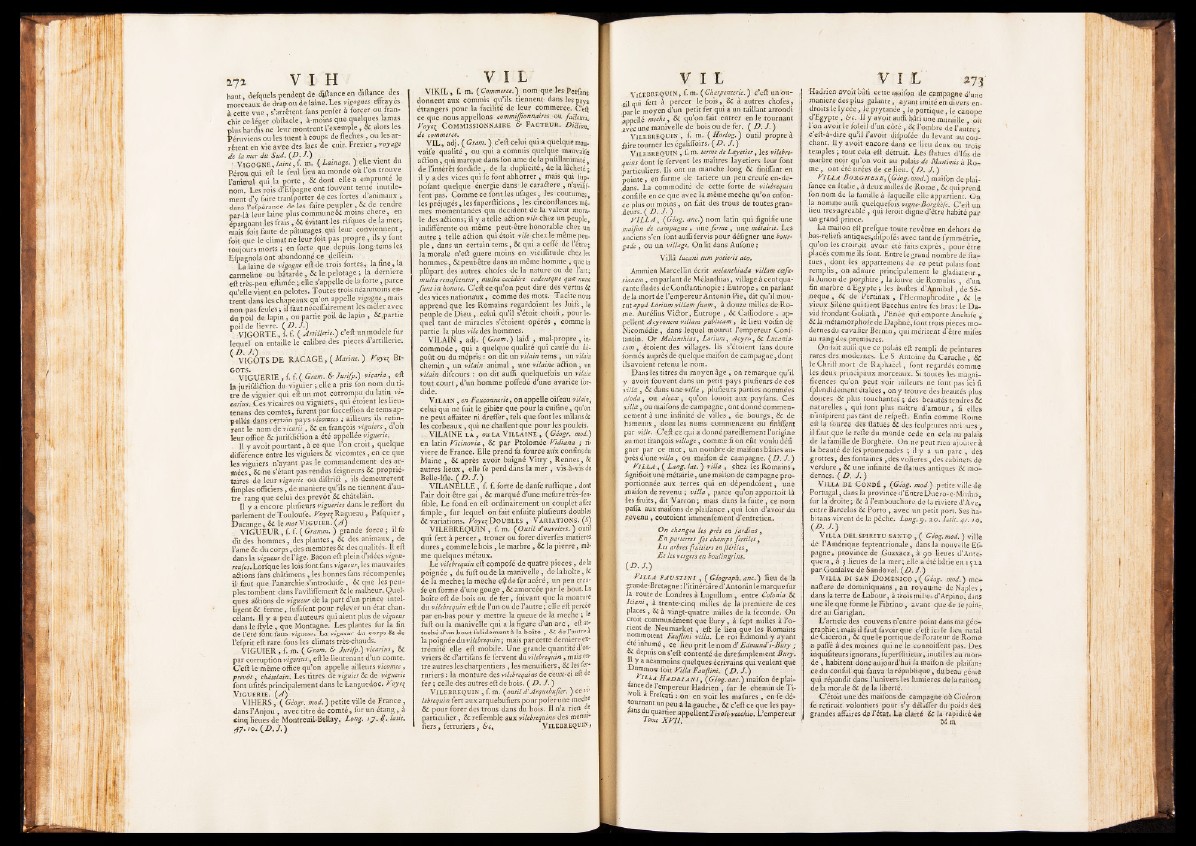
173 V I H
haut, defquels pendentde djftance en diftance des
morceaux de drap ou de laine. Les vigognes eftray es
à cette vue , s’arrêtent fans penfer à for.çer ou franchir.
ce léger obftacle, à-moins que quelques, lamas
pffis hardis ne leur montrent l’exemple, oc, alors les
Péruviens ou les tuent à coups de fléchés , ou les arrêtent
en Vie avee des lacs de cuir. Frezier, voyage
de la mer du Sud. (Z ? ./ .) • ' ■■ ,
’ V ig o g n e , laine, f. m, {Lainage. ) elle vient du
Pérou qui- eft le feul lieu au monde oii l’on trouve
l’animal qui la porte, & dont elle a emprunte le
nom. Les rois d’Efpagne.ont fouvent tente inutilement
d’y faire transporter de ces fortes d animaux ,
dans l’efpérance de les faire peupler, 6c de rendre
par-là leur laine plus commune & moins chere, en
épargnant des fra is, & évitant les rifques de la mer;
mais foit faute de pâturage.s. qui leur conviennent,
folï que le climat ne leur fpit pas propre, ils y font
toujours morts ; en forte que, depuis , long-tems les
Efpaenols ont abandonhécedeffem.
La laine de vigogne eft de -trpis fortes,; la fine, la
carmeline pu bâtarde, & le pelotage ; la derniere
eft très-peu eftimée ; elle s’appelle de la,forte, parce
qu’elle vient en pelotes. Toutes trois néanmoins entrent
dans lès-chapeaux, qu’on appelle vigogne , mais
non pas feules ; il faut néceffairement les meler avec
du poil d e lapin , ou partie poil de lap in , &,partie
poil de lievre. { D . J . ) . . j i V
' V IG G R T E , f. f. ( Artillerie.) c’eft; unmodele lur
lequel' on entaille le calibre dès pièces d’artillerie.
^ ^ IG O T S D E R A C A G E , ( Marine. ) Voyei Bi g
o t s . • . . . -
V IGU ER IE , f. f. {.Gram. & Jurifp.) vicana, eft
b jurifdiftion du viguier ; elle a pris fon nom du titre
de viguier qui eft un mot corrompu du latin vi~
carius. .Ces vicaires ou viguiçrs, qui etoient les lieu-
tenans des comtes, furent par fucceffiôn de tems ap-
pellés dans certain pays vicomtes ; ailleurs ils retinrent
le nom de vicarii, & en françôis viguier s , d oïl
leur office & jurifdi&ion a été appellée viguerie.
■ Il y avoit pourtant, à ce que l’on c ro it, quelque
différence entre les viguiers & vicomtes, en ce que
les viguiers n’ayant pas le commandement des armées,
& ne s’ étant pas,rendus feigneurs & . propriétaires
de leur viguerie ou diftriét , ils demeurèrent
fimples officiers, de maniéré qu’ils ne tiennent d’autre
rang que celui des; prévôt ,& châtelain.
Il y a encore plufieurs vigueries dans le reffort du
parlement de Touloufe. Voyc{ Ragueau, Pafquier,
Ducange*.& le mot V jg v i e r . {A )
V IG U EU R , f. f. ( Gramm. ) grande force ; il fe
dit des hommes, des plantes, & des animaux , de
l’ame & du corps ,des membres & des qualités. Il eft
dans la vigueur de l’ âge. Bacon eft plein d’idées vigou-
reufes. Lorfque les loisfontfans vigueur, les mauvaifes,
aâions fans châtimens., les bonnes fans recompenfe;
il' faut que l’anàrchie.s’introduife, & que les peuples
tombent dans l’aviliffemerit & le malheur. Quelques
défions de vigueur dë la part d’un prince intelligent
& ferme ,:fuffifent pour relever un état chancelant.
Il y a peu d’auteurs qui aient plus de vigueur
dans le fty le , que Montagne. Les plantes fur la fin
de l’été font fans vigueur. La vigueur du corps & de
Fefprit eft rare fous les climats très-chauds.
VIGU IE R , f. m. ( Gram. & Jurifp.) vicarius, &
par corruption vigerius-, eft le lieutenant d’un comte.
C ’eft le-même office qu’on appelle ailleurs vicomte,
prévôt, châtelain. Les titres de viguier & de viguerie
font ufités principalement dans le Languedoc. Poyc{
V ig u e r i e . {A )
V IH E R S , ( Geogr. mod. ) petite ville de France,
dans l’Anjou , avec titre de comté, fur un étang, à
cinq lieues de Montreuil-Bellay, Long. 1 7 . 8 . latit,
4 7 .10 . { D . J . )
V I L
V IK I L , f. m. {Commerce. ) nom que les Perfans
donnent aux commis qu’ils tiennent- dans les pays,
étrangers pour la facilite de leur commerce. C’eft
ce que nous appelions commifjionnaires 'Ou facteurs
Voyei C o m m i s s io n n a ir e & Fa c t e u r . Diction.
de commerce,
V I L , adj. ( Gram.') c’eft celui q uia quelque mau-
vaife qualité , ou qui a commis quelque mauvaife
aftion, qui marque dans fon ame de la pufillanimité,
de l’intérêt fordide , de la duplicité, de la lâcheté ;,
il y a des vices qui fe font abhorrer , mais qui fup,
pofant quelque énergie dans- le cara&ere , n’avilif.
fent pas. Comme ce font les ufages, les ■ coutumes,
les préjugés., les fuperftitions ; les circonftances mêmes
momentanées qui décident de la valeur mora-
le des aftions; il y a telle a&ion vile chez un peuple,
indifférente ou même peut-être honorable chez un
autre ; telle aélion quiétoit WA-,chez le même peuple
, dans un certain tems, & qui,a ceffé de l’être;
la morale n’eft guere moins en yiciffitude chez les
hommes , & peut-être dans-un même homme , que ia
pïûpart des autres chofes de la nature ou de l’art;
multa renafeentur, multa cecidére cadentque quee nunc
funt in honore. C’eft ce qu’on peut dir e des vertus &
des vices nationaux, comme des mots. Tacite nous
apprend que les Romains regardoient les Ju ifs, le
peuple de Dieu , celui qu’il s’étoit choifi., pour lequel
tant de miracles s’étoient opérés , comme la
partie la plus vile des hommes.
VILAIN , adj. ( Gram. ) laid , mal-propre , incommode
, qui a quelque qualité qui caufe du dégoût
ou du mépris : on dit un vilain tems , un vilain
chemin , un vilain animal, une vilaine aftion, un
vilain difeours : on dit auffi quelquefois un vilain
tout court, d’un homme poffedé d’une avarice fordide.
V il a in , en Fauconnerie, on appelle oifeau vilain,
celui qui ne fuit, le gibier que pour la cuifine, qu’on
ne peut affaiter ni dreffer, tels que font les milans &
les corbeaux, qui ne chaffent que pour les poulets.
.V IL A IN E l a , ou l a V i l l a in e , {Géogr. mod.)
en latin Vicinovia, & par Ptolomée Vidiana ; rivière
de France. Elle prend fa fource au'x confins du
Maine , & après avoir baigné V it r y , Rennes, &
autres lieu x , elle fe perd dans la mer , vis-à-vis de
Belle-Ifle. ( D . J . )
VILAN EL LE , f. f. forte de danfe ruftique, dont
l’air doit être g a i, & marqué d’une mefure très-fen*
fible. Le fond en eft ordinairement un couplet affez
fimple, fur lequel on fait enfuite plufieurs doubles
& variations. Voye{ D o u b l e s , V a r ia t io n s . (S)
VILEBREQUIN , f. m. {Outil d'ouvriers. ) outil
qui fert à p ercer, trouer ou forer diverfes matières
dures, comme le bois , le m arbre, & la pierre, même
quelques métaux.
Le vilebrequin eft compofé de quatre pièces, delà
poignée , du fuft ou de la manivelle, de laboîte, &
de la meche; la meche eftdefér acéré, un peu creu-
fe en forme d’une gouge , & amorcée par le bout. La
boîte eft de bois ou de fe r , fuivant que la monturô
du vilebrequin eft de l’un ou de l’autre; elle eft percée
par en-bas pour y mettre la queue de la meche ; le
fuft ou la manivelle qui a la figure d’un a r c , eft attaché
d’un bout folidement à la boîte , & de l’autre a
la poignée du vilebrequin ; mais par cette derniere extrémité
elle eft mobile. Une grande quantité d’ouvriers
& d’artifans fe fervent du vilebrequin, mais entre
autres les charpentiers, les menuifiers, & les fer*
ruriers : la monture des vilebrequins de ceux-ci eft oe
fer ; celle des autres eft de bois. {D . J . )
V il e b r e q u in , f. m. {outil d'ArquebuJter. ) ce vilebrequin
fert aux arquebufiers pour pofer une meche
& pour forer des trous dans du bois. Il n’a rien d®
particulier, & reffemble aux vilebrequins des menui1-
fie r s, ferruriers, 6*c, V ilebrequin >
V I L
Vilebrequin, f. m, {Charpenterie.) c*eft uneu^
^ 1 qui fert à percer le bois, & à autres chofes,
par le moyen d’un petit fer qui a un taillant arrondi
appellé meche, & qu’on , fait entrer en le tournant
^avec une manivelle de pois ou de fer. { D . J . )
Vilebrequin, f. m. {Horlog.) outil propre à
.foire tourner les égaüffoirs. {D . J . " )
VILEBREQUIN , f. m. terme de Layetier, les vilebrequins
dont fe fervent les maîtres làyetiers leur font
jparticuliers. Us ont un manche long & finiffant en
pointe, en forme de tariere un peu çreufe en-de.-
dans. La commodité de cette forte de vilebrequin
confifte en ce que avec la même meche qu’on enfonce
plus ou moins, on fait des trous de toutes grandeurs.
( D . J . ) \ .
V IL L A , {Gcog. anc.) nom latin qui lignifie une
maifon de campagne , une ferme , une métairie. Les
.anciens s’en font auffi fervis pour défigner une bourgade
j ou un village, Qo lit dans Aufone ;
Villâ lucani tum potieris aco,
Ammien Marcellin écrit mtlanthiada villam ccefa*
jianam, en parlant de Mélanthias, villageàcentqua-
Tante ftades, de Conftantinopifi ; Eutrope, en parlant
de là mort de l’empereur Antonin Pie, dit qu’il mou^-
,rut apud Lorium yillam fuam, à douze milles de Rome.
Auréilius Viélor, Eutrope , & Caffiodore | appellent
Acyronem villam publïcam, le lieu voifin dé
Nicoméclie , dans lequel mourut l’empereur Conf-
tantin. Or Mélanthias, Lorium, Acyro, &C Lucania-
cum, étoient .des villages. Ils .s’étoient fans doute
formés auprès de quelque maifon de .campagne, dont
ilsavoient retenu le nom.
Dans les titres du moyen âge , on remarque qy.’iL
y avoit fouvent dans un petit pays plufieurs de ces
v illa , & dans une villa , plufieurs parties nommées
aloda, ou aïeux, qu’on louoit aux payfans. Ces
v illa , ou maifons.de campagne, ont donne commencement
à une infinité de villes , de bourgs, .& de
hameaux, dont les noms commencent, ou finiffent
par ville. G ’e.ft ce qui a donné pareillement l’origine
au mot françôis village, comme fi on eût voulu défi
gner par ce mot, un nombre de.maifons bâties auprès
d’une ■ villa 9 ou jnaifon.de campagne. { D . J . )
Vi.LLA , ( Lang. lut. ) villa , chez les Romains,
fignifioit unè métairie, ùnemaifon de campagne proportionnée
aux terres qui en dépendoient, une
maifon de revenu ; v illa , parce qu’on apportpit là
les fruits, dit 'Varron ; mais dans la fuite., ce nom
pafia aux maifons de plaifance , qui loin d’avoir du
revenu, coutoient immenfement d’entretien.
On changea Us prés en jardins ,
E n parterres fes champs fertiles ,
Les arbres fruitiers en (Unies ,
Et.les vergers en boulingrins.
LD. J . )
Vi l l a f a v s t in i , ( Géograph. anc.) lieu de là
grande-Bretagne : l’itinéraire d’Antonin lemar.que fur
la route de Londres .à Luguüum , entre Cojonia &c
L ia n i, à trente-cinq milles de la première de ces
places, & à vingt-quatr.e 'milles de la fécondé. On
croit communément que B ury, .à fept .railles à l’orient
de Neumarket , ëjft ;le lieu que les Romains
nommoient Eaufiini villa. L e roi Edmond y ayant
«te inhumé, ce lieu prit le nom d’ Edmund's-Bury ;
& dçpüis on s’eft contenté de direfimplement Bury.
U y a neanmoins quelques écrivains qui veulent que
, Uummowfoit Vi.Ua Fauflini. ( D . J . )
^ d'iLLA H a d r i ah i , {Géog.anc.) maifon de plai-
lan<:e^ e Empereur Hadrien , fur le chemin de Ti-
'Voli à Frefcàti.on en voit les mafures , -en fe dé-
tournant .un peu à la gauche, & c’eft ce que les pay-
Jans du quartier appellentTiyoli vccchio. L ’empereur
Tome XV U ,
V I L 27.3
Hadrien avoit bâti cette maifon de çatnpagne d?une
maniéré des plus galante, ayant imité en divers endroits
le ly c é e , !ê prytanée , le .portique, le canope
d’Egypte , &c. Il y ayoit auffi bâti une muraille , pii
Io n avpij le foleil d’up côté , l’ombre de l’autre-
c eft-à-dire qu il 1 avoit cjilpofee du levant au couchant.
Il y ayoit encore dans ce lieu deux ou trois
temples ; tout cela eft détruit. Les ftatu.es d’Ifis de
marbre no.ir qn’on voit au palais de Muxiqiis à Rome
, ont été tirées de ce liéu. ( D . J . )
V i l l a B o r g h e s e , {G é o g . m o d .) maifpn de.plai-
fance en Italie, à deux milles de R ome, •& qui prend
fon n9.n1 de la famille à laquelle elle Appartient. On
la nomme auffi quelquefois vigne-Borghhft, C ’eft un
lieu très-agréable ? cjui ferpit digne 4’être habité par
un grand pripce.
La maiipn eft prefque toute revêtue en dehors de
;bas-reliëfs antiques^difpofés avec tant de fymmétrie,
qu on les croirait ayojr été faits exprès, pour être
placés comme ils font. Entre le grand nombre de fta.-
tues, dont les appartemens de c.e petit palais font
remplis, on admire principalement le gladiateur.,
la Junon de .porphire , la louve de Romulus , d’un
fin marbre d'Egypte ; les buftes d’A^nibal , de Sé-
neque , 6ç de Pertinax , rHermaphrodite , &c le
vieux ffilène qui tient Bacchus entre fes bras: le David
frondant Goliath, i’Enée qui emporte Anchife ,
de là métamorphofe de Daphné, font trois pièces modernes
du cavalier Bernin? qui méritent d'être mifes
au rahg des premières.
On lait auluq.ue ce palais eft rempli de peintures
rares des modem.es. Le S Antoine du Carache, &
le Chrift mort de Raphaëel, font regardés comme
les deux principaux morceaux. Si toutes Les magnificences
qu’on .peut voir ailleurs ne font pas ici fi
fplendidement étalées, on y .trouve des beautés plus
douces & plus touchantes •; des beautés tendres Ôc
naturelles , qui font plus naître d’amour, fi elles
n'infpiren? pas tant de refpeft. Enfin comme Rome
eft la iburce des ftatues 6ç des feulptures anti tues y
.il faut qy.e le refte du monde cede en cela au palai$
de la famjlle de Borghèfè. On ne peut rien ajouter à
la beauté de fes promenades ; il y a un parc , de$
grottes | des fontaines , des volières, des cabinets de
verdure , & une infinité de ftatues antiques & modernes.
( D . J . )
V i l l a d e C ondé , {Géog. mod.) petite ville de
Portugal., dans la province d’EntreDuero-e-Minho ,
fur la droite; & à ,l’embouchure de la riviere d’Ave,
.entre Barcelos & Porto , avec un petit port. Ses ha-
bitans vivent de la pêche. Long. 9 . ao . latit. 41. 10 . mm
V il l a d e l s p ir it u s a n t o , ( Géog. mod. ) ville
de l’Amérique feptentrionale , dans.la nouvelle Ef-
.pagne, province.de Guaxaca, à .90 -lieues d’Ante-
quera.,.à 5 lieues d éjà mer;-elle.a été bâtie en 1 5 1 1
par Gonfalve de Sando val. {D . J . )
V il l a d i s a n D o m e n ig o , ( Géog. mod.) ma-
naftere de dominiquains , au .royaume de Naples ,
dans ia terre de Labour, à trois mille;, d’Arpino, dans
une île que forme le Fibrino ? avant que de i'e joinf,
dre au.Gariglan,
L’article de.s couvens n’entre point dans ma géographie
; mais il faut fav.oir que C-eft ici le lieu natal
de C icéron, & quede portique de Forateuï de Rome
a paffé à des moines qui ne le eennoiffent pas. Des
inquifiteurs ignorans, uiperftiiieiix,inutiles'aii monde
, habitent donc aujourd’hui la maifon de plaifan*
ce du conful qui -fauva la république, du beau génie
qui répandit dans l’univers les lumières dë la raiion;
de la morale & de la liberté.
■ C’étôjt une des maifons de campagne où Gicéron
fe retiroit volontiers pour s’y délaffer du poids ded
grandes affaires d.e l’état. La .clarté &c la rapidité de
M m