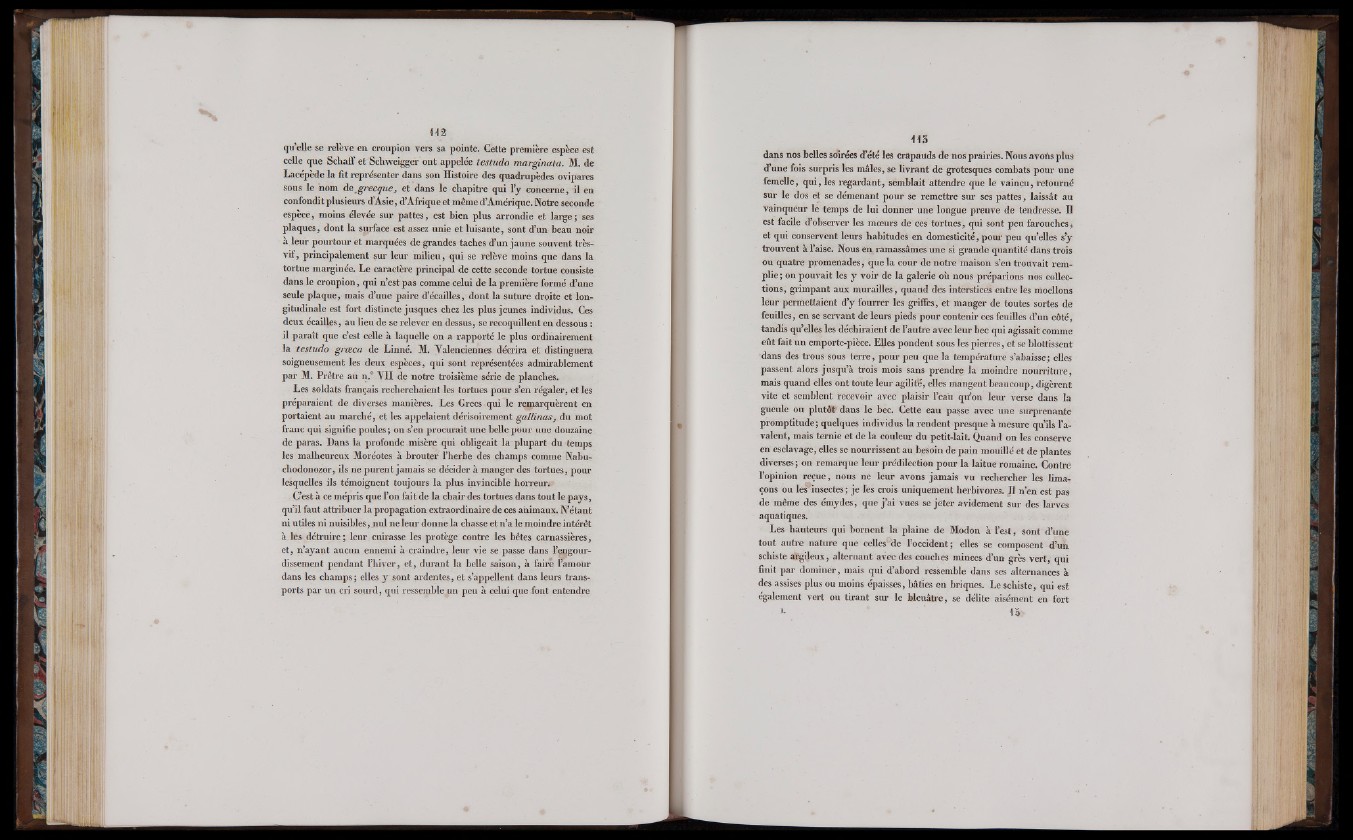
qu’elle se relève en croupion vers sa pointe. Cette première espèce est
celle que Schaff et Schweiggér ont appelée testudo marginata. M. de
Lacépède la fit représenter dans son Histoire des quadrupèdes ovipares
sous le nom àe^grecque, et dans le chapitre qui l’y concerne, il en
confondit plusieurs d’Asie, d’Afrique et même d’Amérique. Notre seconde
espèce, moins élevée sur pattes, est bien plus arrondie et large; ses
plaques, dont la surface est assez unie et luisante, sont d’un beau noir
à leur pourtour et marquées de grandes taches d’un jaune souvent très-
vif, principalement sur leur milieu, qui se relève moins que dans la
tortue marginée. Le caractère principal de cette seconde tortue consiste
dans le croupion, qui n’est pas comme celui de la première formé d’une
seule plaque, mais d’une paire d’écailles, dont la suture droite et longitudinale
est fort distincte jusques chez les plus jeunes individus. Ces
deux écailles, au lieu de se relever en dessus, se recoquillent en dessous :
il parait que c’est celle à laquelle on a rapporté le plus ordinairement
la testudo groeca de Linné. M. Yalenciennes décrira et distinguera
soigneusement les deux espèces, qui sont représentées admirablement
par M. Prêtre au n.° YII de notre troisième série de planches.
Les soldats français recherchaient les tortues pour s’en régaler, et les
préparaient de diverses manières. Les Grecs qui le remarquèrent en
portaient au marché, et les appelaient dérisoirement g a llin a sdu mot
franc qui signifie poules; on s’en procurait une belle pour une douzaine
de paras. Dans la profonde misère qui obligeait la plupart du temps
les malheureux Moréotes à brouter l’herbe des champs comme Nabu-
chodonozor, ils ne purent jamais se décider à manger des tortues, pour
lesquelles ils témoignent toujours la plus invincible horreur;
C’est à ce mépris que l’on fait de la chair des tortues dans tout le pays,
qu’il faut attribuer la propagation extraordinaire de ces animaux. N’étant
ni utiles ni nuisibles, nul ne leur donne la chasse et n’a le moindre intérêt
à les détruire ; leur cuirasse les protège contre les bêtes carnassières,
et, n’ayant aucun ennemi à craindre, leur vie se passe dans l’çngour-
dissement pendant l’hiver, et, durant la belle saison, à faire 1 amour
dans les champs; elles y sont ardentes, et s’appellent dans leurs transports
par un cri sourd, qui ressemble un peu à celui que font entendre
dans nos belles soirées d’été les crapauds de nos prairies. Nous avons plus
d’une fois surpris les mâles, se livrant de grotesques combats pour une
femelle, qui, les regardant, semblait attendre que le vaincu, retourné
sur le dos et se démenant pour se remettre sur ses pattes, laissât au
vainqueur le temps de lui donner une longue preuve de tendresse. Il
est facile d’observer les moeurs de ces tortues, qui sont peu farouches,
et qui conservent leurs habitudes en domesticité, pour peu qu’elles s’y
trouvent à l’aise. Nous en ramassâmes une si grande quantité dans trois
ou quatre promenades, que la cour de notre maison s’en trouvait remplie;
on pouvait les y voir de la galerie où nous préparions nos collections,
grimpant aux murailles, quand des interstices entre les moellons
leur permettaient d’y fourrer les griffes, et manger de toutes sortes de
feuilles, en se servant de leurs pieds pour contenir ces feuilles d’un côté,
tandis qu’elles les déchiraient de l’autre avec leur bec qui agissait comme
eût fait un emporte-pièce. Elles pondent sous les pierres, et se blottissent
dans des trous sous terre, pour peu que la température s’abaisse; elles
passent alors jusqu’à trois mois sans prendre la moindre nourriture,
mais quand elles ont toute leur agilité, elles mangent beaucoup, digèrent
vite et semblent recevoir avec plaisir l’eau qu’on leur verse dans la
gueule ou plutôt dans le bec. Cette eau passe avec une surprenante
promptitude; quelques individus la rendent presque à mesure qu’ils l’avalent,
mais ternie et de la couleur du petit-lait. Quand on les conserve
en esclavage, elles se nourrissent au besoin de pain mouillé et de plantes
diverses; on remarque leur prédilection pour la laitue romaine. Contre
l’opinion reçue, nous ne leur avons jamais vu rechercher les limaçons
ou les“ insectes ; je les crois uniquement herbivores. n'en est pas
de même des émydes, que j’ai vues se jeter avidement sur des larves
aquatiques.
Les hauteurs qui bornent la plaine de Modon à l’est, sont d’une
tout autre nature que celles' cle l’occident ; elles se composent d’un
schiste argileux, alternant avec des couches minces d’un grès vert,1 qui
finit par dominer, mais qui d’abord ressemble dans ses alternances à
des assises plus ou moins épaisses, bâties en briques. Le schiste, qui est
également vert ou tirant sur le bleuâtre, se délite aisément en fort
i* 15'1