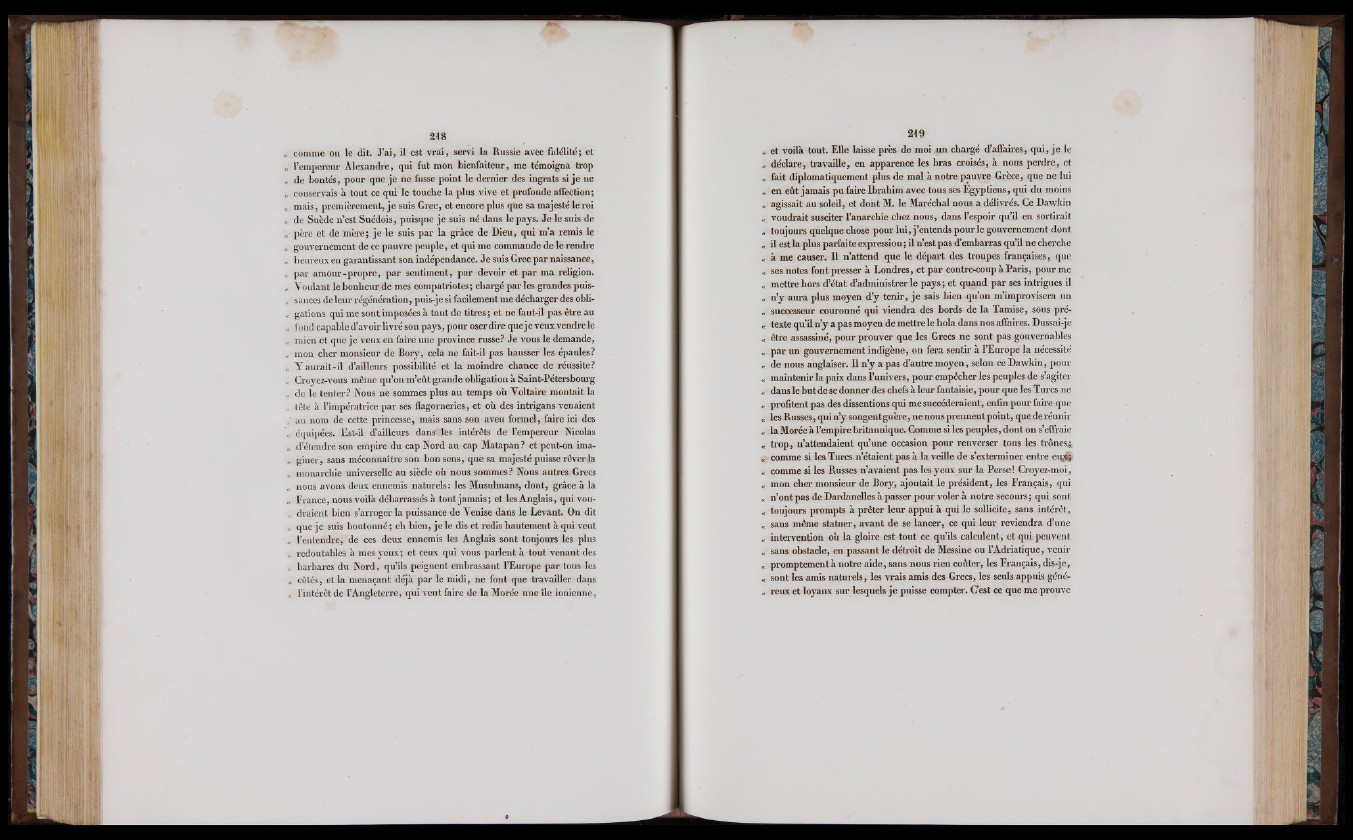
* comme on le dit. J’ai, il est vrai, servi la Russie avec fidélité; et
« l’empereur Alexandre, qui fut mon bienfaiteur, me témoigna trop
« de bontés, pour que je ne fusse point le dernier des ingrats si je ne
« conservais à tout ce qui le touche la plus vive et profonde affection;
« mais, premièrement, je suis Grec, et encore plus que sa majesté le roi
« de Suède n’est Suédois, puisque je suis né dans le pays. Je le suis de
« père et dé mère; je le suis par la grâce de Dieu, qui m’a remis le
« gouvernement de ce pauvre peuple, et qui me commande de le rendre
« heureux en garantissant son indépendance. Je suis Grec par naissance,
« par amùur-propre, par sentiment, par devoir et par ma religion.
« Voulant le bonheur de mes compatriotes; chargé par les grandes puis-
« sances de leur régénération, puis-je si facilement me décharger des obli-
« gâtions qui me sont imposées à tant de titres ; et ne faut-il pas être au
« fond capable d’avoir livré son pays, pour oser dire que je veux vendre le
« mien et que je veux en faire une province russe? Je vous le demande,
« mon cher monsieur de Bory, cela ne fait-il pas hausser les épaules?
« Y aurait-il d’ailleurs possibilité et la moindre chance de réussite?
« Croyez-vous même qu’on m’eût grande obligation à Saint-Pétersbourg
« de le tenter? Nous ne sommes plus au temps oîi Voltaire montait la
« tête à l’impératrice par ses flagorneries, et ou des intrigans venaient
«' au nom de cette princesse, mais sans son aveu formel, faire ici des
« équipées. Est-il d’ailleurs dans Tes intérêts de l’empereur Nicolas
« ¿’étendre son empire du cap Nord au cap Matapan? et peut-on ima-
« giner, sans méconnaître son bon sens, que sa majesté puisse rêver la
« monarchie universelle au siècle où nous sommes? Nous autres Grecs
« nous avons deux ennemis naturels: les Musulmans, dont, grâce à la
¿«.France, nous voilà débarrassés à tout jamais; et les Anglais, qui vou-
« draient bien s’arroger la puissance de Venise dans le Levant. On dit
« que je suis boutonné; eh bien, je le dis et redis hautement à qui véut
« l’entendre, de ces deux ennemis les Anglais sont toujours les plus
■« redoutables à mes yeux; et ceux qui vous parlent à tout venant des
« barbares du Nord, qu’ils peignent embrassant l’Europe par tous les
« côtés, et la menaçant déjà par le midi, ne font que travailler dans
« l’intérêt de l’Angleterre, qui veut faire de la Morée une île ionienne,
et voilà tout. Elle laisse près de moi un chargé d’affaires, qui, je le
déclare, travaille, en apparence les bras croisés, à nous perdre, et
fait diplomatiquement plus de mal à notre pauvre Grèce, que ne lui
en eût jamais pu faire Ibrahim avec tous ses Egyptiens, qui du moins
agissait au soleil, et dont M. le Maréchal nous a délivrés. Ce Dawkin
voudrait susciter l’anarchie chez nous, dans l’espoir qu’il en sortirait
toujours quelque chose pour lui, j’entends pour le gouvernement dont
il est la plus parfaite expression; il n’est pas d’embarras qu’il ne cherche
à me causer. Il n’attend que le départ des troupes françaises, que
ses notes font presser à Londres, et par contre-coup à Paris, pour me
mettre hors d’état d’administrer le pays; et quand par ses intrigues il
n’y aura plus moyen d’y tenir, je sais bien qu’on m’improvisera un
successeur couronné qui viendra des bords de la Tamise, sous prétexte
qu’il n’y a pas moyen de mettre le hola dans nos affaires. Dussai-je
être assassiné, pour prouver que les Grecs ne sont pas gouvernables
par un gouvernement indigène, on fera sentir à l’Europe la nécessité
de nous anglaiser. Il n’y a pas d’autre moyen, selon cé Dawkin, pour
maintenir la paix dans l’univers, pour empêcher les peuples de s’agiter
dans le but de se donner des chefs à leur fantaisie, pour que les Turcs ne
profitent pas des dissentions qui me succéderaient, enfin pour faire que
les Russes, qui n’y songent guère, ne nous prennent point, que de réunir
la Morée à l’empire britannique. Gomme si les peuples, dont on s’effraie
trop, n’attendaient qu’une occasion pour renverser tous les trônes*
comme si les Turcs n’étaient pas à la veille de s’exterminer entre
comme si les Russes n’avaient pas les yeux sur la Perse! Croyez-moi,
mon cher monsieur de Bory, ajoutait le président, les Français, qui
n’ont pas de Dardanelles à passer pour voler à notre secours; qui sont
toujours prompts à prêter leur appui à qui le sollicite, sans intérêt,
sans même statuer, avant de se lancer, ce qui leur reviendra d’une
intervention où la gloire est tout ce qu’ils calculent, et qui peuvent
sans obstacle, en passant le détroit de Messine ou l’Adriatique, venir
promptement à notre aide, sans nous rien coûter, les Français, dis-je,
sont les amis naturels, les vrais amis des Grecs, les seuls appuis généreux
et loyaux sur lesquels je puisse compter. C’est ce que me prouve