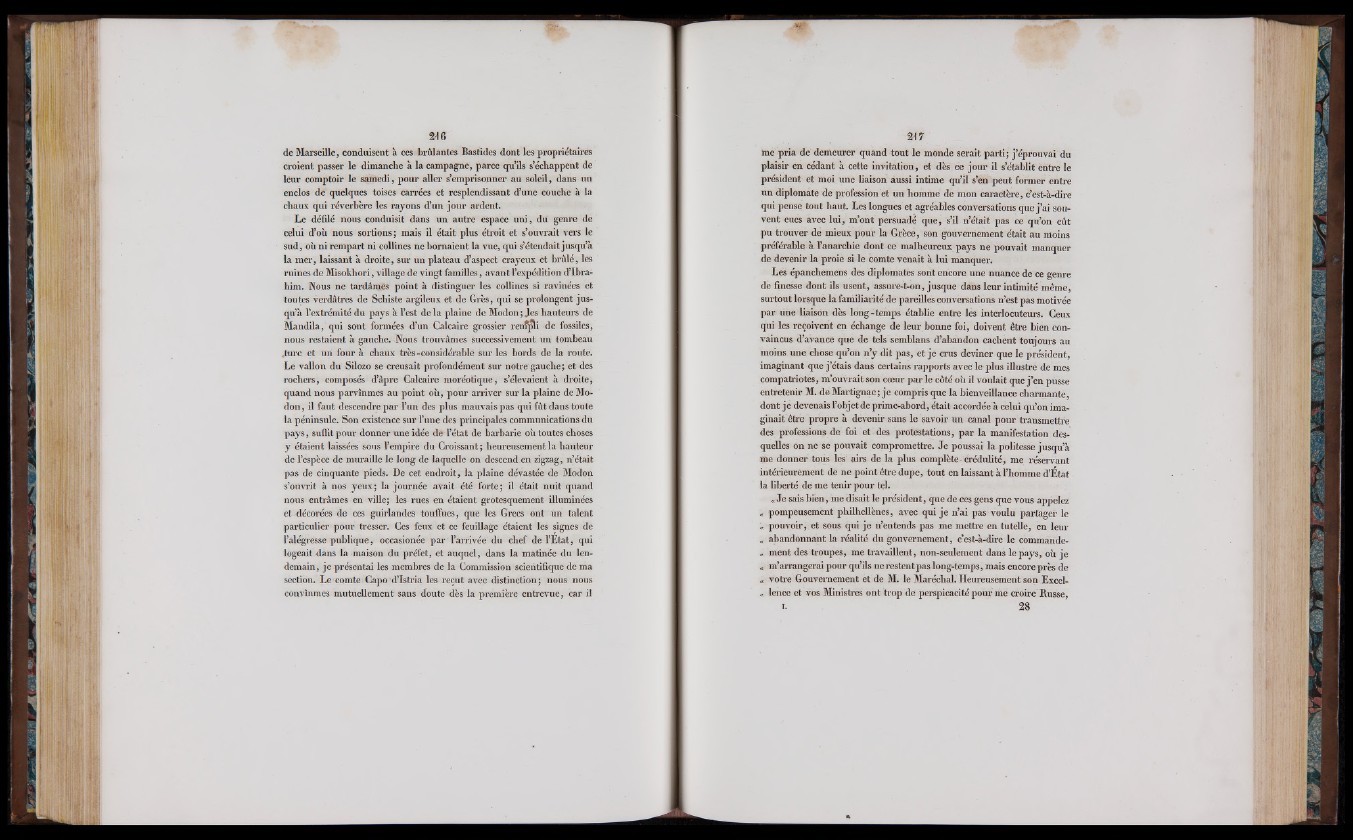
de Marseille, conduisent a ces brûlantes Bastides dont les propriétaires
croient passer le dimanche à la campagne, parce qu’ils s’échappent de
leur comptoir le samedi, pour aller s’emprisonner au soleil, dans un
enclos de quelques toises carrées et resplendissant d’une couche à la
chaux qui réverbère les rayons d’un jour ardent.
Le défilé nous conduisit dans un autre espace uni, du genre de
celui d’où nous sortions; mais il était plus étroit èt s’ouvrait vers le
sud, où ni rempart ni collines ne bornaient la vue, qui s’étendait jusqu’à
la mer, laissant à droite, sur un plateau d’aspect crayeux et brûlé, les
ruines de Misokhori, village de vingt familles, avant l’expédition d’Ibra-
him. Nous ne tardâmes point à distinguer les collines si ravinées et
toutes verdâtres de Schiste argileux et de Grès, qui se prolongent jusqu’à
l’extrémité du pays à l’est delà plaine de Modon; Jes hauteurs de
Mandila, qui sont formées d’un Calcaire grossier rempli de fossiles,
nous restaient à gauche. Nous trouvâmes successivement un tombeau
„turc et un four à chaux très-considérable sur les bords de la route.
Le vallon du Silozo se creusait profondément sur notre gauche; et des
rochers, composés d’âpre Calcaire moréotique, s’élevaient à droite,
quand nous parvînmes au point où, pour arriver sur la plaine de Modon,
il faut descendre par l’un des plus mauvais pas qui fût dans toute
la péninsule. Son existence sur l’une des principales communications du
pays, suffit pour donner une idée de l’état de barbarie où toutes choses
y étaient laissées sons l’empire du Croissant ; heureusement la hauteur
de l’espèce de muraille le long de laquelle on descend.en zigzag, n’était
pas de cinquante pieds. De cet endroit, la plaine dévastée de Modon
s’ouvrit à nos yeux; la journée avait été forte; il était nuit quand
nous entrâmes en ville; les rues en étaient grotesquement illuminées
et décorées de ces guirlandes touffues, que les Grecs ont un talent
particulier pour tresser. Ces feux et ce feuillage étaient les signes de
l’alégresse publique, occasionée par l’arrivée du chef de l’Etat, qui
logeait dans la maison du préfet, et auquel, dans la matinée du lendemain,
je présentai les membres de la Commission scientifique de ma
section. Le comte Gapo d’Istria les reçut avec distinction; nous nous
convînmes mutuellement sans doute dès la première entrevue, car il
me pria de demeurer quand tout le monde serait parti; j’éprouvai du
plaisir en cédant à cette invitation, et dès ce jour il s’établit ëntre le
président et moi une liaison aussi intime qu’il s’en peut former entre
un diplomate de profession et un homme de mon caractère, c’est-à-dire
qui pense tout haut. Les longues et agréables conversations que j ’ai souvent
eues avec lui, m’ont persuadé que, s’il n’était pas ce qu’on eût
pu trouver de mieux pour la Grèce, son gouvernement était au moins
préférable à l’anarchie dont ce malheureux pays ne pouvait manquer
de devenir la proie si le comte venait à lui manquer.
Les épanchemens des diplomates sont encore une nuance de ce genre
de finesse dont ils usent, assure-t-on, jusque dans leur intimité même,
surtout lorsque la familiarité de pareilles conversations n’est pas motivée
par une liaison dès long-temps établie entre les interlocuteurs. Ceux
qui les reçoivent en échange de leur bonne foi, doivent être bien convaincus
d’avance que de tels semblans d’abandon cachent toujours au
moins une chose qu’on n’y dit pas, et je crus deviner que le président,
imaginant que j’étais dans certains rapports avec le plus illustre de mes
compatriotes, m’ouvrait son coeur par le côté où il voulait que j’en pusse
entretenir M. deMartignac; je compris que la bienveillance charmante,
dotit je devenais l’objet de prime-abord, était accordée à celui qu’on imaginait
être propre à devenir sans le savoir un canal pour transmettre
des professions de foi et des protestations, par la manifestation desquelles
on ne se pouvait compromettre. Je poussai la politesse jusqu’à
me donner tous les airs de la plus complète crédulité, me réservant
intérieurement de ne point être dupe, tout en laissant à l’homme d’État
la liberté de me tenir pour tel.
« Je sais bien, me disait le président, que de ces gens que vous appelez
« pompeusement philhellènes, avec qui je n’ai pas voulu partager le
« pouvoir, et sous qui je n’entends pas me mettre en tutelle, en leur
« abandonnant la réalité du gouvernement, c’est-à-dire le commânde-
« ment des troupes, me travaillent, non-seulement dans le pays, où je
« m’arrangerai pour qu’ils ne restent pas long-temps, mais encore près de
« votre Gouvernement et de M. le Maréchal. Heureusement son Excel*
« lence et vos Ministres ont trop de perspicacité pour me croire Russe,