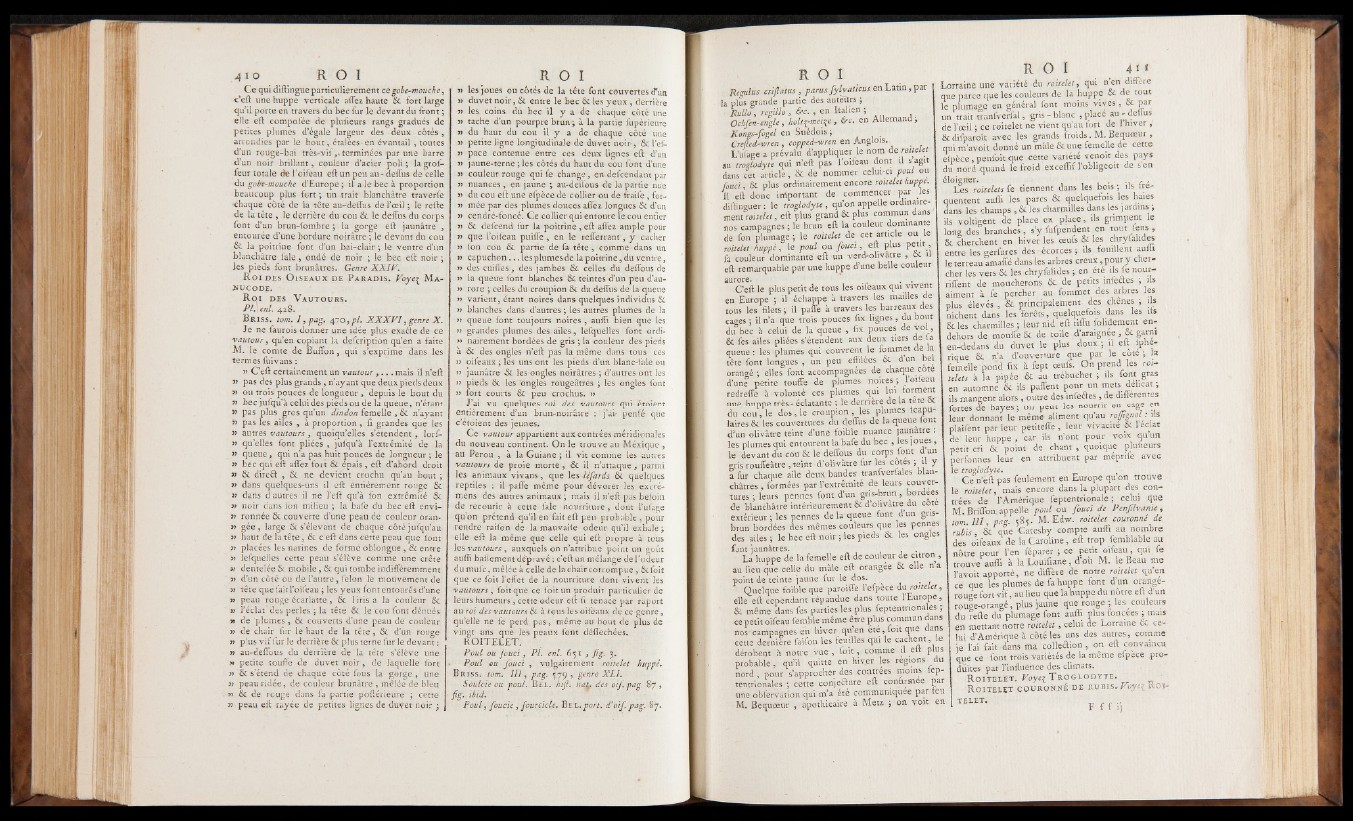
4 1 0 R O I
Ce qui diftingue particulièrement ce gobe-mouche,
c’eft une huppe verticale affez haute & fort' large
qu’il porte en travers du bec fur le devant du front ;
elle eft compofée de plufieurs rangs gradués de
petites plumes d’égale largeur des deux côtés,
arrondies par le bout, étalées-en évantail, toutes
d’un rouge-bai très-vif ,» terminées par une barre
d’un noir brillant, couleur d’acier poli ; la grofi-
feur totale de l ’oifeau eft un peu au - deffus de celle
du gobe-mouche d’Europe ; il a le bec à proportion
beaucoup plus fort ; un trait blanchâtre traverfe
-chaque côté de la tête au-defliis de l’oeil ; le refte
de la tête , le derrière du cou & le deflus du corps
font d’un brun-fombre; la gorge eft jaunâtre ,
entourée d’une bordure noirâtre ; le devant du cou
& la poitrine font d’un hai-clair ; le ventre d’un
blanchâtre fa le , ondé de noir ; le bec eft noir ;
les pieds font brunâtres. Genre X X JV .
R o i d e s O i s e a u x d e P a r a d i s . Voyeç Ma-
JsIUCODE.
R o i d e s V a u t o u r s .
PI. I enl. 428.
B r i s s . tom. l ,p a g . 4 7 0 ,p l. X X X V I , genre X .
Je ne faurois donner une idée plus exaéfe de ce
vautour, qu’en copiant la defcription qu’en a faite
M. le comte de Buffon, qui s’exprime dans les
termes fuivans :
» C’eft certainement un vautour , . . . mais il n’eft
v pas des plus grands, n’ayant que deux pieds deux
» ou trois pouces de longueur , depuis le bout du
bec jufqu’a celui des pieds ou de la queue, n’étant
B pas plus gros qu’un dindon femelle , & n’ayant
ï> pas les ailes , à proportion , fi grandes que les
3) autres vautours , quoiqu’elles s’étendent, lorf-
» qu’elles font pliées , jufqu’à l’extrémité de la.
» queue , qui n’a pas huit pouces de longueur ; le
» bec qui eft affez fort & épais , eft d’abord droit
» & direâ , & ne devient crochu qu’au bout ;
» dans quelques-uns il eft entièrement rouge &
v dans d'autres il ne l’eft qu’à fon extrémité Sc
» noir dans fon milieu ; la bafe du bec eft envi-
» ronnée & couverte d’une peau de couleur ôràn-
« g é e , large & s’élevant de chaque côté jüfqu’au.
j> haut de la tête, & c eft dans cette peau que lont
?> placées les narines de forme oblongue , & entre
» lelquelles cette peau s’élève comme une crête
k dentelée & mobile, & qui tombe indifféremment
» d’un côté ou de l’autre, félon le mouvement de
>? tête que lait l’oifeau ; les yeux font entourés d’une
» peau rouge écarlatte, & 1 iris a la couleur &
» l’éclat des perles ; la tête & le cou font dénués
» de plumes , & couverts d’une peau de couleur
» de chair fur le haut de la tê te , & d’un rouge
v plus v if fur le derrière & plus terne fur le devant :
yj au-defibus du derrière de la tête s’élève une
» petite touffe de duvet n o ir, de laquelle fort
?> & s’étend de chaque côté fous la gorge , une
« peau ridée, de couleur brunâtre , mêlée de bleu
m & de rouge dans fa .partie poftérieure ; cette
v peau eft rayée .de petites lignes de duyet noir ;
R O I
» les joues ou côtés de la tête font couvertes d'un
» duvet noir, & entre le bec & les yeux , derrière
» les. coins dû bec il y a de " chaque côté une
» tache d’un pourpre brun ; à la partie fupérieure
n du haut du cou il y a de chaque côté une
» petite ligne longitudinale de duvet noir', & l’efi
n pace contenue entre ces deux lignes eft d’un
>> jaune-terne ; les côtés du haut du cou font d’une
n couleur rouge qui fe change, en defcendant par
» nuances, en jaune ; au-defibus de la partie nue
v du cou effune efpèce de collier ou de fraife , for-
« mée par des plumes douces affez longues & d’un
n cendré-foncé. Ce collier qui entoure le cou entier
» & defcend fur la poitrine, eft allez ample pour
» que l’oifeau puiffe * en le refferrant, y cacher
» fon cou &. partie de fa tête , comme dans un
» capuchon. . . les plumes de la poitrine, du ventre,
» des cuiffes , des jambes & celles du deffous de
n la queue font blanches Ô£ teintes d’un peu d’au-
» rore ; celles du croupion &. du deffus de la queue
n varient, étant noires dans quelques individus ÔC
» blanches dans d’autres; les autres plumes de la
» queue font toujours noires , aufli bien que les
n grandes plumes des.ailes., lefquelles font ordi-
» nairement bordées de gris ; la couleur des pieds
à & des ongles n’eft pas la même dans tous ces
» oifeaux ; les uns ont les pieds d’un blanc-fale. ou
>» jaunâtre 3c les ongles noirâtres-; d’autres ont les
» pieds ôc les 'ongles rougeâtres ; les ongles font
» fort courts ôc peu crochus, »
J ’ai vu quelques-roi des vautours qui étoient
entièrement d’un brun-noirâtre : j ’ai*- penfé que
c’étoient des jeunes.
Ce vautour appartient aux contrées-méridionales
du nouveau continent. On le trouve au Méxique ,
au Pérou , à la Guiane ; il vit comme les autres
vautours de proie morte , & il n’attaque , parmi
les animaux vivans, que les léfards & quelques
reptiles : il paffe même pour dévorer les excré-
mens des autres animaux ; mais il n’eft pas befoin
de recourir à cette fale nourriture, dont l’ufage
qu’on prétend qu’il en fait eft peu probable , pour
rendre raifon de la mauvaiiè odeur qu’il 'exhale ;
elle eft la même que celle qui eft propre à tous
les vautours , auxquels on n’attribue point un goût
aufli bafiement dépravé : c’eft un mélange de l ’odeur
du mufc, mêlée à celle de la chair corrompue, & foit
que ce foit l’effet de la nourriture dont vivent les
vautours , foit que ce foit un produit particulier de
leurs humeurs , cette odeur eft fi tenace par raport
au roi des vautours Ôc à tous les oifeaux de ce genre,
qu’elle ne fe perd pas, même au bout de plus de
vingt ans que les peaux font déffechées.
RO IT E L E T .
P oui ou Jouci , PL enl. 6 51 , fig. 3.
• Poui ou fouci , vulgairement roitelet huppé.
B r i s s . tom. 111, pag. 579 , genre X L 1.
Soulcie ou poul. B e l . ht fl. nat. des oifpag. 8 7 ,
fig. ibid.
Poul, foucie, fourcicle, B e l .port, d ’oif. pag. $7 .
R O I
Regulus crifiatus , parus fylvaticus en Latin, par 1
la plus grande partie des autèûrvs ;
Rullo , regillo, &c. , en Italien ;
Ochfen-engle, holt{-meï{e , &c. en Allemand ,
Kongs-fogel en Suédois ;
Crefted-wren, copped-wren en Ànglois.
L’uiage a prévalu d’appliquer le nom t e roitelet
*u troglodyte qui n’eft pas l’oifeau dont il s agit
dans cet article, Ôc de nommer celui-ci poul ou
fouci, ôc plus ordinairement encore roitelet huppe.
Il eft donc important de commencer par les
diftinguer : le troglodyte, qu’on appelle ordinaire-
ment roitelet, eft plus grand Ôc plus commun dans
nos campagnes ; le brun eft la couleur dominante
de fon plumage; le roitelet de cet article ou le
roitelet huppé, le poul ou fo u c i, eft plus petit ,
fa couleur dominante eft un verd-olivatre , oc il
eft remarquable par une huppe d’une belle couleur
aurore. . .
C’eft le plus petit de tous les oifeaux qui vivent
en Europe ; il échappe à travers les mailles de
tous les filets; il paffe à travers les barreaux des
cages ; il n’a que trois pouces fix lignes, du bout'
du bec à celui de la ‘queue , fix pouces de v o l,
& fès ailes pliées s’étendent aux deux tiers de la
queue : les plumes qui couvrent le fommet de la
tête font longues , un peu effilées & d un bel
orangé,; elles font accompagnées de chaque cote 1
d’une petite touffe de plumes noires ; loileau
redreffe à volonté ces plumes qui ^
unè huppe très - éclatante ; le derrière de lâ tete oc.
du cou, le dos, le croupion , les plumes feapu-
laires & les couvertures du deffus de la queue font
d’un olivâtre teint d’une, foible nuance jaunâtre .
les plumes qui entourent la bafe du bec , les joues,
le devant du cou & le deffous du corps ^font d ün
gris rouffeâtre , teint d’olivâtre fur les cotes ;^il y
a fur chaque aile deux bandes1 tranfverfales blanchâtres
, formées par l’extrémité de leurs couvertures,
; leurs pennes font d’un gris-brun, bordées
de blanchâtre intérieurement ôc d’olivâtre du cote
extérieur ; les pennes de la queue font d un gris-
brun bordées des mêmes couleurs que les pennes
des ailes ; le bec eft noir ; les pieds 8c les ongles
font jaunâtres.
La huppe de la femelle eft de couleur de citron ,
au lieu que celle du mâle eft orangée ôc elle na
point de teinte jaune fur le dos. .
Quelque foible que paroiffe l’efpèce du roitelet,
elle eft cependant répandue dans toute l’Europe,
Ôc même dans fes parties les plus feptentnonales ;
ce petit oifeau femble même être plus commun dans
nos-campagnes en hiver qu en ete, foit que ans
cette dernière faifon les feuilles qui le cachent, le
dérobent à notre v u e , fo it, comme il eft plus
probable, qu’il quitte en hiv,er les régions du
nord, pour s’approcher des .contrées moins lep-
tentrionales ; cette conjecture eft confirmée par
une obfervation qui m’a été communiquée par-feu
M. Bequoeur , apothicaire à Metz ; on voit en
R ° I 41 ï
Lorraine une variété du roitelet, qui n en diffère
que parce que les couleurs de la huppe ôc de tout
le plumage en général font moins vives , ôc par
un trait tranfverfal, gris - blanc , placé au - deffus
de l’oeil ; ce roitelet ne vient qu’au fort de l’hiv e r,'
Ôc difparoît avec les grands froids. M. Bequoeur,
qui m’avoit donné un mâle ôc une femelle de cette
efpèce, penfoit que cette variété venoit des pays
du nord quand le froid exceflif l’obligeoit de s’en
éloigner. " m r '
Les roitelets fe tiennent dans les bois ; ils tre-
quentent aufli les parcs Ôc quelquefois les haies
dans les champs , ôc les charmilles dans les jardins ;
ils voltigent de place en place, ils grimpent le
long des branches , s’y fufpendent en tout fens ,
ôc cherchent en hiver les oeufs ôc les chryfalides
entre les gerfures des -écorces ; ils fouillent auili
le terreau amaffé dans les arbres creux, pour y chercher
les vers ôc les chryfalides ; en été ils fe nour-
riffent de moucherons ôc de petits infectes ; ils
aiment à fe percher au fommet des arbres les
plus élevés , ôc principalement des chenes ; ils
nichent dans les fo rêts, quelquefois dans les ils
Ôc les charmilles ; leur nid eft tiffu folidement en-
dehors de moufle ôc de toile d’araignée , ôc garni
en-dedanS du duvet le pluè doux ; il eu jphe-
rique ôc n’a d’ouverture que par le cote ; la
femelle pond fix à fept oeufs. On prend les roitelets
à la pipée ôc au trébuchet ; ils font gras
en automne Ôc ils paffent pour un mets délicat ;
ils mangent alors , outre des infe&es , de.différentes
fortes de bayes ; on peut les nourrir en cage en
leur donnant le même aliment qu’au roffignol: ils
plaifent par leur petitelTe , leur vivacité & 1 éclat
de' leur huppe, car ils n’ont pour voix quun
petit cri & point de chant , quoique plufieurs
perfonnes leur en attribuent par méprife avec
le troglodyte* 5 -
Ce n’éft pas feulement en Europe qu on trouve
le roitelet, mais encore dans la plupart des contrées
de l’Amérique feptentrionale ; celui que
M. Briflbn. appelle poul ou fouci de Penfilvunie,
tom. 111, pag. 585. M. Ed-w. roitelet couronné de
rubis, & que Catesby compte aufli au nombre
des oifeaux de la Caroline, eft trop femblable au
nôtre pour l’en féparér ; ce petit oifeau, qui fe
trouve aufli à la Louifiane, d’oh M. le Beau me
l’avoit apporté, ne diffère de notre roitelet qu’en
ce que les plumes de fa huppe font d’un orangé-
rouge fort v if , au lieu que la huppe du nôtre eft d’un
rouge-orangé, plus jaune que rouge ; les couleurs
du refte du plumage font aufli plus foncées ; mais
en mettant notre roitelet, celui de Lorraine & celui
d’Amérique à côté les uns des autres, comme
je l’ai fait dans ma collection , on eft convaincu
que cè font trois variétés de la meme efpèce produites
par l’influence des climats.
R o i t e l e t , p 'o y q ; T r o g l o d y t e .
R o i t e l e t c o u r o n n é d e r u b i s . Voye^ R o i t
e l e t . mai 1 F f f ij