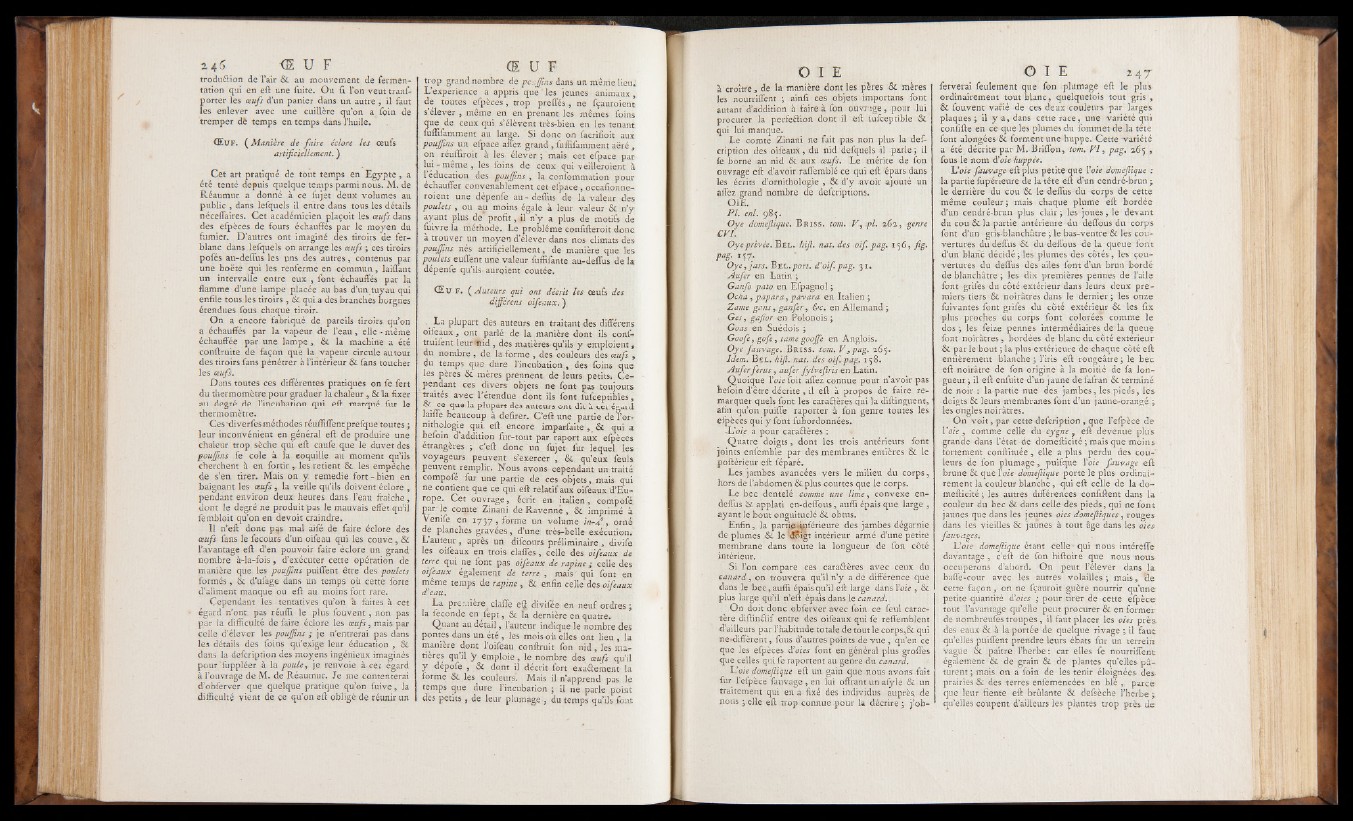
troduéfion de l ’air & au mouvement de fermentation
qui en eft une fuite. Ou fi l’on veut tranf-
p or ter les oeufs d’un panier dans un autre , il faut
les enlever avec une cuillère qu’on a foin de
tremper dè temps en temps dans l’huile.
OEuf. ( Manière de faire éclore les oeufs
artificiellement. )
Cet art pratiqué de tout temps en E g yp te ,. a
été tenté depuis quelque temps :parmi nous. M. de
Réaumur. a donné à ce fujet deux volumes au
public , dans lefquels il entre dans tous les détails
néceffaires. Cet académicien plaçoit les oeufs dans
des efpèces de fours échauffés par le moyen du
fumier. D ’autres ont imaginé des tiroirs de fer-
blanc dans lefquels on arrange les oeufs ; ces tiroirs
pofés au-deffus les uns des autres, contenus par
une boëte qui les renferme en commun, laiffant
un intervalle entre eux , font échauffés par la
flamme d’une lampe placée au bas d’un tuyau qui
enfile tous les tiroirs , & qui.a des branches borgnes
étendues fous chaque tiroir.
On a encore fabriqué de pareils tiroirs qu’on
a échauffés par la. vapeur de l’eau , elle - même
échauffée par une lampe, & la machine a été
conftruite de façon que la vapeur circule autour
des tiroirs fans pénétrer à l’intérieur & fans toucher
les oeufs.
Dans toutes ces différentes pratiques on fe fert
du thermomètre pour graduer la chaleur, & la fixer
au degré de l’incubation qui eft marqué fur le
thermomètre.
Ces'diverfes méthodes réufliffentprefque toutes ;
leur inconvénient en général eft de produire une
chaleur trop sèche qui eft caufe que le duvet des
poujjîns fe cole à la eoquille au moment qu’ils
cherchent à en fortir , les retient &. les empêche
de s’en tirer. Mais on y remedie fort-bien en
baignant les oeufs, la veille qu’ils doivent éclore ,
pendant environ deux; heures dans l’eau fraîche,
dont le degré ne produit 'pas le mauvais effet qu’il
fembloit qu’on en devoit craindre.
Il n’eft donc p^s mal aifé de faire éclore des
oeufs fans le fecoürs d’un oifeau qui les couve, &
l’avantage eft d’en pouvoir faire éclore un grand
nombre à-la-fois, d’exécuter cette opération de
manière que. les pouffins puiffent être des poulets
formés, & d'uiàge dans un temps où cette forte
d’aliment manque ou eft au moins fort rare.
Cependant les tentatives qu’on à faites à cet
égard n’ont, pas réufii le plus fouvent, non pas
par la difficulté de faire éclore les oeufs, mais par
celle d’élever les poujjîns ; je n’entrerai pas dans
les détails des foins quexige leur éducation, &
dans la defcription des moyens ingénieux imaginés
pour fuppléer à la poule, je renvoie à cet égard
à l’ouvrage de M. de Réaumur. Je me contenterai
d’obferver que quelque pratique qu’on fuive, la
difficulté vient dè ce qu’on eft obligé de réunir un
trop grand nombre de pc.:JJîns dans un même lieu.'
L ’expérience a appris que 'le s jeunes animaux,,
de toutes efpèces, trop preffés , ne fçauroient
s’élever , même en en prenant les mêmes foins
que de ceux qui s’élèvent très-bien en les tenant
mffifamment au large. Si donc on facrifioit aux
poujjîns un efpace allez grand, fuffifamment aëré ,
on reüfliroit à les élever ; mais cet efpace. par
lui-même , les foins de ceux qui veilleroient à
1 éducation des poujjîns , la confommation pour
échauffer convenablement cet efpace , oçcafionne-
roient une dépenfe au - deffus de la valeur des
poulets , ou au moins égale à leur valeur & n’y
ayant plus,de profit, il n’y a plus de motifs de
fuivre la méthode. Le problème confifteroit donc
a trouver un moyen d’élever dans nos climats des
P0UJJîns nés artificiellement, de manière que les
poulets euffent une valeur fuffifante au-deffus de la
dépenfe qu’ils- auroient coûtée.
OE u f . ( Auteurs qui ont décrit les oeufs des
diffèrens oifeaux. )
■ k.a pluPart auteurs en traitant des différens
oifeaux, ont parlé de la manière dont ils conf-
truifent leur nid , des matières qu’ils y emploient,
du nombre , de la forme , des couleurs des oeufs ,
du temps que dure l’incubation., des foins que
les pères &. mères prennent de leurs petits* Ce-
pendant ces divers objets ne font pas toujours
traites avec l ’etendue dont ils font lufceptibles,
& ce que la plupart des auteurs ont dit à cet égard
laiffe beaucoup à defirer. C ’eft une partie de l’ornithologie
qui. eft encore imparfaite , & qui a
befoin^ d’addition fur-tout par râport aux efpèces
étrangères ; c’eft donc un, fujet fur lequel les
voyageurs peuvent s’exercer , & qu’eux feuls
peuvent remplir. Nous avons cependant un traité
compofé fur une partie de ces objets, mais qui
ne contient que ce qui eft relatif aux oifeaux d’Europe.
Cet ouvrage,, écrit en italien, compofé
par le comte Zinani de Ravenne, & imprimé à
Venife en 17 3 7 , forme un volume i/z-40, orné
de planches gravées , d’une très-belle exécution.
L auteur, après un difcours préliminaire ,. divife
les oifeaux en trois claffes, celle des oifeaux de
terre qui ne font pas oifeaux de rapine ; celle des
oifeaux egalement de terre. , mais' qui font en
même temps de rapine , & enfin celle des oifeaux
d ’eau.
La première claffe eft divifée en neuf ordres ;
la fécondé en fept, Sc la dernière en quatre.
Quant au detail, l’auteur indique le nombre des
pontes dans un été , les mois où elles ont lieu , la
manière dont l’oifeau conftruit fon n id , les matières
qu’il y emploie, le nombre des oeufs qu’il
y depofe , & dont il décrit fort exactement la
forme & les couleurs. Mais il n’apprend pas le
temps que dure l’incubation ; il ne parle point
dès petits , de leur plumage , du temps qu’ils font
à croître, de la manière dont les pères & mères
les nourriffent ; ainfi ces objets importans font
autant' d’addition à faire à fon ouvrage , pour -lui
procurer la perfeûion dont il eft iufceptible &
qui lui manque.
Le comte Zinani ne fait , pas non plus la defcription
des oifeaux, du nid defquels il parle ; il
fe borne au nid &. aux oeufs. Le mérite de fon
ouvrage eft d’avoir raffemblé ce qui eft épars dans
les écrits d’ornithologie , & d’y avoir ajouté un
allez grand nombre de defcriptions.
OIE.
P I. enl. 9 8 5.
Oye domeflique. B R is s . tom. V , -pl. 262, genre
CVÎ.
Oye privée. B e l . hifi. nat. des oif. pag. 15 6 , fig.
Paë- * 57; * . : ' . *
Oye, jars. B e l .^ o« . d ’oif. pag. 31«
Aufer en Latin.;
Ganfo pato en Efpagnol ;
Oc h a , papara, pavara en Italien ;
Zame gnns,.ganfer, &c. en Allemand;
Ges, gafior en Polonois ;
Goas en Suédois ;
Goofe y gofe, tarne gooffe en Anglois.
Oye fauvage. B r i s s . tom. V s pag. 265.
Idem. B e l . hifi. nat. des oif. pag. 158.
Aufer fé ru s, aufer fylveflris en Latin.
Quoique Y oie foit affez connue pour n’avoir pas
befoin d’être décrite, il eft à propos de faire remarquer
quels font les caraâères qui la diftinguent,
afin qu’on puiffe raporter à fon genre toutes les
efpèces qui y font fubordonnées.
-L’oie a pour caractères::
Quatre doigts, dont les trois antérieurs font
joints enfemble par des membranes entières & le
poftérieur eft féparé.
Les jambes avancées vers le milieu du corps,
hors de l’abdomen &plus courtes que le corps.
Le bec dentelé comme une lime, convexe en-
deffus & applati en-deffous, aufli épais que la rg e,
ayant le bout onguituclé :& obtus.
Enfin, la partie «inférieure des jambes dégarnie
de plumes lei<3?>igt intérieur armé d’une petite
membrane dans toute la longueur de fon côté
intérieur.
Si l’on compare ces caraétères avec ceux du
canard, on trouvera qu’il n’y a de différence que
dans le bec, aufli épais qu’il eft large dans l’oie , &
plus large qu’il n’eft épais dans le canard.
On doit donc obferver avec foin ce feul caractère
diftinétif entre des oifeaux qui fe reffemblent
d’ailleurs par l’habitude totale de tout le corps,& qui
ne*diffèrent, fous d’autres points de vue , qu’en ce
que les efpèces dé oies font en général plus groffes
que celles qui fe raportent au genre du canard.
Uoie domeflique eft un gain que nous avons fait
fur Tefpèce fauvage , en lui offrant un alyie & un
traitement qui en a fixé des individus auprès, de
nous ;e lle eft trop connue pour la décrire; j’obferverai
feulement que fon plumage eft le plus
ordinairement tout blanc, quelquefois tout gris ,
& fouvent varié de ces deux couleurs par larges
plaques ; il y -a , dans cette race, une variété qui
coniifte en ce que les plumes du fommet de la tête
font alongées & forment une huppe. Cette -variété
a été décrite par M. Briffon, tom. V I , pag. 265 ,
fous le nom d’oie huppée.
Voie fauvage eû. plus petite que Voie domeflique :
la partie fupérieure de la tête eft d’un cendré-brun ;
le derrière du cou & le deffus du corps de cette
même couleur ; mais chaque plume eft bordée
d’un cendré-brun plus clair ; les joués, le devant
du cou & la partie antérieure du dëffous du corps
font d’un gris-blanchâtre ; le bas-ventre & les couvertures
du deffus & du deffous de là queue font
d’un blanc décidé pies plumes des cotés, les couvertures
du deffus des ailes font d’un brun bordé
de blanchâtre ; les dix premières pennes de l’aile
font grifes du côté .extérieur dans leurs deux premiers
tiers &. noirâtres dans le dernier ; les onze
fuivantes font grifes du côté extérieur & les fix
plus proches du corps font colorées comme le
dos ; les feize pennes intermédiaires de la queue
font noirâtres, bordées de blanc du côté extérieur
& par le bout ; la plus extérieure de chaque côté eft
entièrement blanche ; l’iris eft rougeâtre ; le bec
eft noirâtre de fon origine à la moitié de fa longueur
; il eft enfuite d’un jaune de fafran & terminé
de noir : la partie nue des jambes, les pieds, les
• doigts & leurs membranes font d’un jaune-orangé ;
les ongles noirâtres.
On v o it , par cette defcription , que l’efpèce de
l ’oie j comme celle du cygne , eft devenue plus
grande dans l’état de domefticité ; mais que moins
fortement conftituée, elle a plus perdu des cou-*
leurs de fon plumage, puifque Voie fauvage eft
brune & que Voie domeflique porte le plus ordinairement
la couleur blanche, qui eft celle de la domefticité
; les autres différences confiftent dans la
couleur du bec & dans celle des pieds, qui ne font
jaunes que dans les jeunes oies domefliques, rouges
dans les vieilles & jaunes à tout âge dans les oies
fauvagest
Voie domeflique étant celle * qui nous intéreffe
davantage, c’eft de fon hiftoire que nous nous-
occuperons d’abord. On peut l’élever dans la
baffe-cour avec les autres volailles ; mais , de
cette façon, on ne fçauroit guère nourrir qu’une-
petite quantité déoies ; pour tirer de cette efpèce
tout l’avantage qu’elle peut procurer & en former
de nombreufes troupes , il faut placer les oies près,
des eaux & à la portée de quelque rivage ; il' faut
quelles puiffent prendre leurs ébats fur un terreirr.
vague & paître l’herbe: car elles fe nourriffent
également & de grain & de plantes qu’elles- pâturent
; mais on a foin de les tenir éloignées des-
prairies & des terres enfemencées en blé ,. parce
que leur fiente eft brûlante & defsèche l’herbe;,
qu’elles coupent d’ailleurs les plantes trop près, dé