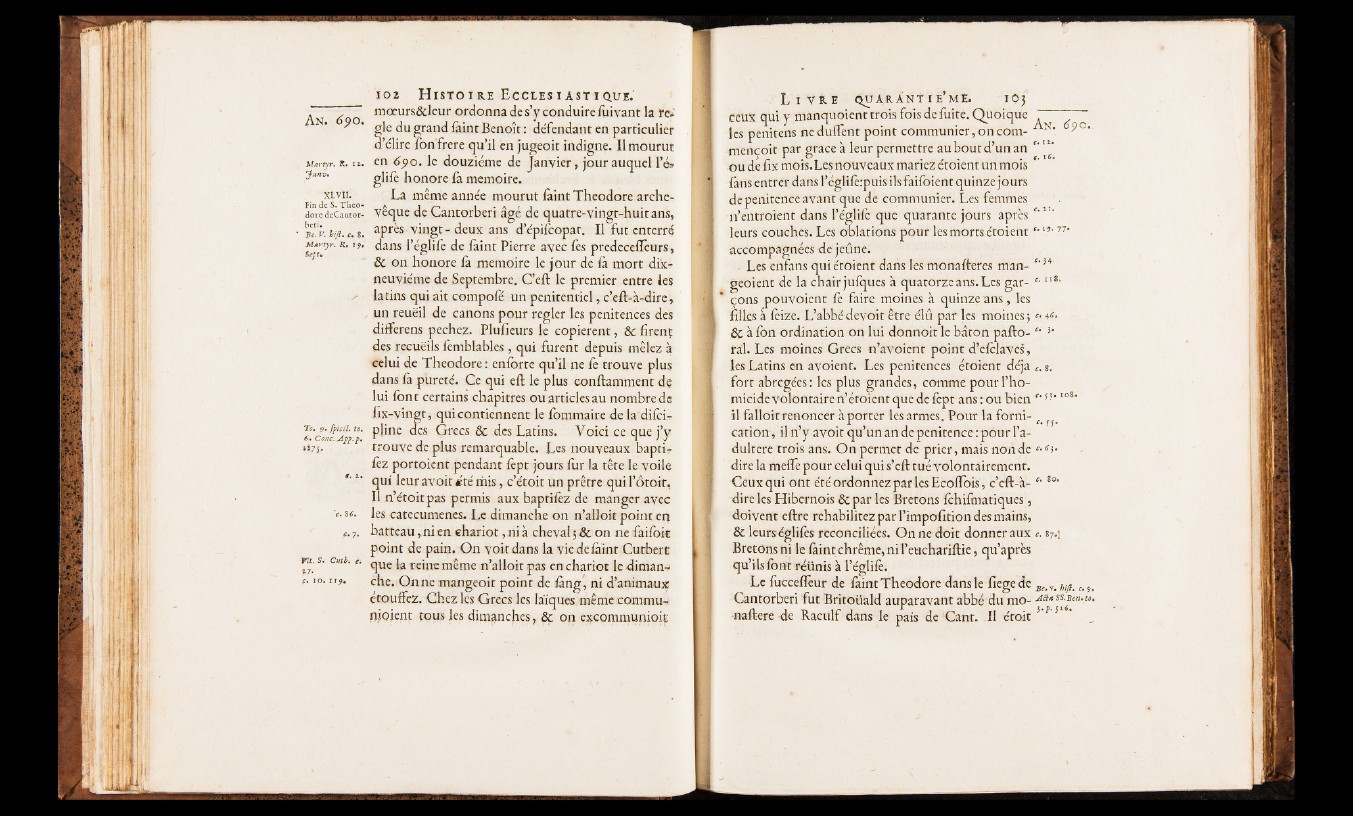
An. 690.
Martyr. R# iî.»
Janv.
XLVII.
Fin de S. Théodore
deCaotor-
beri.
Be. V. hift. c. 8.
Martyr. R, 15*
Sep»
To. 9. fpicil. to.
6. Conc. A p . p
mm
$. £•
c. u .
c. 7.
Vit. S. Cutb. c. 17-
ç. 10. 1 19.
102 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .'
moeurs&leur ordonna de s’y conduire fuivant la le*'
gle du grand iàint Benoît : défendant en particulier
d’élire fonfrere qu’il en jugeoit indigne. Il mourut
en 69 o. le douzième de Janvier, jour auquel l’é»
glife honore ià mémoire.
La même année mourut iàint Théodore archevêque
de Cantorberi âgé de quatre-vingt-huit ans,
après vingt - deux ans d’épifcopat. Il fut enterré
dans l’égliiè de iàint Pierre avec fes predeceiïèurs,
& on honore là mémoire le jour de ià mort dix-
neuviéme de Septembre. C’eft le premier entre les
latins qui ait compofé un penitentiel, c’eft-à-dire,
un reuëil de canons pour regler les penitences des
differens pechez, Plufieurs le copièrent, & firent
des recueils femblables , qui furent depuis mêlez à
celui de Théodore : enlorte qu’il ne iè trouve plus
dans ià pureté. Ce qui eft le plus conftamment de
lui font certains chapitres ou articles au nombre de
iîx-vingt, qui contiennent le fotnmaire de la diici-
pline des Grecs & des Latins. Voici ce que j’v
trouve de plus remarquable. Les nouveaux bapti-
ièz portoient pendant fept jours fur la tête le voile
qui leur avoit été mis, c’étoit un prêtre qui l’ôtoit,
Il n’étoit pas permis aux baptiièz de manger avec
les catecumenes. Le dimanche on n’ailoit point en
batteau, ni en chariot, ni à cheval 5 &c on ne faifoit
point de pain. On voit dans la vie de iaint Cutbert
que la reine même n’alloit pas en chariot le dimam»
che. On ne mangeqit point de lâng', ni d’animaux
étouffez. Chez lés Grecs les laïques, même commu-
nioient tous les dimanches, & 011 excommunioit
L l V f c É q u a d r a n t 1 é’ m ê . i 0 3
Céüx qui y manquoient trois fois de fuite. Quoique 7 ~
les penitens ne dullènt point communier, on com- N‘ 9 ° '
mençoit par grâce à leur permettre au bout d’un an £' “ ‘
ou de fix mois.Les nouveaux mariez étoient un mois
I fans entrer dans l’églife:puis ils faifoient quinze jours
1 de penitence avant que de communier. Les femmes
I n’entroient dans l’églife que quarante jours après
leurs couches. Les oblations pouf les morts étoient t*l,> 77‘
1 accompagnées de jeûne.
. Les enfans qui étoient dans les monafteres man- i-54
g geoient de la chair juiques à quatorze ans. Les gar- '• II8-
cons pouvoient fè faire moines à quinze ans, les
filles à ièize. L’abbé devoit être élû par les moines 5c- 4ff.
ôç àfon ordination on lui donnoitle bâton pafto- ” }'
ràl. Les moines Grecs n’avoient point d’eiclaves,
les Latins en avoient. Les penitences étoient déjà c. g.
fort abrégées : les plus grandes, comme pour l’homicide
volontaire n’étoient que de ièpt ans : ou bien c' s-' Io8‘
il falloit renoncer à porter les armes. Pour la forni- c sJ_
cation, il n’y avoit qu’un an de penitence : pour l’a-
dultere trois ans. On permet de prier, mais non de c-6î’
dire la melïê pour celui qui s’eft tué volontairement.
Ceux qui ont été ordonnez par les Ecoiïois, c’eft-à- £’ 83‘
dire les Hibernois & par les Bretons ichifmatiques,
doivent eftre rehabilitez par l’impoiltion des mains,
& leurs égliiès reconciliées. On ne doit donner aux c. 87.]
Bretons ni le iàint chrême, ni l’euchariftie, qu’après
qu’ils font réünis à l’égliïè.
Le fiicceiïcur de iàint Théodore dans le ilegede ^
Cantorberi fut Britoüald auparavant abbé du mo- -¿s* **•»«»•.»>•
naftere de Raculf dans le pais deCant. Il e'toit ’ ' ‘ _