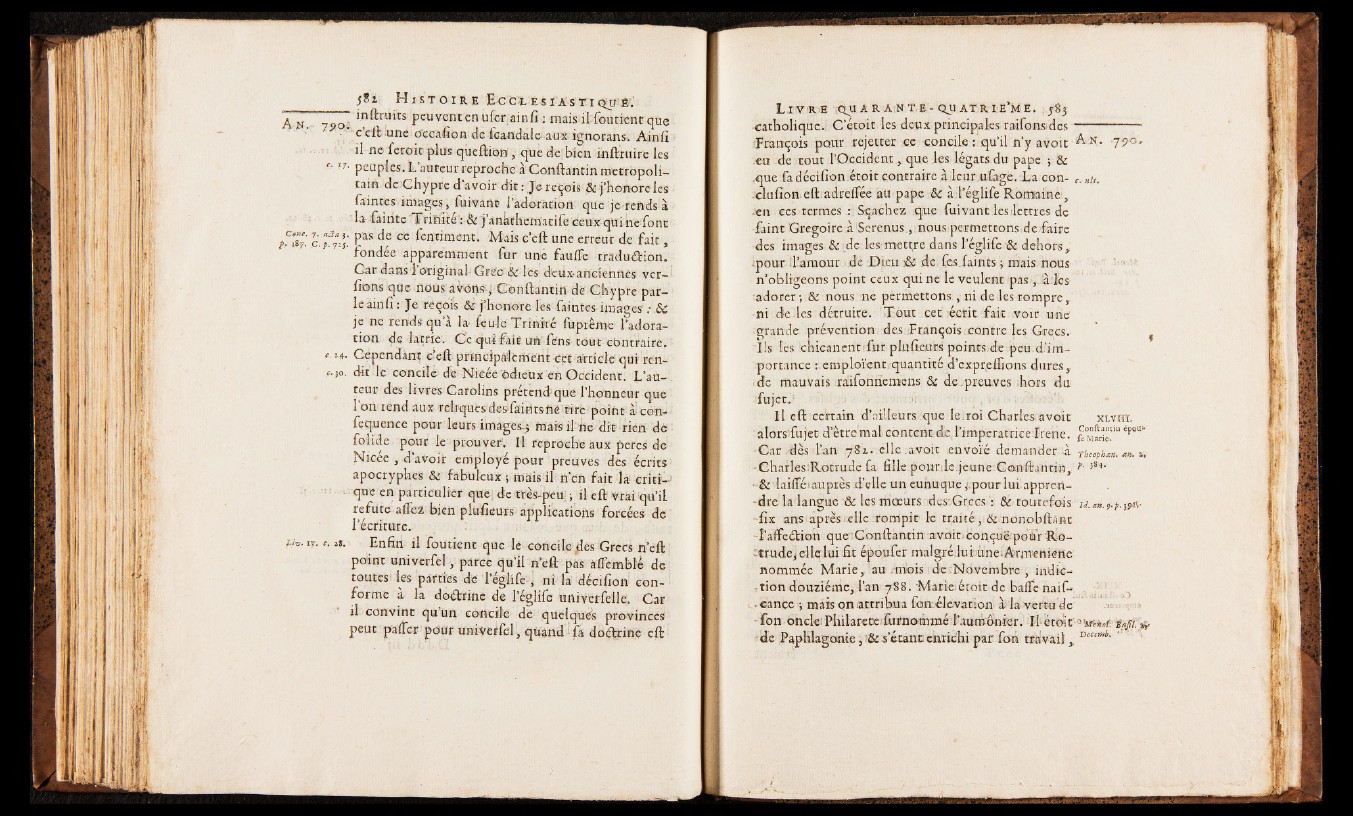
A n .-
Cene.
g 1,87.
581 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q n ê.
i.nftrüits peuvent en ufer ainfi : maisdl: fout,«air qûç
c eft. une : tfecafioû de ièamdal&' aux ign of ans-. Aànii
il ne fcroit plus queftioh , que de bien inftruire les
c- 1 peuples. L auteur reproche àCon ftantin métropolitain
d eC h y p te d a voir dit : J ereçois & j’honore les
fa'intes images, fuivanc l ’adoration que je rends à
lar fairite -T r i f i i t e j ’anktheïn'atife ceux qui ne fo nt
' r 7» j Pas % ce Îcû'fitoent. Mais c’eft une erreur de f a i t ,
fondée apparemment fur une fauflfe traduction.
Car dans i original- Gre'o & les de u x a n ci e n ne s v e r - !
fions que nous a v où sC o n fta n tir i- de Chypre parle
ainfi : Je reçois & j’honore les fâintes images : .&
je ne rends qu à la feule Trinité' fuprême l ’adoration
de latrie. Ce qu-i fiut un l'eus tour contraire.
*■ Sj§ Cependant c‘eft- princdpMèment-cpt airticle' qüf ren-
c.jo. dit le concile de Nïèéê odieux en Occident. L’aû-,
teur des livres Garolins prétend- que l'honneur que
l ’on rend aux reliques desTâiritsËè ^fré-point a corn-
fequence pour leurs images-; mate il ne dit rien de
folide pour le prouver. Il reproche aux peres de
Nicée , d’avoir employé pour preuves dès écrits
apocryphes & fabuleux ; maisdl n’en fajt la criti--
que en particulier que; de très-peu ; il eft Vrai qu’il
réfute aiüx bien plufieurs applications forcées de
l ’écriture.
'• g Enfin il foutient que le concile dés-Grecs n’eft
point univerfèl , parce qu’il n’eft pas aflèmblé de
toutes les parties de l’eglife , ni la décifion con- ;
forme à la doétfine de l’églife uttiverfelle. Car
il convint quun concile de quelques provinces
peut palier pour univerfel, quand la doctrine eft
L. r v R i E î«£u A R A N $ $ - Q-u A ’î ’ R i e ’m e . ;
catholique.: C ’étoit les deux principales raifonsides------------- •
•François pour, rejetter ee concile : qu’il n’y avoir ^ N- 7 ^ ° '
eu de tout l’Occident, que les légats du pape ; &
.que :fa déci-iion.étoit,contraire à leur ufage. ;La con- c. Uu,
clufion eft adrelfée au pape & à l’églife Romaine:,
-en ces termes : Sçachez que fui va nt les .'lettres de
-faint Grégoire à Serenus.,.nous permettons.de.-faire
des images & Lde les mettre dans l’eglife & dehors,
.pour il amour de :E)teu :& de fesTaints -f mais nous
n’obligeons point ceux qui ne le veulent pas, à les
adorer; Sr nous me permettons , ni de les rompre,
ni dedes détruire. Tout cet .écrit fait voir une
grande prévention des-¡François contré les Grecs».
Ils les Chicanent 1 fur plufieurs poincs.de peu d’importance
emploient .-quantité d’expreffions dures,
de mauvais raifonriemens & de preuves hors du
fujet. - , M
Il eft certain d’ailleurs .que roi Charles avoit xLVfit.
alorsîfujet d’être mal contentde l’imperatricelrene. époUi
Car dès l’an 781. elle.avoit envoie demander a Q nR r «. *
-CharlesiRotrude Ca fille pour: le. je une Confia n tin, p- î84-
• & laifTé:auprès d’elle un eunuque ¿pour lulappreri-
-dre k langue & les moeurs dçssGrecsd: & toutefois
dix ans après ..elle rompit le traité, & nonobihnt
-l’affedtioh queiConftantin Avxiit.conçuepoÈfr R o -
¿trodé; elle lui fit époufer malgré lui ime.Armeniéiic
nommée Marie, au mois de .Novembre , indicé
-tion douzième,;ian 788. Maric.étoit de bafle naif--, 1
Qcançe ; mais on ¡at tribua fertélevation ila-vertu de" .n .
- Fon oncle! Philarece:ïurnooemé 1: aum^finier. Il- êtes *
<Üc Paphlagonie j ’& s ’étancenrichi par fon travail, D,cemK ''