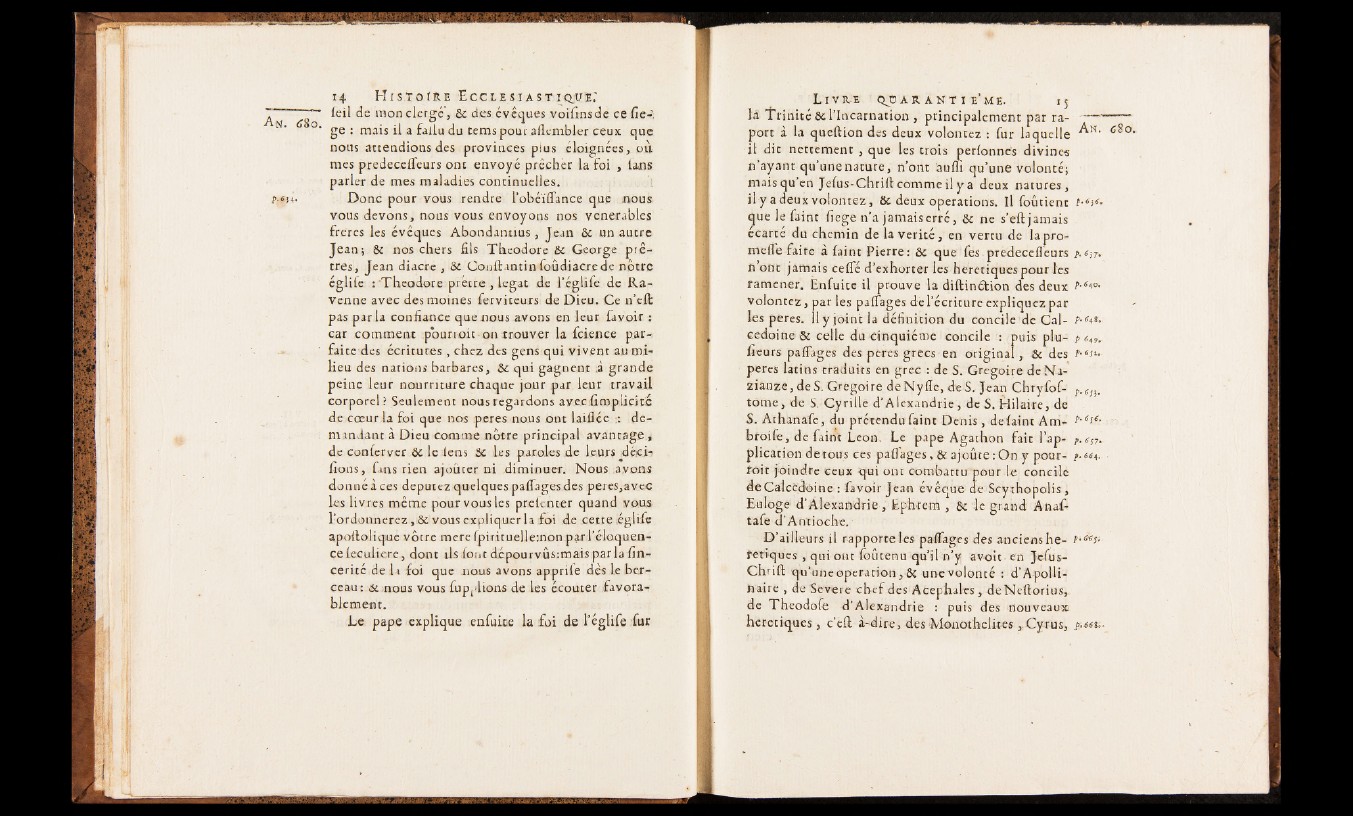
I f l
I f g
I
'
An. 6&o.
P U 4-
14 H i s t o i r e E c c i b s i a s t i q j Uîe;
feil de mon clergé , 6c des évêques voifinsde ce fie-,
ge : mais il a fallu du tems pour aflembler ceux que
nous attendions des provinces plus éloignées, pii
mes predeceffeurs ont envoyé prêcher la foi , lans
parler de mes maladies continuelles.
Donc pour vous rendre l'obéïflance que nous
vous devons, nous vous envoyons nos venerables
frères les évêques Abondantius, Jean ôc un autre
Jean; ôc nos chers fils Théodore ôc George p iè tres,
Jean diacre , ôc Conftantinfoûdiacrede nôtre
églife : Théodore prêtre , légat de l’égljfe de Ra-
venne avec des moines ferviteurs de Dieu. Ce n’efl;
pas parla confiance que nous avons en leur fayoir :
car comment pouri oit -on .trouver la fcienc.e parfaite
des écritures , chez des gens qui vivent au milieu
des nations barbares, & qui gagnent à grande
peine leur nourriture chaque jour par leur travail
corporel ï Seulement nous regardons avec (implicite
de coeur la foi que nos peres nous ont laiflée demandant
à Dieu comme nôtre principal avantage *
de conierver ôc le iens 5e les paroles de leurs déci-
fions , fans rien ajoûter ni diminuer. Nous .ayons
donné à ces députez quelques palTages des peres,avec
les livres même pour vous les prelenter quand vous
^ordonnerez, ôc vous expliquer la foi de cette ¡églife
apostolique vôtre mere fpirituelle:non par l’éloquence
ieculicre, dont ils dont dcpourvûsimais par la fin-
cerité de la foi que nous avons apprife dès le berceau
: ôc nous vous fupplions de les écouter favorablement.
Le pape explique enfuite la fo i de l’églife fur
L ivrée q o a r a n t i e ’ m e . 15
l i Trinité ôc l’Incarnation , principalement par ra- — ------
port à la queftion des deux volontez : fur laquelle ^ N’ 680
il dit nettement , que les trois perlonnes divines
n'ayant qu’une nature, n’ont auffi qu’une volonté;
mais qu en Jefus-Chriif comme il y a deux natures,
il y a deux volontez, & deux opérations. Il foûtient Mjuque
le faint fiege n’a jamais erré, ôc ne s’eft jamais
écarté du chemin de la vé r ité , en vertu de lapro-
mefle faite a faint Pierre: ôc que fes predecefleurs p.e¡7*
n’ont jamais celle d’exhorter les heretiques pour les
ramener. Enfuite il prouve la diftinôtion des deux
volontez, par les paflages de l'écriture expliquez par
les peres. Il y joint la définition du concile de Cal- t-6+*-
cedoinéôc celle du cinquième concile : puis plu- p
fieurs paflages des pères grecs en original, ôc des Réopérés
latins traduits en grec : de S. Grégoire deNa-
ziânze, de S. Grégoire de Ny Ile, de S. Jean Chryfof-
tome, de S. Gyrille d’Alexandrie, de S. Hilaire, de
S. Arhanafc, du prétendu faint Denis, de faint Am-
btoife, de faint Léon. Le pape Agachón fait l’ap- /. ¿J7.
plication de tous ces paflages, & ajoute : On y pour- p• «¿4.
foie joindre ceux qui ont combattu pour le concile
de Calcédoine : favoir Jean évêque de Scythopolis,
Eulôgè d’Alexandrie , Ep'hrern , ôc le grand Anaf-
tafe d’Antioche.
D ’ailleurs il rapporte les paflages des anciens he- t'* r -
fetiques, qui ont ioûtenu qu’il n ’y av-oit en Jefus-
Chriffc qu'un e opération, ôc une volonté : d’Apollinaire
, de Severe chef des Acéphales, deNeltorius,
de Theodofe d ’Alexandrie : puis des nouveau*
heretiques, c’eil à-dire, des Monothelit-es ,C y ru s ,