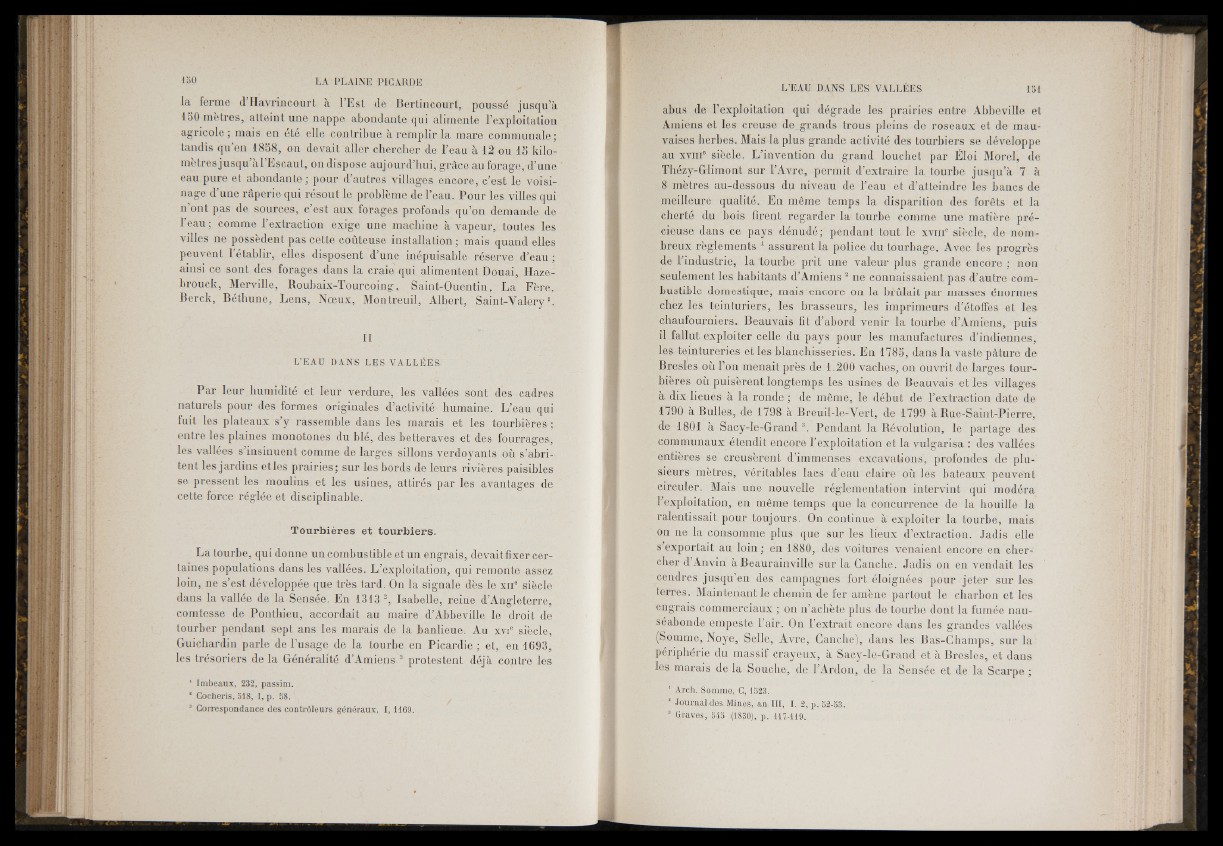
la ferme d’Havrincourt à l’Est de Bertincourt, poussé jusqu’à
■150 mètres, atteint une nappe abondante qui alimente l ’exploitation
agricole; mais en été elle contribue à remplir la mare communale;
tandis qu’en 1858, on devait aller chercher de l’eau à 1 2 ou 15 kilomètres
jusqu’à l ’Escaut, on dispose aujourd’hui, grâce au forage, d’une
eau pure et abondante ; pour d’autres villages encore, c’est le voisinage
d une râperie qui résout le problème de l’eau. Pour les villes qui
n’ont pas de sources, c’est aux forages profonds qu’on demande de
l’eau ; comme l’extraction exige une machine à vapeur, toutes les
villes ne possèdent pas cette coûteuse installation; mais quand elles
peuvent l’établir, elles disposent d’une inépuisable réserve d’eau ;
ainsi ce sont des forages dans la craie qui alimentent Douai, Haze-
brouck, Merville, Roubaix-Tourcoing, Saint-Quentin, La Fère,
Berck, Béthune, Lens, Noeux, Montreuil, Albert, Saint-Valery1.
I I
L’EAU DANS LES VALLÉES
Par leur humidité et leur verdure, les vallées sont des cadres
naturels pour des formes originales d’activité humaine. L’eau qui
fuit les plateaux s’y rassemble dans les marais et les tourbières ;
entre les plaines monotones du blé, des betteraves et des fourrages,
les vallées s’insinuent comme de larges sillons verdoyants où s’abritent
les jardins etles prairies; sur les bords de leurs rivières paisibles
se pressent les moulins et les usines, attirés par les avantages de
cette force réglée et disciplinable.
Tourbières et tourbiers.
La tourbe, qui donne un combustible et un engrais, devait fixer certaines
populations dans les vallées. L ’exploitation, qui remonte assez
loin, ne s’est développée que très tard. On la signale dès le xne siècle
dans la vallee de la Sensée. En 1313 2, Isabelle, reine d’Angleterre,
comtesse de Ponthieu, accordait au maire d’Abbeville. le droit de
tourber pendant sept ans les marais de la banlieue-. Au xvie siècle,
Guichardin parle de l’usage de la tourbe en Picardie; et, en 1693,
les trésoriers d e là Généralité d’Amiens 3 protestent déjà contre les
‘ Imbeaux, 232, passim.
2 Cocheris, 518, I, p. 58.
3 Correspondance des contrôleurs généraux, 1 ,1169.
abus de l’exploitation qui dégrade les prairies entre Abbeville et
Amiens et les creuse de grands trous pleins de roseaux et de mauvaises
herbes. Mais la plus grande activité des tourbiers se développe
au xvme siècle. L’invention du grand louchet par Ëloi Morel, de
Thézy-Glimont sur l’Avre, permit d’extraire la tourbe jusqu’à 7 à
8 mètres au-dessous du niveau de l’eau et d’atteindre les bancs de
meilleure qualité. En même temps la disparition des forêts et la
cherté du bois firent regarder la tourbe comme une matière précieuse
dans ce pays dénudé; pendant tout le xviii8 siècle, de nombreux
règlements 1 assurent la police du tourbage. Avec les progrès
de l’industrie, la tourbe prit une valeur plus grande encore ; non
seulement les habitants d’Amiens 2 ne connaissaient pas d’autre combustible
domestique, mais encore on la brûlait par masses énormes
chez les teinturiers, les brasseurs, les imprimeurs d’étoffes et les
chaufourniers. Beauvais fit d’abord venir la tourbe d’Amiens, puis
il fallut exploiter celle du pays pour les manufactures d’indiennes,
les teintureries etles blanchisseries. En 1785, dans la vaste pâture de
Bresles où l’on menait près de 1.200 vaches, on ouvrit de larges tourbières
où puisèrent longtemps les usines de Beauvais e tle s villages
à dix lieues à la ronde ; de même, le début de l’extraction date de
1790 à Bulles, de 1798 à Breuil-le-Vert, de 1799 à Rue-Saint-Pierre,
de 1801 à Sacy-le-Grand3. Pendant la Révolution, le partage des
communaux étendit encore l’exploitation et la vulgarisa : des vallées
entières se creusèrent d’immenses excavations, profondes de plusieurs
mètres, véritables lacs d’eau claire où les bateaux peuvent
circuler. Mais une nouvelle réglementation intervint qui modéra
l’exploitation, en même temps que la concurrence de la houille la
ralentissait pour toujours. On continue à exploiter la tourbe, mais
on ne la consomme plus que sur les lieux d’extraction. Jadis elle
s’exportait au loin; en 1880, des voitures venaient encore en chercher
d Anvin à Beaurainville sur la Canche. Jadis on en vendait les
cendres jusqu’en des campagnes fort éloignées pour jeter sur les
terres. Maintenant le chemin de fer amène partout le charbon et les
engrais commerciaux ; on n’achète plus de tourbe dont la fumée nauséabonde
empeste l ’air. On l ’extrait encore dans les grandes vallées
(Somme, Noye, Selle, Avre, Canche), daos les Bas-Champs, sur la
périphérie du massif crayeux, à Sacy-le-Grand et à Bresles, et dans
les marais de la Souche, de l’Ardon, de la Sensée et de la Scarpe ;
* Arch. Somme, C, 1523.
2 Journal des Mines, an III, I. 2, p. 52-53.
3 Graves, 545 (1830), p. 117-119.