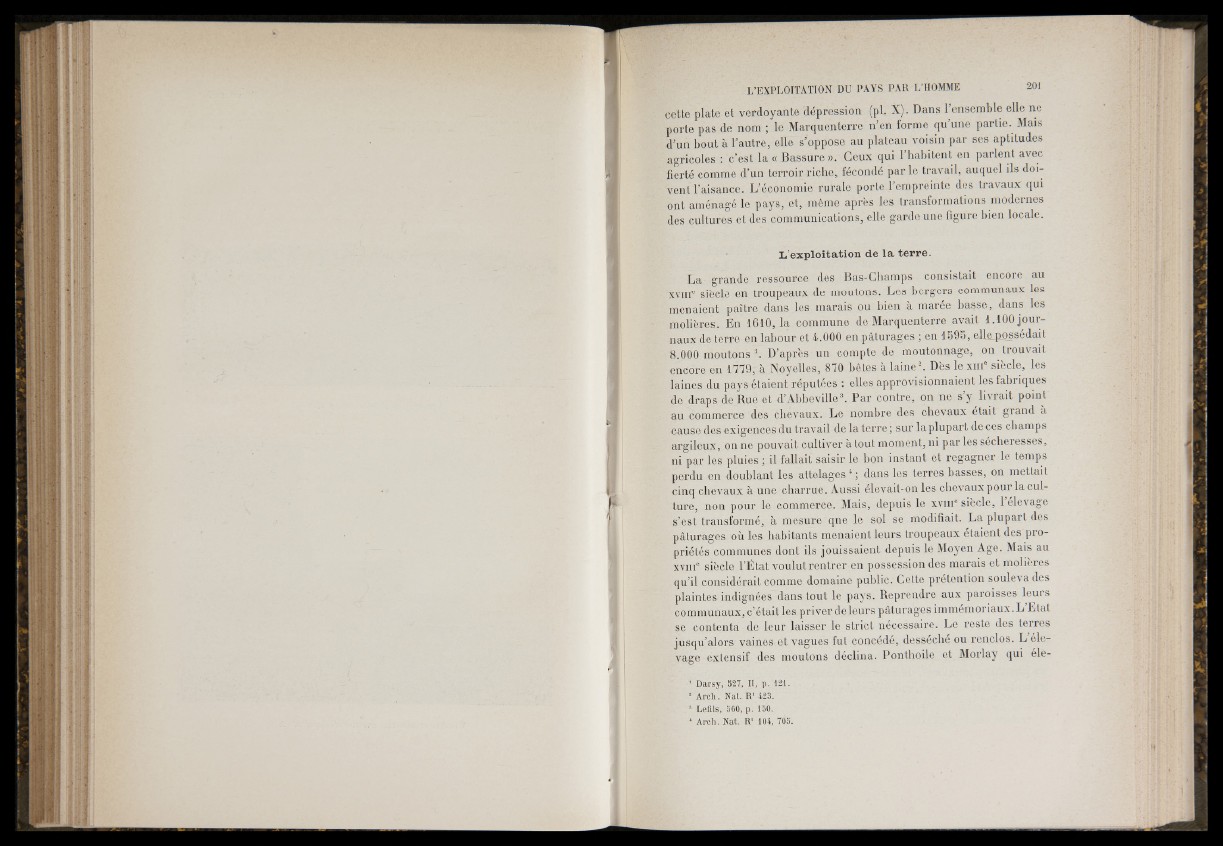
cette plate et verdoyante dépression (pl. X). Dans 1 ensemble elle ne
porte pas de nom ; le Marquenterre n’en forme qu’une partie. Mais
d’un bout à l’autre, elle s’oppose au plateau voisin par ses aptitudes
agricoles : c’est la « Bassure ». Ceux qui l’habitent en parlent avec
fierté comme d’un terroir riche, fécondé par le travail, auquel ils doivent
l’aisance. L’économie rurale porte l’empreinte des travaux qui
ont aménagé le pays, et, même après les transformations modernes
des cultures et des communications, elle garde une figure bien locale.
L ’e x p lo it a t io n d e l a t e r r e .
La grande ressource des Bas-Champs consistait encore au
x v i i i 6 siècle en troupeaux de moutons. Les bergers communaux les
menaient paître dans les marais ou bien à marée basse, dans les
molières. En 1610,1a commune de Marquenterre avait 1.100 journaux
de terre en labour et 4.000 en pâturages ; en 1595, ellejpossédait
8.000 moutons L D’après un compte de moutonnage, on trouvait
encore en 1779, à Noyelles, 870 bêtes à laine2. Dès le xme siècle, les
laines du pays étaient réputées : elles approvisionnaient les fabriques
de draps de Rue et d’Abbeville8. Par contre, on ne s’y livrait point
au commerce des chevaux. Le nombre des chevaux était grand à
cause des exigences du travail de la terre; sur la plupart de ces champs
argileux, on ne pouvait cultiver à tout moment, ni par les sécheresses,
ni par les pluies ; il fallait saisir le bon instant et regagner le temps
perdu en doublant les attelages4; dans les terres basses, on mettait
cinq chevaux à une charrue. Aussi élevait-on les chevaux pour la culture,
non pour le commerce. Mais, depuis le xvme siècle, 1 élevage
s’est transformé, à mesure qne le sol se modifiait. La plupart des
pâturages où les habitants menaient leurs troupeaux étaient des propriétés
communes dont ils jouissaient depuis le Moyen Age. Mais au
xvme siècle l’État voulut rentrer en possession des marais et molières
qu’il considérait comme domaine public. Cette prétention souleva des
plaintes indignées dans tout le pays. Reprendre aux paroisses leuis
communaux, c’était les priver de leurs pâturages immémoriaux. L Etat
se contenta de leur laisser le strict nécessaire. Le reste des terres
jusqu’alors vaines et vagues fut concédé, desséché ou renclos. L élevage
extensif des moutons déclina. Ponthoile et Morlay qui ele-
1 Darsy, 527, II, p. 121.
a Arch. Nat. R* 423.
. 3 Leflls, 560, p. 150.
4 Arch. Nat. R* 104, 705.