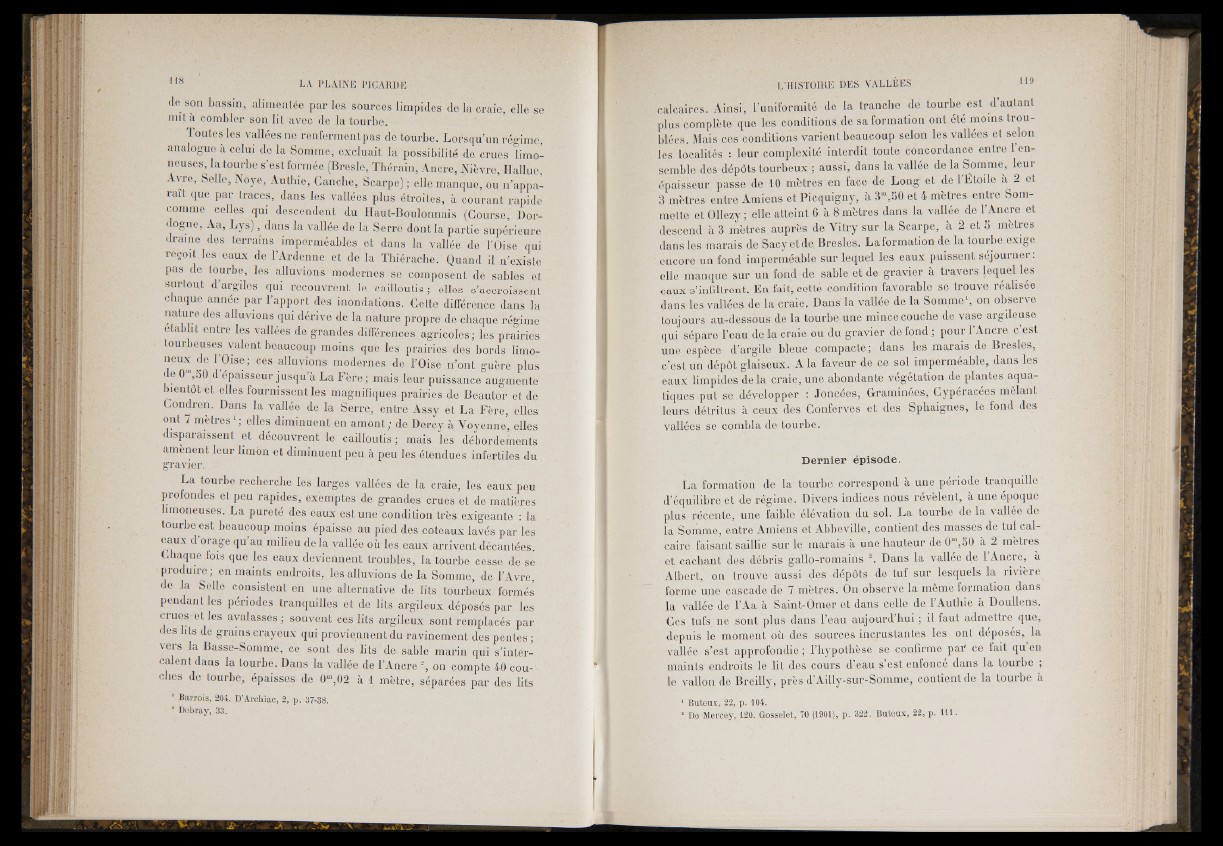
de son bassin, alimentée par les sources limpides de la craie, elle se
mit à combler son lit avec de la tourbe.
Toutes les vallées ne renferment pas de tourbe. Lorsqu’un régime,
analogue à celui de la Somme, excluait la possibilité de crues limoneuses,
la tourbe s’est formée (Bresle, Thérain, Ancre, fièv re , Hallue,
Avre, Selle, Noye, Authie, Canche, Scarpe); elle manque, ou n’appa-
rait que par traces, dans les vallées plus étroites, à courant rapide
comme celles qui descendent du Haut-Boulonnais (Course, Dor-
dogne, Aa, L y s), dans la vallée de la Serre dont la partie supérieure
draine des terrains imperméables et dans la vallée de l’Oise qui
reçoit les eaux de l’Ardenne et de la Thiérache. Quand il n’existe
pas e tourbe, les alluvions modernes se composent de sables et
surtout d’argiles qui recouvrent le cailloutis ; elles s’accroissent
chaque année par l’apport des inondations. Cette dilférence dans la
nature des alluvions qui dérive de la nature propre de chaque régime
établit entre les vallées de grandes différences agricoles; les prairies
tourbeuses valent beaucoup moins que les prairies des bords limoneux
de 1 Oise; ces alluvions modernes de l’Oisé n’ont guère plus
de 0m,50 d’épaisseur jusqu’à La F ère; mais leur puissance augmen te
bientôt"et elles fournissent les magnifiques prairies de Beautor et de
Condren. Dans la vallée de la Serre, entre Assy et La Fère, elles
ont 7 mètres1; elles diminuent en amont; de Dercy à Voyenne, elles
disparaissent et découvrent le cailloutis ; mais les débordements
amènent leur limon et diminuent peu à peu les étendues infertiles du
gravier.
La tourbe recherche les larges vallées de la craie, les eaux peu
profondes et peu rapides, exemptes de grandes crues et de matières
limoneuses. La pureté des eaux est une condition très exigeante : la
tourbe est beaucoup moins épaisse au pied des coteaux lavés par les
eaux d’orage qu’au milieu delà vallée où les eaux arrivent décantées.
Chaque fois que les eaux deviennent troubles, la tourbe cesse de se
produire; en maints endroits, les alluvions de la Somme, de l’Avre,
de la Selle consistent en une alternative de lits tourbeux formés
pendant les périodes tranquilles et de lits argileux déposés par les
crues et les avalasses; souvent ces lits argileux sont remplacés par
des lits de grains crayeux qui proviennent du ravinement des pentes ;
vers la Basse-Somme, ce sont des lits de sable marin qui s’intercalent
dans la tourbe. Dans la vallée de l’Ancre A, on compte 40 couches
de tourbe, épaisses de 0m,02 à 1 mètre, séparées par des lits
4 B a rro is , 204. D’A rc h ia c , 2, p . 37-38.
s D eb ray , 33.
calcaires. Ainsi, l’uniformité de la tranche de tourbe est d’autant
plus complète que les conditions de sa formation ont été moins troublées.
Mais ces conditions varient beaucoup selon les vallées et selon
les localités : leur complexité interdit toute concordance entre l’ensemble
des dépôts tourbeux ; aussi, dans la vallée de la Somme, leur
épaisseur passe de 10 mètres en face de Long et de l’Étoile à 2 et
3 mètres entre Amiens et Picquigny, à 3m,50 et 4 mètres entre Som-
mette et Ollezy ; elle atteint 6 à 8 mètres dans la vallée de l’Ancre et
descend à 3 mètres auprès de Vitry sur la Scarpe, à 2 et 5 mètres
dans les marais de Sacy et de Bresles. La formation de la tourbe exige
encore un fond imperméable sur lequel les eaux puissent séjourner,
elle manque sur un fond de sable et de gravier à travers lequel les
eaux s’infiltrent. En fait, cette condition favorable se trouve réalisée
dans les vallées de la craie. Dans la vallée de la Somme1, on observe
toujours au-dessous de la tourbe une mince couche de vase argileuse
qui sépare l’eau de la craie ou du gravier de fond ; pour l’Ancre c est
une espèce d’argile bleue compacte; dans les marais de Bresles,
c’est un dépôt glaiseux. A la faveur de ce sol imperméable, dans les
eaux limpides de la craie, une abondante végétation de plantes aquatiques
put se développer : Joncées, Graminées, Cypéracées mêlant
leurs détritus à ceux des Conferves et des Sphaignes, le fond des
vallées se combla de tourbe.
D e r n ie r é p is o d e .
La formation de la tourbe correspond à une période tranquille
d’équilibre et de régime. Divers indices nous révèlent, à une époque
plus récenté, une faible élévation du sol. La tourbe de la vallee de
la Somme, entre Amiens et Abbeville, contient des masses de tuf calcaire
faisant saillie sur le marais à une hauteur de 0m,50 a 2 mètres
et cachant des débris gallo-romains 2. Dans la vallée de 1 Ancre, à
Albert, on trouve aussi des dépôts de tuf sur lesquels la rivière
forme une cascade de 7 mètres. On observe la même formation dans
la vallée de l’Aa à Saint-Ümer et dans celle de l’Authie à Doullens.
Ces tufs ne sont plus dans l’eau aujourd’hui ; il faut admettre que,
depuis le moment où des sources incrustantes les ont déposes, la
vallée s’est approfondie ; l’hypothèse se confirme par1 ce fait qu en
maints endroits le lit des cours d’eau s’est enfoncé dans la tourbe ;
le vallon de Breilly, près d'Ailly-sur-Somme, contient de la tourbe à
1 Buteux, 22, p. 104.
s De Mercey, 120. Gosselet, 70 (1901), p. 322. Buteux, 22, p. 111.