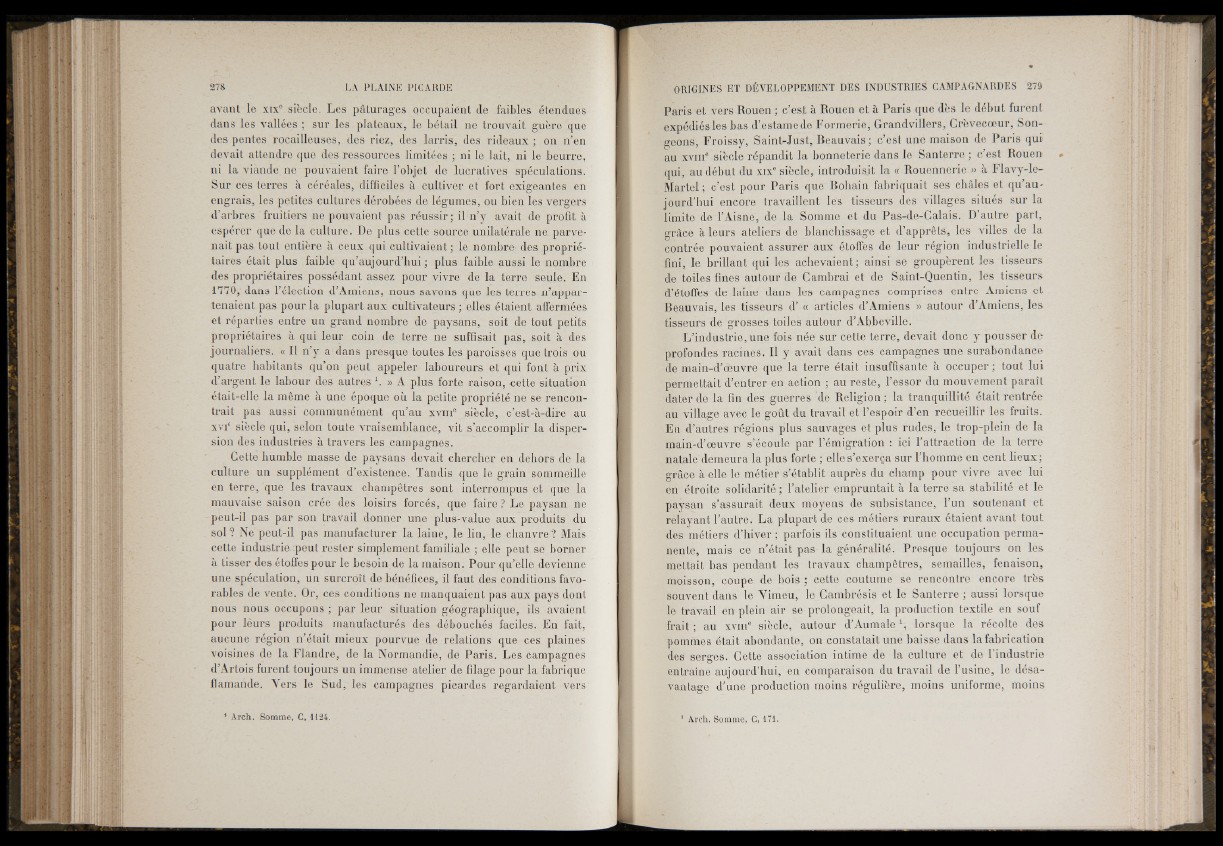
avant le xixe siècle. Les pâturages qccupaient de faibles étendues
dans les vallées ; sur les plateaux, le bétail ne trouvait guère que
des pentes rocailleuses, des riez, des larris, des rideaux ; on n’en
devait attendre que des ressources limitées ; ni le lait, ni le beurre,
ni la viande ne pouvaient faire l’objet de lucratives spéculations.
Sur ces terres à céréales, difficiles à cultiver et fort exigeantes en
engrais, les petites cultures dérobées de légumes, ou bien les vergers
d’arbres fruitiers ne pouvaient pas réussir; il n’y avait de profit à
espérer que de la culture. De plus cette source unilatérale ne parvenait
pas tout entière à ceux qui cultivaient; le nombre- des propriétaires
était plus faible qu’aujourd’hui ; plus faible aussi le nombre
des propriétaires possédant assez pour vivre de la terre seule. En
i770, dans l’élection d’Amiens, nous savons que les terres n’appartenaient
pas pour la plupart aux cultivateurs ; elles étaient affermées
et réparties entre un grand nombre de paysans, soit de tout petits
propriétaires à qui leur coin de terre ne suffisait pas, soit à des
journaliers. «II n’y a dans presque toutes les paroisses que trois ou
quatre habitants qu’on peut appeler laboureurs et qui font à prix
d’argent le labour des autres 1. » A plus forte raison, cette situation
était-elle la même à une époque où la petite propriété ne se rencontrait
pas aussi communément qu’au xvme siècle, c’est-à-dire au
xvie siècle qui, selon toute vraisemblance, vit s’accomplir la dispersion
des industries à travers les campagnes.
Cette humble masse de paysans devait chercher en dehors de la
culture un supplément d’existence. Tandis que le grain sommeille
en terre, que les travaux champêtres sont interrompus et que la
mauvaise saison crée des loisirs forcés, que faire ? Le paysan ne
peut-il pas par son travail donner une plus-value aux produits du
sol? Ne peut-il pas manufacturer la laine, le lin, le chanvre? Mais
cette industrie :peut rester simplement familiale ; elle peut se borner
à tisser des étoffes pour le besoin de la maison. Pour qu’elle devienne
une spéculation, un surcroît de bénéfices, il faut des conditions favorables
de vente. Or, ces conditions ne manquaient pas aux pays dont
nous nous occupons ; par leur situation géographique, ils avaient
pour leurs produits manufacturés des débouchés faciles. En fait,
aucune région n’était mieux pourvue.de relations que ces plaines
voisines de la Flandre, de la Normandie, de Paris. Les campagnes
d’Artois furent toujours un immense atelier de filage pour la fabrique
flamande. Vers le Sud, les campagnes picardes regardaient vers
* Arch. Somme, C, 1124.
Paris et vers Rouen ; c’est à Rouen et à Paris que dès le début furent
expédiés les bas d’estamede Formerie, Grandvillers, Crèvecoeur, Songeons,
Froissy, Saint-Just, Beauvais; c’est une maison de Paris qui
au xvme siècle répandit la bonneterie dans le Santerre ; c’est Rouen
qui, au début du xixe siècle, introduisit la « Rouennerie » à Flavy-Ie-
Martel ; c’est pour Paris que Bohain fabriquait ses châles et qu’a u jourd’hui
encore travaillent les tisseurs des villages situes sur la
limite de l’Aisne, de la Somme et du Pas-de-Calais. D’autre part,
grâce à leurs ateliers de blanchissage et d’apprêts, les villes de la
contrée pouvaient assurer aux étoffes de leur région industrielle le
fini, le brillant qui les achevaient; ainsi se groupèrent les tisseurs
de toiles fines autour de Cambrai et de Saint-Quentin, les tisseurs
d’étoffes de laine dans les campagnes comprises entre Amiens et
Beauvais, les tisseurs d’ « articles d’Amiens » autour d’Amiens, les
tisseurs de grosses toiles autour d’Abbeville.
L’industrie,une fois née sur cette terre, devait donc y pousser de
profondes racines. Il y avait dans ces campagnes une surabondance
de main-d’oeuvre que la terre était insuffisante à occuper ; tout lui
permettait d’entrer en action ; au reste, l’essor du mouvement paraît
dater de la fin des guerres de Religion ; la tranquillité était rentrée
au village avec le goût du travail et l’espoir d’en recueillir les fruits.
En d’autres régions plus sauvages et plus rudes, le trop-plein de la
main-d’oeuvre s’écoule par l’émigration : ici l’attraction de la terre
natale demeura la plus forte ; elle s’exerça sur l’homme en cent lieux;
grâce à elle le métier s’établit auprès du champ pour vivre avec lui
en étroite solidarité; l’atelier empruntait à la terre sa stabilité et le
paysan s’assurait deux moyens de subsistance, l’un soutenant et
relayant l’autre. La plupart de ces métiers ruraux étaient avant tout
des métiers d’hiver; parfois ils constituaient une occupation permanente,
mais ce n’était pas la généralité. Presque toujours on les
mettait bas pendant les travaux champêtres, semailles, fenaison,
moisson, coupe de bois ; cette coutume se rencontre encore très
souvent dans le Vimeu, le Cambrésis et le Santerre ; aussi lorsque
le travail en plein air se prolongeait, la production textile en souf
frait ; au xvme siècle, autour d’Aumale S lorsque la récolte des
pommes était abondante, on constatait une baisse dans la fabrication
des serges. Cette association intime de la culture et de l’industrie
entraîne aujourd’hui, en comparaison du travail de l’usine, le désavantage
d’une production moins régulière, moins uniforme, moins
* Arch. Somme, C, 171.