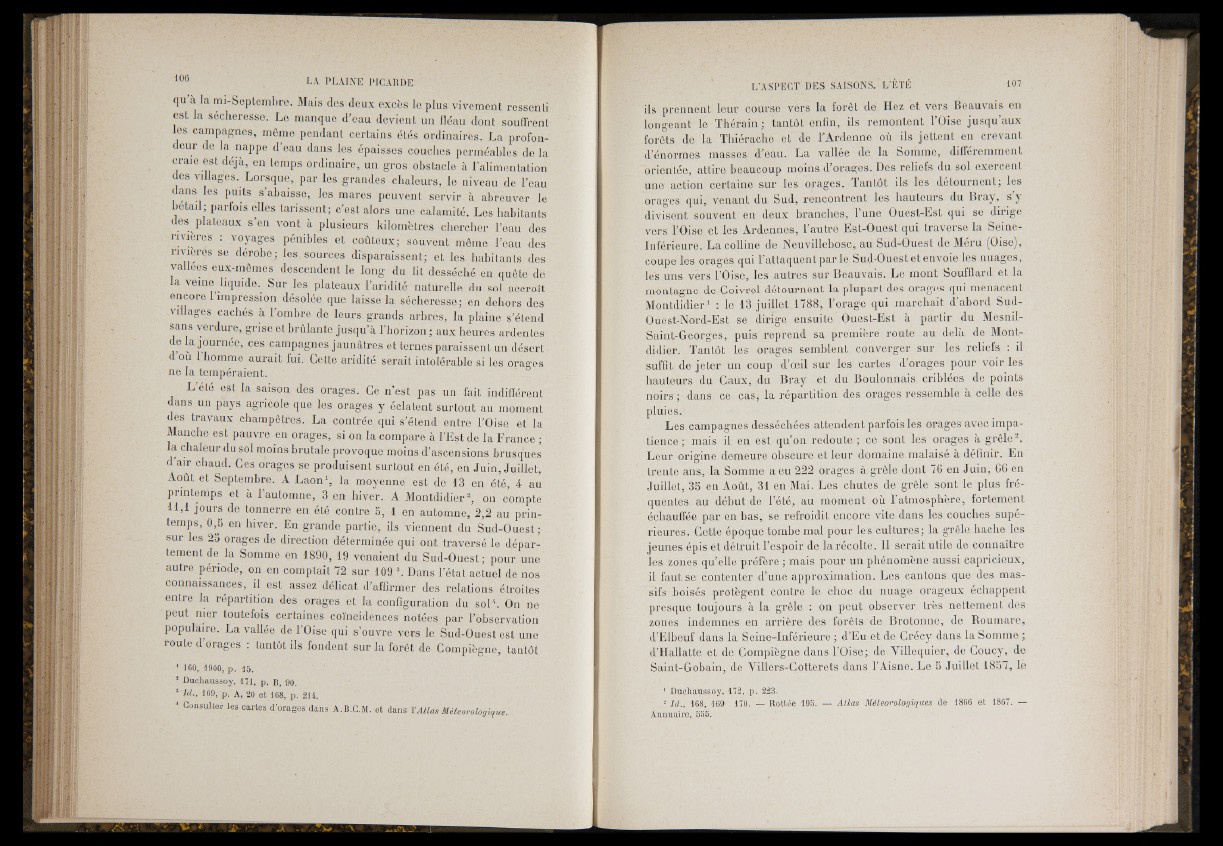
qu’à la mi-Septembre. Mais des deux excès le plus vivement ressenti
est la sécheresse. Le manque d’eau devient un fléau dont souffrent
les campagnes, même pendant certains étés ordinaires. La profondeur
de la nappe d’eau dans les épaisses couches perméables de la
craie est déjà, en temps ordinaire, un gros obstacle à l ’alimentation
des villages. Lorsque, par les grandes chaleurs, le niveau de l’eau
dans les puits s’abaisse, les mares peuvent servir à abreuver le
bétail; parfois elles tarissent; c’est alors une calamité. Les habitants
des plateaux s’en vont à plusieurs kilomètres chercher l’eau des
rivières : voyages pénibles et coûteux; souvent même l’eau des
rivieres se dérobé; les sources disparaissent; et les habitants des
valiees eux-mêmes descendent le long du lit desséché en quête de
la veine liquide. Sur les plateaux l’aridité naturelle du sol accroît
encore l ’impression désolée que laisse la sécheresse; en dehors des
villages cachés à l’ombre de leurs grands arbres, la plaine s’étend
sans verdure, grise et brûlante jusqu’à l’horizon ; aux heures ardentes
e la journée, ces campagnes jaunâtres et ternes paraissent un désert
d’où l ’homme aurait fui. Cette aridité serait intolérable si les orages
ne la tempéraient.
L’été est la saison des orages. Ce n ’est pas un fait indifférent
dans un pays agricole que les orages y éclatent surtout au moment
des travaux champêtres. La contrée qui s’étend entre l’Oise et la
Manche est pauvre en orages, si on la compare à l’Est de la France ;
la chaleur du sol moins brutale provoque moins d’ascensions brusques
d’air chaud. Ces orages se produisent surtout en été, en Juin, Juillet,
Août et Septembre. A Laon1, la moyenne est de 13 en été, 4 au
printemps et à l ’automne, 3 en hiver. A Montdidier2, 011 compte
1 1 , 1 jours de tonnerre en été contre 8, 1 en automne, 2 ,2 au printemps,
0,8 en hiver. En grande partie, ils viennent du Sud-Ouest ;
sur les 28 orages de direction déterminée qui ont traversé le département
de la Somme en 1890, 19 venaient du Sud-Ouest; pour une
autre période, on en comptait 72 sur 109 3. Dans l’état actuel de nos
connaissances, il est assez délicat d’affirmer des relations étroites
entre la répartition des orages et la configuration du sol4. On ne
peut mer toutefois certaines coïncidences notées par l’observation
populaire. La vallée de l’Oise qui s’ouvre vers le Sud-Ouest est une
route d orages : tantôt ils fondent sur la forêt de Compiègne, tantôt
' 160, 1900, p. 15.
* Duchaussoy, 171, p. B, 90.
3 Ici., 169, p. A, 20 et 168, p. 211.
4 Consulter les cartes d’orages dans A.B.C.M. et dans VAtlas Météorologique.
ils prennent leur course vers la forêt de Hez et vers Beauvais en
longeant le Thérain; tantôt enfin, ils remontent l’Oise jusqu’aux
forêts de la Thiérache et de l’Ardenne où ils jettent en crevant
d’énormes masses d’eau. La vallée de la Somme, différemment
orientée, attire beaucoup moins d’orages. Des reliefs du sol exercent
une action certaine sur les orages. Tantôt ils les détournent; les
orages qui, venant du Sud, rencontrent les hauteurs du Bray, s y
divisent souvent en deux branches, l’une Ouest-Est qui se dirige
vers l’Oise et les Ardennes, l’autre Est-Ouest qui traverse la Seine-
Inférieure. La colline de Neuvillebose, au Sud-Ouest de Méru (Oise),
coupe les orages qui l’attaquent par le Sud-Ouest et envoie les nuages,
les uns vers l’Oise, les autres sur Beauvais. Le mont Soufflard et la
montagne de Coivrel détournent la plupart des orages qui menacent
Montdidier1 : le 13 juillet 1788, l’orage qui marchait d’abord Sud-
Ouest-Nord-Est se dirige ensuite Ouest-Est à partir du Mesnil-
Saint-Georges, puis reprend sa première route au delà de Montdidier.
Tantôt les orages semblent converger sur les reliefs : il
suffit de jeter un coup d’oeil sur les cartes d’orages pour voir les
hauteurs du Caux, du Bray et du Boulonnais criblées de points
noirs ; dans ce cas, la répartition des orages ressemble à celle des
pluies.'
Les campagnes desséchées attendent parfois les orages avec impatience;
mais il en est qu’on redoute ; ce sont les orages à g rêle2.
Leur origine demeure obscure et leur domaine malaise à définir. En
trente ans, la Somme a eu 222 orages à grêle dont 76 en Juin, 66 en
Juillet, 38 en Août, 31 en Mai. Les chutes de grêle sont le plus fréquentes
au début de l’été, au moment où l’atmosphère, fortement
échauffée par en bas, se refroidit encore vite dans les couches supérieures.
Cette époque tombe mal pour les cultures; la grêle hache les
jeunes épis et détruit l’espoir de la récolte. Il serait utile de connaître
les zones qu’elle préfère ; mais pour un phénomène aussi capricieux,
il faut se contenter d’une approximation. Les cantons que des massifs
boisés protègent contre le choc du nuage orageux échappent
presque toujours à la grêle : on peut observer très nettement des
zones indemnes en arrière des forêts de Brotonne, de Roumare,
d’Elbeuf dans la Seine-Inférieure ; d’Eu et de Crécy dans la Somme ;
d’Hallatte et de Compiègne dans l’Oise; de Yillequier, de Coucy, de
Saint-Gobain, de Yillers-Cotterets dans l’Aisne. Le 8 Juillet 1857, le
4 Duchaussoy, 172, p. 223.
3 Id„ 168, 169 170. — Rottée 19a. — Atlas Météorologiques de 1866 et 1867. —
Annuaire, 585.