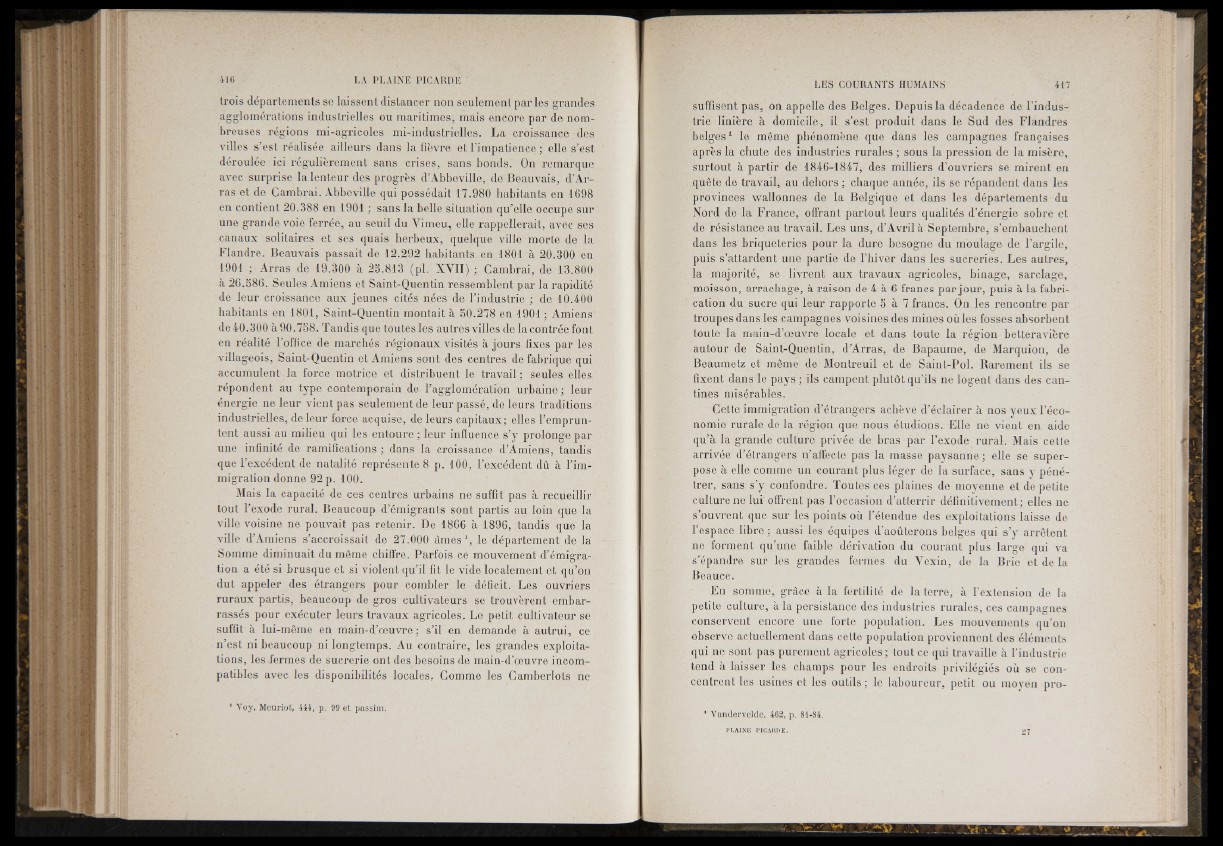
trois départements se laissent distancer non seulement par les grandes
agglomérations industrielles ou maritimes, mais encore par de nombreuses
régions mi-agricoles mi-industrielles. La croissance des
villes s’est réalisée ailleurs dans la fièvre et l’impatience ; elle s’est
déroulée ici régulièrement sans crises, sans bonds. On remarque
avec surprise la lenteur des progrès d’Abbeville, de Beauvais, d’Ar-
ras et de Cambrai. Abbeville qui possédait 17.980 habitants en 1698
en contient 20.388 en 1901 : sans la belle situation qu’elle occupe sur
une grande voie ferrée, au seuil du Vimeu, elle rappellerait, avec ses
canaux solitaires et ses quais herbeux, quelque ville morte de la
Flandre. Beauvais passait de 12.292 habitants en 1801 à 20.300 en
1901 ; Arras de 19.300 à 23.813 (pl. XVII) ; Cambrai, de 13.800
à 26.586. Seules Amiens et Saint-Quentin ressemblent par la rapidité
de leur croissance aux jeunes cités nées de l’industrie ; de 10.400
habitants en 1801, Saint-Quentin montait à 50.278 en 1901 ; Amiens
de 40.300 à 90.758. Tandis que toutes les autres villes de la contrée font
en réalité l’office de marchés régionaux visités à jours fixes par les
villageois, Saint-Quentin et Amiens sont des centres de fabrique qui
accumulent la force motrice et distribuent le travail; seules elles
répondent au type contemporain de l’agglomération urbaine; leur
énergie ne leur vient pas seulement de leur passé, de leurs traditions
industrielles, de leur force acquise, de leurs capitaux; elles l’empruntent
aussi au milieu qui les entoure ; leur influence s’y prolonge par
une infinité de ramifications ; dans la croissance d’Amiens, tandis
que l’excédent de natalité représente 8 p. 100, l’excédent dû à l’immigration
donne 92 p. 100.
Mais la capacité de ces centres urbains ne suffit pas à recueillir
tout l’exode rural. Beaucoup d’émigrants sont partis au loin que la
ville voisine ne pouvait pas retenir. De 1866 à 1896, tandis que la
ville d’Amiens s’accroissait de 27.000 âmes1, le département de la
Somme diminuait du même chiffre. Parfois ce mouvement d’émigration
a été si brusque et si violent qu’il fit le vide localement et qu’on
dut appeler des étrangers pour combler le déficit. Les ouvriers
ruraux partis, beaucoup de gros cultivateurs se trouvèrent embarrassés
pour exécuter leurs travaux agricoles. Le petit cultivateur se
suffit à lui-même en main-d’oeuvre; s’il en demande à autrui, ce
n’est ni beaucoup ni longtemps. Au contraire, les grandes exploitations,
les fermes de sucrerie ont des besoins de main-d’oeuvre incompatibles
avec les disponibilités locales. Comme les Camberlols ne
' Voy. Meuriot, 444, p. 99 et passim.
suffisent pas, on appelle des Belges. Depuis la décadence de l’industrie
linière à domicile, il s’est produit dans le Sud des Flandres
belges1 le même phénomène que dans les campagnes françaises
après la chute des industries rurales ; sous la pression de la misère,
surtout à partir de 1846-1847, des milliers d’ouvriers se mirent en
quête de travail, au dehors ; chaque année, ils se répandent dans les
provinces wallonnes de la Belgique et dans les départements du
Nord de la France, offrant partout leurs qualités d’énergie sobre et
de résistance au travail. Les uns, d’Avril à Septembre, s’embauchent
dans les briqueteries pour la dure besogne du moulage de l ’argile,
puis s’attardent une partie de l’hiver dans les sucreries. Les autres,
la majorité, se livrent aux travaux agricoles, binage, sarclage,
moisson, arrachage, à raison de 4 à 6 francs par jour, puis à la fabrication
du sucre qui leur rapporte 5 à 7 francs. On les rencontre par
troupes dans les campagnes voisines des mines où les fosses absorbent
toute la main-d’oeuvre locale et dans toute la région betteravière
autour de Saint-Quentin, d’Arras, de Bapaume, de Marquion, de
Beaumetz et même de Montreuil et de Saint-Pol. Rarement ils se
fixent dans le pays ; ils campent plutôt qu’ils ne logent dans des cantines
misérables.
Cette immigration d’étrangers achève d’éclairer à nos yeux l’économie
rurale de la région que nous étudions. Elle ne vient en aide
qu’à la grande culture privée de bras par l ’exode rural. Mais cette
arrivée d’étrangers n’affecte pas la masse paysanne; elle se superpose
à elle comme un courant plus léger de la surface, sans y pénétrer,
sans s’y confondre. Toutes ces plaines de moyenne et de petite
culture ne lui offrent pas l’occasion d’atterrir définitivement; elles ne
s’ouvrent que sur les points où l’étendue des exploitations laisse de
l’espace libre ; aussi les équipes d’aoûterons belges qui s’y arrêtent
ne forment qu’une faible dérivation du courant plus large qui va
s’épandre sur les grandes fermes du Yexin, de la Brie et de la
Beauce.
En somme, grâce à la fertilité de la terre, à l’extension de la
petite culture, à la persistance des industries rurales, ces campagnes
conservent encore une forte population. Les mouvements qu’on
observe actuellement dans cette population proviennent des éléments
qui ne sont pas purement agricoles; tout ce qui travaille à l’industrie
tend à laisser les champs pour les endroits privilégiés où se concentrent
les usines et les outils; le laboureur, petit ou moyen pro-
1 Vandervelde, 462, p. 81-84.
PLAINE PICARDE.