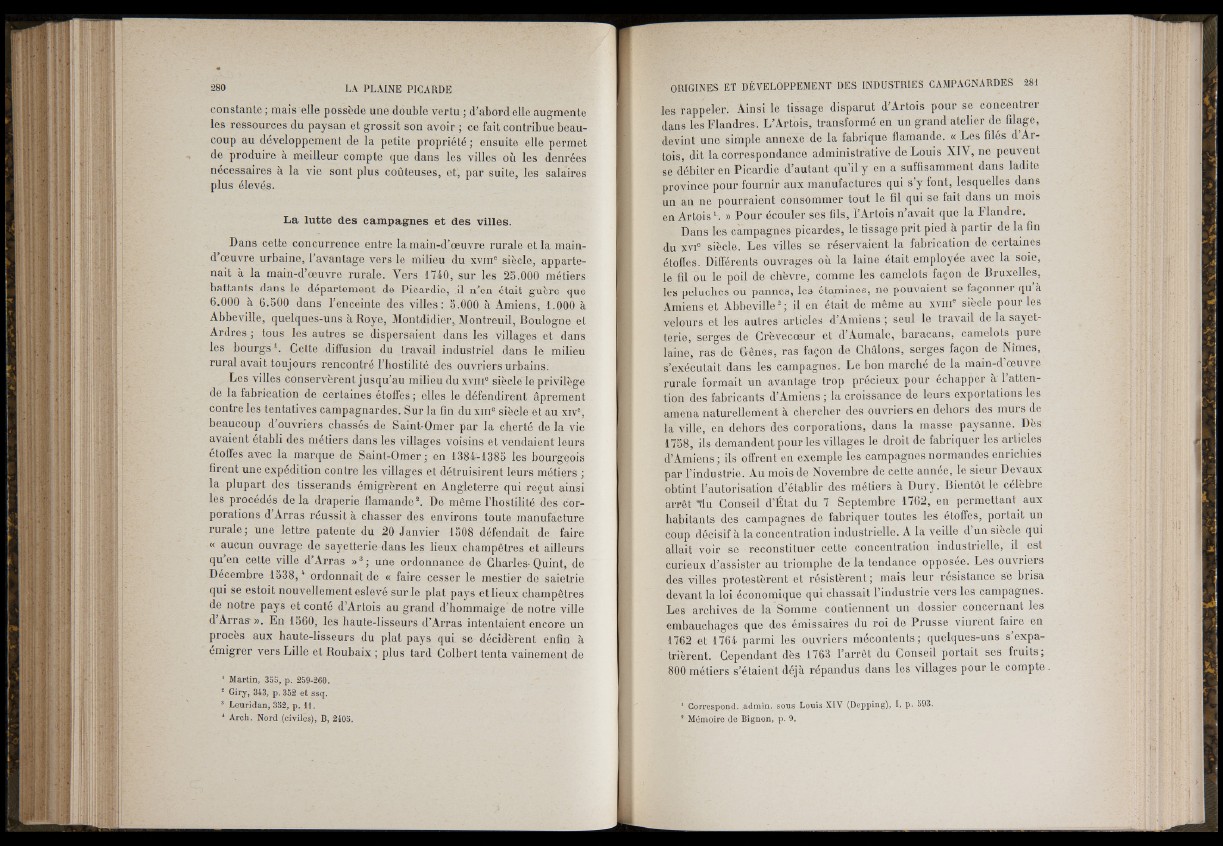
constante ; mais elle possède une double vertu ; d’abord elle augmente
les ressources du paysan et grossit son avoir ; ce fait contribue beaucoup
au développement de la petite propriété; ensuite elle permet
de produire à meilleur compte que dans les villes où les denrées
nécessaires à la vie sont plus coûteuses, et, par suite, les salaires
plus élevés.
La lutte des campagnes et des villes.
Dans cette concurrence entre la main-d’oeuvre rurale et la main-
d oeuvre urbaine, l’avantage vers le milieu du xvm8 siècle, appartenait
à la main-d’oeuvre rurale. Vers 1740, sur les 25.000 métiers
battants dans le département de Picardie, il n ’en était guère que
6.000 à 6.500 dans l’enceinte des villes: 5.000 à Amiens, 1.000 à
Abbeville, quelques-uns à Roye, Montdidier, Montreuil, Boulogne et
Ardres ; tous les autres se dispersaient dans les villages et dans
les bourgs1. Cette diffusion du travail industriel dans le milieu
rural avait toujours rencontré l’hostilité des ouvriers urbains.
Les villes conservèrent jusqu’au milieu duxvm® siècle le privilège
de la fabrication de certaines étoffes; elles le défendirent âprement
contre les tentatives campagnardes. Sur la fin du xme siècle et au xive,
beaucoup d’ouvriers chassés de Saint-Omer par la cherté d e là vie
avaient établi des métiers dans les villages voisins et vendaient leurs
étoffés avec la marque de Saint-Omer; en 1384-1385 les bourgeois
firent une expédition contre les villages et détruisirent leurs métiers ;
la plupart des tisserands émigrèrent en Angleterre qui reçut ainsi
les procédés d e là draperie flamande2. De même l ’hostilité des corporations
d’Arras réussit à chasser des environs toute manufacture
rurale; une lettre patente du 20 Janvier 1508 défendait de faire
« aucun ouvrage de sayetterie dans les lieux champêtres et ailleurs
qu’en cette ville d’Arras » 3; une ordonnance de Charles-Quint, de
Décembre 1538,4 ordonnait de « faire cesser le mestier de saietrie
qui se estoit nouvellement eslevé sur le plat pays et lieux champêtres
de notre pays et conte d’Artois au grand d’hommaige de notre ville
d Arras1». En 1560, les haute-lisseurs d’Arras intentaient encore un
procès aux haute-lisseurs du plat pays qui se décidèrent enfin à
emigrer vers Lille et Roubaix ; plus tard Colbert tenta vainement de
‘ Martin, 355, p. 259-260.
* Giry, 343, p. 352 et ssq.
3 Leuridan, 352, p. 11.
1 Arch. Nord (civiles), B, 2405.
les rappeler. Ainsi le tissage disparut d’Artois pour se concentrer
dans les Flandres. L’Artois, transformé en un grand atelier de filage,
devint une simple annexe de la fabrique flamande. « Les filés d’Artois,
dit la correspondance administrative de Louis XIY, ne peuvent
se débiter en Picardie d’autant qu’il y en a suffisamment dans ladite
province pour fournir aux manufactures qui s’y font, lesquelles dans
un an ne pourraient consommer tout le fil qui se fait dans un mois
en Artois1. » Pour écouler ses fils, l’Artois n’avait que la Flandre.
Dans les campagnes picardes, le tissage prit pied à partir de la fin
du xvi° siècle. Les villes se réservaient la fabrication de certaines
étoffes. Différents ouvrages où la laine était employée avec la soie,
le fil ou le poil de chèvre, comme les camelots façon de Bruxelles,
les peluches ou pannes, les étamines, ne pouvaient se façonner qu à
Amiens et Abbeville2 ; il en était de même au x v i ii0 siècle pour les
velours et les autres articles d’Amiens ; seul le travail de la sayetterie,
serges de Crèvecoeur et d’Aumale, baracans, camelots pure
laine, ras de Gênes, ras façon de Châlons, serges façon de Nîmes,
s’exécutait dans les campagnes. Le bon marché de la main-d’oeuvre
rurale formait un avantage trop précieux pour échapper à l’attention
des fabricants d’Amiens ; la croissance de leurs exportations les
amena naturellement à chercher des ouvriers en dehors des murs de
la ville, en dehors des corporations, dans la masse paysanne. Dès
1758, ils demandent pour les villages le droit de fabriquer les articles
d’Amiens ; ils offrent en exemple les campagnes normandes enrichies
par l’industrie. Au mois de Novembre de cette année, le sieur Devaux
obtint l’autorisation d’établir des métiers à Dury. Bientôt le célébré
arrêt Tlu Conseil d’Ëtat du 7 Septembre 1762, en permettant aux
habitants des campagnes de fabriquer toutes les étoffes, portait un
coup décisif à la concentration industrielle. A la veille d un siècle qui
allait voir se reconstituer cette concentration industrielle, il est
curieux d’assister au triomphe de la tendance opposée. Les ouvriers
des villes protestèrent et résistèrent ; mais leur résistance se brisa
devant la loi économique qui chassait 1 industrie vers les campagnes.
Les archives de la Somme contiennent un dossier concernant les
embauchages que des émissaires du roi de Prusse vinrent faiie en
1762 et 1764 parmi les ouvriers mécontents; quelques-uns s’expatrièrent.
Cependant dès 1763 l’arrêt du Conseil portait ses fruits,
800 métiers s’étaient déjà répandus dans les villages pour le compte
' Correspond, admin. sous Louis XIV (Depping), I, p. 593.
1 Mémoire de Bignon, p. 9.