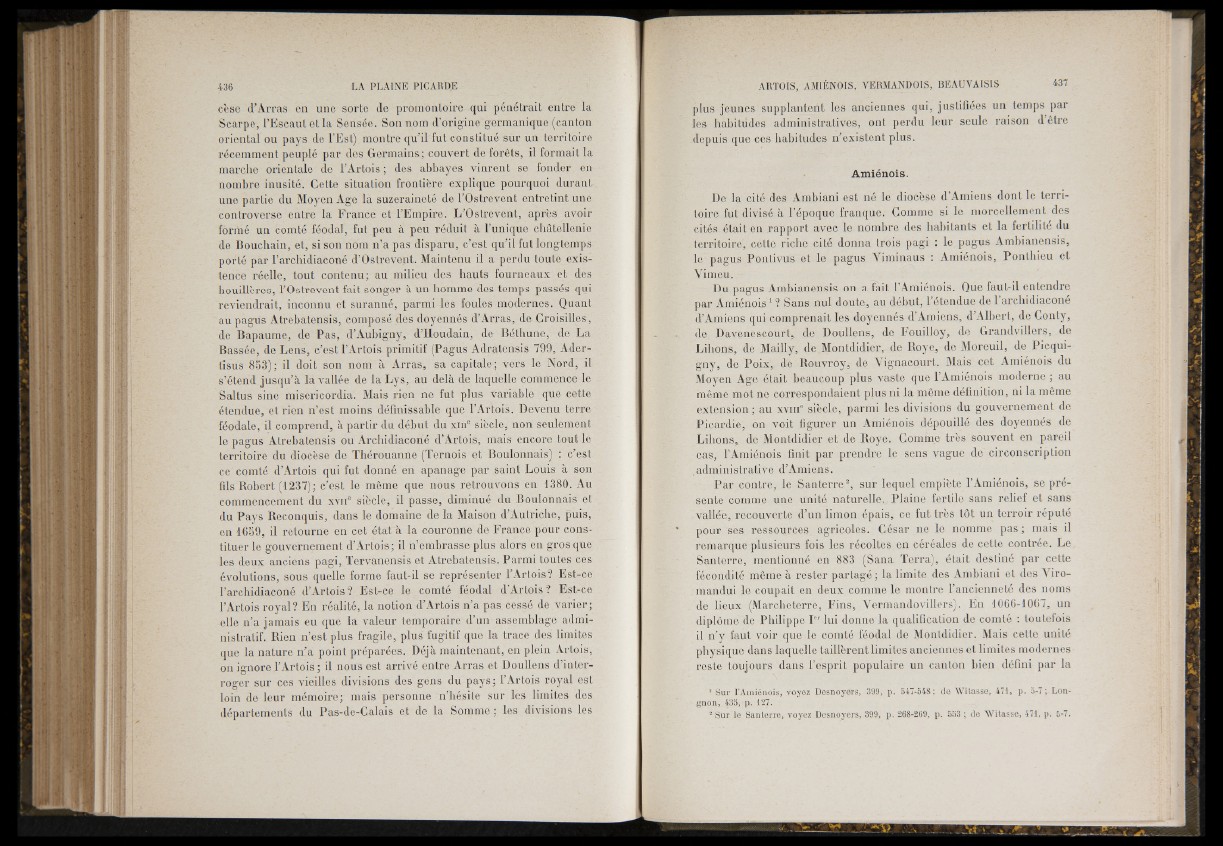
cèse d’Arras en une sorte de promontoire qui pénétrait entre la
Scarpe, l’Escaut et la Sensée. Son nom d’origine germanique (canton
oriental ou pays de l’Est) montre qu’il fut constitué sur un territoire
récemment peuplé par des Germains^; couvert de forêts, il formait la
marche orientale de l’Artois ; des abbayes vinrent se fonder en
nombre inusité. Cette situation frontière explique pourquoi durant
une partie du Moyen Age la suzeraineté de l’Ostrevent entretint une
controverse entre la France et l’Empire. L’Ostrevent, après avoir
formé un comté féodal, fut peu à peu réduit à l’unique châtellenie
de Boucliain, et, si son nom n’a pas disparu, c’est qu’il fut longtemps
porté par l’archidiaconé d’Ostrevent. Maintenu il a perdu toute existence
réelle, tout contenu; au milieu des hauts fourneaux et des
houillères, l’Ostrevent fait songer à un homme des temps passés qui
reviendrait, inconnu et suranné, parmi les foules modernes. Quant
au pagüs Atrebatensis, composé des doyennés d’Arras, de Croisîlles,
de Bapaume, de Pas, d’Aubigny, d’Houdain, de Béthune, de La
Bassée, de Lens, c’est l’Artois primitif (Pagus Adratensis 799, Ader-
tisus 853); il doit son nom à Arras, sa capitale- vers le Nord, il
s’étend jusqu’à la vallée de la Lys, au delà de laquelle commence le
Saltus sine misericordia. Mais rien ne fut plus Variable que cette
étendue, et rien n’est moins définissable que l’Artois. Devenu terre
féodale, il comprend, à partir du début du xine siècle, non seulement
le pagus Atrebatensis ou Arehidiaconé d’Artois; mais encore tout le
territoire du diocèse de Thérouanne (Ternois et Boulonnais) : c’est
ce comté d’Artois qui fut donné en apanage par saint Louis à son
fils Robert (1237); c’est le même que nous retrouvons en 1380. Au
commencement du x v i i® siècle, il passe, diminué du Boulonnais et
du Pays Reconquis, dans le domaine de la Maison d’Autriche, puis,
en 1659, il retourne en cet état à la couronne de France pour constituer
le gouvernement d’Artois; il n’embrasse plus alors en gros que
les deux anciens pagi, Tervanensis et Atrebatensis. Parmi toutes ces
évolutions, sous quelle forme faut-il se représenter l’Artois? Est-ce
l’archidiaconé d’Artois? Est-ce le comté féodal d’Artois? Est-ce
l’Artois royal? En réalité, la notion d’Artois n’a pas cessé de varier;
elle n’a jamais eu que la valeur temporaire d’un assemblage administratif.
Rien n’est plus fragile, plus fugitif que la trace des limites
que la nature n’a point préparées. Déjà maintenant, en plein Artois,
on ignore l’Artois ; il nous est arrivé entre Arras et Doullens d’interroger
sur ces vieilles divisions des gens du pays; l’Artois royal est
loin de leur mémoire; mais personne n’hésite sur les limites des
départements du Pas-de-Calais et de la Somme ; les divisions les
plus jeunes supplantent les anciennes qui, justifiées un temps par
les habitudes administratives, ont perdu leur seule raison d être
depuis que ces habitudes n’existent plus.
Amiénois.
De la cité des Ambiani est né le diocèse d’Amiens dont le territoire
fut divisé à l’époque franque. Comme si le morcellement des
cités était en rapport avec le nombre des habitants et la fertilité du
territoire, cette riche cité donna trois pagi : le pagus Ambianensis,
le pagus Pontivus et le pagus Viminaus : Amiénois, Ponthieu et
Vimeu.
Du pagus Ambianensis on a fait l’Amiénois. Que faut-il entendre
par Amiénois1 ? Sans nul doute, au début, l’étendue de l’archidiaconé
d’Amiens qui comprenait les doyennés d’Amiens, d’Albert, de Conty,
de Davenescourt, de Doullens, de Fouilloy, de Grandvillers, de
Lihons, de Mailly, de.Montdidier, de Roye, de Moreuil, de Picqui-
gny, de Poix, de Rouvroy, de Yignacourt. Mais cet Amiénois du
Moyen Age était beaucoup plus vaste que l’Amiénois moderne ; au
même mot ne correspondaient plus ni la même définition, ni la même
extension; au xvme siècle, parmi les divisions du gouvernement de
Picardie, on voit figurer un Amiénois dépouillé des doyennés de
Lihons, de Montdidier et de Roye. Comme très souvent en pareil
cas, l’Amiénois finit par prendre le sens vague de circonscription
.administrative d’Amiens.
Par contre, le Santerre2, sur lequel empiète l’Amiénois, se présente
comme une unité naturelle. Plaine fertile sans relief et sans
vallée, recouverte d’un limon épais, ce fut très tôt un terroir réputé
pour ses ressources agricoles. César ne le nomme pas ; mais il
remarque plusieurs fois les récoltes en céréales de cette contrée. Le
Santerre, mentionné en 883 (Sana Terra), était destiné par cette
fécondité même à rester partagé; la limite des Ambiani et des Viro-
mandui le coupait en deux comme le montre l’ancienneté des noms
de lieux (Marcheterre, Fins, Yermandovillers). En 1066-1067, un
diplôme de Philippe Ier lui donne la qualification de comté : toutefois
il n’y faut voir que le comté féodal de Montdidier. Mais cette unité
physique dans laquelle taillèrent limites anciennes et limites modernes
reste toujours dans l’esprit populaire un canton bien défini par la
1 Sur l’Amiénois, voyez Desnoyers, 399, p. 547-548; de Witasse, 471, p. 5-7; Lon-
gnon, 435, p. 127.
! Sur lo Santerre, voyez Desnoyers, 399, p. 268-269, p. 553 ; de Witasse, 471, p. 5-7.