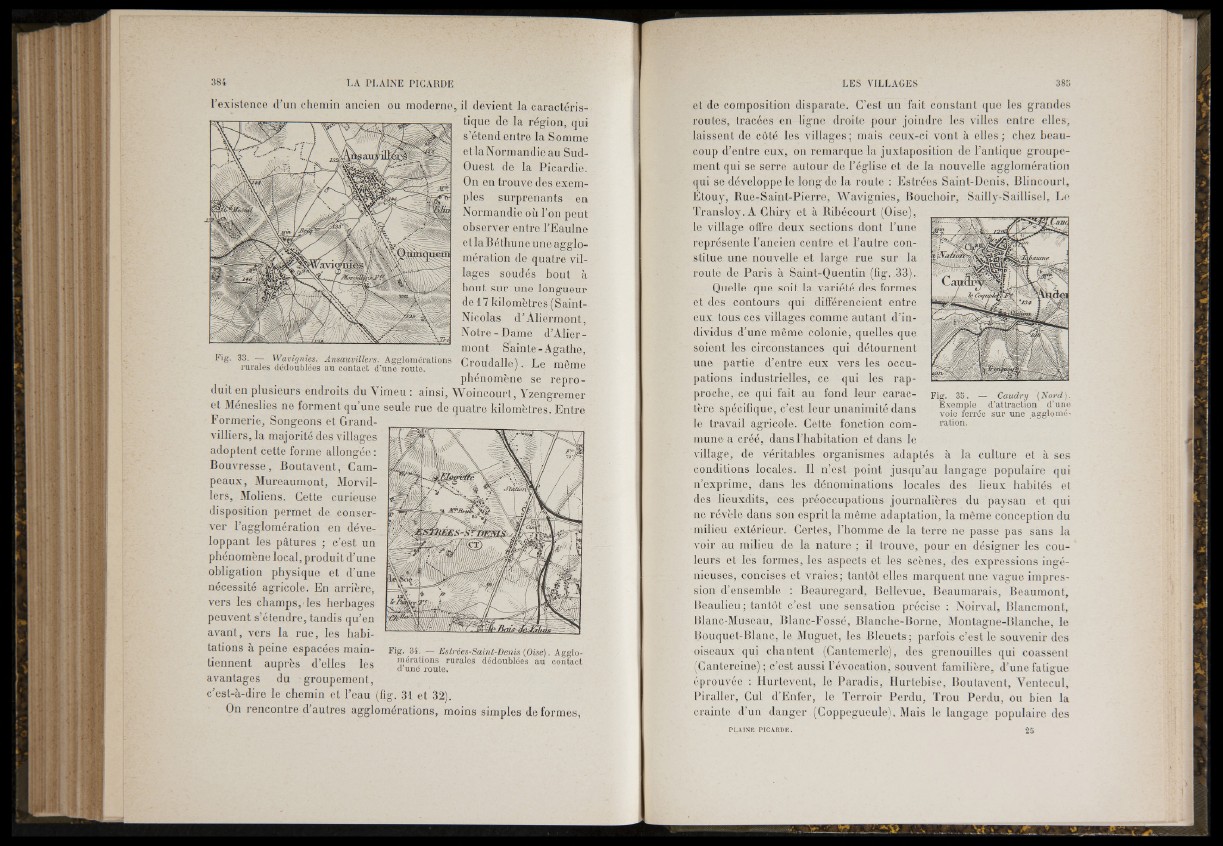
l'existence d’un chemin ancien ou moderne, il devient la caractéristique
de la région, qui
s’étend entre la Somme
et la Normandie au Sud-
Ouest de la Picardie.
On en trouve des exemples
surprenants en
Normandie où l’on peut
observer entre l’Eaulne
et la Béthune une agglomération
de quatre villages
soudés bout à
bout sur une longueur
de 17 kilomètres (Saint-
Nicolas d ’Âliermont,
Notre-Dame d’Alier-
mont Sainte-Agathe,
Croudalle). Le même
phénomène se reproduit
Fig. 33. ■— Wavignies. Ansauvillers. Agglomérations
rurales dédoublées au contact d’une route.
en plusieurs endroits du Yimeu : ainsi, Woincourt, Yzengremer
et Méneslies ne forment qu’une seule rue de quatre kilomètres. Entre
Formerie, Songeons et Grand-
villiers, la majorité des villages
adoptent cette forme allongée :
Bouvresse, Boutavent, Cam-
peaux, Mureaumont, Morvil-
lers, Moliens. Cette curieuse
disposition permet de conserver
l’agglomération en développant
les pâtures ; c’est un
phénomène local, produit d’une
obligation physique et d’une
nécessité agricole. En arrière,
vers les champs,)les herbages
peuvent s’étendre, tandis qu’en
avant, vers la rue, les habitations
à peine espacées maintiennent
auprès d’elles les
Fig. 34. — Estrées-Saint-Denis (Oise). Agglomérations
rurales dédoublées au contact
d’uné route.
avantages du groupement,
c’est-à-dire le chemin et l’eau (fig. 31 et 32).
On rencontre d’autres agglomérations, moins simples déformés,
et de composition disparate. C’est un fait constant que les grandes
routes, tracées en ligne droite pour joindre les villes entre elles,
laissent de côté les villages; mais ceux-ci vont à elles; chez beaucoup
d’entre eux, on remarque la juxtaposition de l’antique groupement
qui se serre autour de l’église et de la nouvelle agglomération
qui se développe le long de la route : Estrées Saint-Denis, Blincourt,
Étouy, Bue-Saint-Pierre, Wavignies, Bouchoir, Sailly-Saillisel, Le
Transloy. A Chiry et à Bibécourt (Oise),
le village olfre deux sections dont l’une
représente l’ancien centre et l’autre constitue
une nouvelle et large rue sur la
routé de Paris à Saint-Quentin (fig. 33).
Quelle que soit la variété des formes
et des contours qui différencient entre
eux tous ces villages comme autant d’individus
d’une même colonie, quelles que
soient les circonstances qui détournent
une partie d’entre eux vers les occupations
industrielles, ce qui les rapproche,
ce qui fait au fond leur caractère
spécifique, c’est leur unanimité dans
le travail agricole. Cette fonction commune
a créé, dans l’habitation et dans le
Fig. 35. — Caudry (Nord).
Exemple d’attraction d’uno
voie ferrée su r une agglomération.
village, de véritables organismes adaptés à la culture et à ses
conditions locales. Il n ’est point jusqu’au langage populaire qui
n’exprime, dans les dénominations locales des lieux habités et
des lieuxdits, ces préoccupations journalières du paysan et qui
ne révèle dans son esprit la même adaptation, la même conception du
milieu extérieur. Certes, l’homme de la terre ne passe pas sans la
voir au milieu de la nature ; il trouve, pour en désigner les couleurs
et les formes, les aspects et les scènes, des expressions ingénieuses,
concises et vraies; tantôt elles marquent une vague impression
d’ensemble : Beauregard, Bellevue, Beaumarais, Beaumont,
lîeaulieu; tantôt c’est une sensation précise : Noirval, Blancmont,
IUanc-M useau, Blanc-Fossé, Blanche-Borne, Montagne-Blanche, le
Bouquet-Blanc, le Muguet, les Bleuets; parfois c’est le souvenir des
oiseaux qui chantent (Cantemerlc), des grenouilles qui coassent
(Cantereine) ; c’est aussi l’évocation, souvent familière, d’une fatigue
éprouvée : Hurtevent, le Paradis, Hurtebise, Boutavent, Yentecul,
Piraller, Cul d’Enfer, le Terroir Perdu, Trou Perdu, ou bien la
crainte d’un danger (Coppegueule). Mais le langage populaire des
P LA IN E P IC A R D E . 2 5