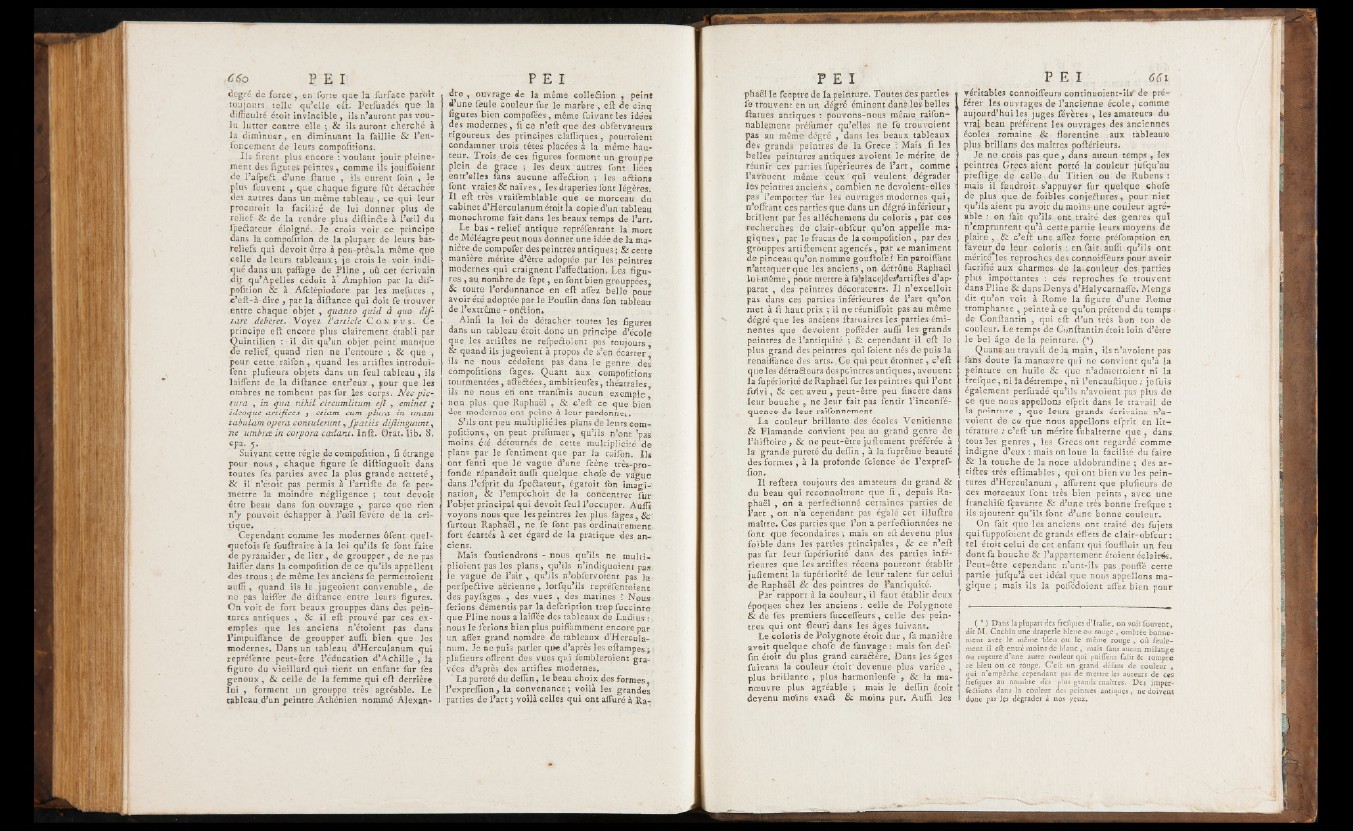
66o P E I
degré -de force', en forte que la furface paraît
toujours telle qu’elle eft. Perfuadés que la
difficulté étoit invincible , ils n’auront pas voulu
lutter contre elle ; & ils auront cherché à
la diminuer, en diminuant la faillie & l’enfoncement
de leurs compofitions.
Ils firent plus encore : voulant jouir pleinement
des figures peintes , comme ils jouifloient
de l’afpecl d’une ftatue , ils eurent foin , le
plus fouvent , que chaque figure fût détachée
des autres dans un même tableau, ce qui leur
procuro.it la facilité de lui donner plus de
relief- & de la rendre plus diftinéle à l’oeil du
fpeélateur éloigné. Je crois voir ce principe
dans la compofition de la plupart de leurs bas-
reliefs qui devoit être à peu-près*la même que
celle de leurs tableaux-, je crois le voir indiqué
dans un paffage de Pline , où cet écrivain
d$ qu’Apelles cédoit à Amphion par la dif-
pofition & à Afolépiodore par les mefures ,
c’eft-à-dire 3 par la aiftance qui doit fe trouver
entre chaque objet , quanto quid à quo dif-
tare deberet. Voyez l’article C o n f u s . Ce
principe eft encore plus clairement établi par
Quintilien : il dit qu’un objet peint manque
de relief, quand rien ne l’entoure ; & que ,
pour cette, raifon , quand les artiftes introduisent
plufieurs objets dans un feul tableau , ils
laiftent de la diflance çntr’eux , pour que les
ombres ne tombent pas fur les corps. JVec p ic-
tura , in q u a . nihil circumlitum ejl , eminet ;
ideoque artifices 3 etiam cum plara in imam
tabulam opéra contulerunt, fp a tiis dfiinguunt,
'ne umbraein corpora codant. Inft. ©rat. lib. 8.
cpa. 5. - - •
Suivant cette régie de compofition , fi étrange
pour nous, chaque figure fe diftinguoît dans
toutes fes parties avec la plus grande netteté,
& il n’étoit pas permis à l’artifte de fe permettre
la moindre négligence ; tout dévoie
être beau dans fon ouvrage , parce que rien'
n’y pouvoit échapper à l’oeil févèré de la critique.
Cependant comme les modernes ôfent quelquefois
fe fouftraire à la loi qu’ils fe font faite
de pyramider , de lier , de groupper, de ne pas
laifler dans la compofition de ce qu'ils appellent
des trous -, de même les anciens fe permettoient
auffi, quand ils le„jugeoient convenable, de
ne pas laifler de diflance entre leurs figures.
On voit de fort beaux groupp.es dans des peintures
antiques , & il eft prouvé par ces exemples
que les anciens n'étoient pas dans
l’impuiflànce de groupper'auffi bien que les
modernes. Dans un tableau d’Herculanum qui
repréfente peut-être l’éducation d’Achille , la
figure du vieillard qui tient un enfant fur fes
genoux , & celle de la femme qui eft derrière
lui , forment un grouppe très agréable. Le
tableau d’un peintre Athénien nommé Alexan-
P E I
dre , ouvrage de la même colleélion , peint
d’une feule couleur fur le marbre, eft de cinq
figures bien compofées, même fuivanc.les idées
des modernes, fi ce n’eft que des oblervateurs
rigoureux des principes clafliques, pourroient
condamner trois. têtes placées à la même hauteur.
Trois de ces figure« forment un grouppe
plein de grâce ; les deux autres font liées
entr’elles lans aucune affeélion > les aâions
font vraies & naïves, les draperies font légères.
Il eft très vraifemblablè que ce morceau du
cabinet d’Herculanum était la copie d’un tableau
monochrome fait dans les beaux temps de l’art.
Le bas - relief antique repréfentant la mort
de Méléagre petit nous donner une idée de la manière
de compofer des peintres antiques ; & cette
manière mérite d’être adoptée par les peintres
modernes qui craignent l’affeélation, Les figures
, au nombre de fept, en font bien grouppées
& toute l’ordonnance en eft aflez belle pour
avoir été adoptée par le Pouffin dans fon tableau
de l’extrême - onftion.
Ainfi la loi de détacher toutes les figures
dans un tableau étoit donc un principe d’école
que les artiftes ne refpeâoient pas toujours
& quand ils jugeoient à propos de s’en écarter
ils ne nous cédoient pas dans le genre des
compofitions fages. Quant aux. compofitions
tourmentées , affeélées, ambitieufes, théâtrales
ils ne nous en ont tranfmis aucun exemple
non plus que Raphaël , & g’eft ce que bien
des modernes ont peine à leur pardonner.
S’ils ont peu multiplié les plans de leurs compofitions
, on peut préfumer, qu’ils n’ont ’pas
moins été détournés de cette multiplicité de
plans par le fentiment que par la raifon. Ils
ont fenti que lé vague d’une fcène très-profonde
répandoit auffi quelque chofe de va^ue
dans l’efprit du fpeâateur, égaroit fon imagination,
& l’empécholt de la concentrer lur
l’ob}.et principal qui devoit feul .l’occuper. Auffi
voyons nous que les peintres les plus fages, &
furtout Raphaël, ne fe font pas ordinairement,
fort écartés à cet égard de la pratique des anciens.
Mais foutiendrons - nous qu’ils ne multi-:
plioient pas les plans, qu’ils n’indiquoient pas
le yague de l’air, qu’ils n’obfervoient pas la
perfpeétive aerienne, lorfqu’ils repréfentoient
des payfages , des vues , des marines ? Nous
ferions démentis par la defeription trop fuccinte
que Pline nous a laiflee des tableaux de Ludius :
nous le ferions bien plus puiflamment encore par
un aflez grand nomdre de tableaux d’Herculanum.
Je ne puis parler que d’après les eftampes ;
plufieurs offrent des vues qui fembleroîent gravées
d’après des artiftes modernes.
" La pureté du deffin, le beau choix des formes
l’expreffion, la convenance ; voilà les grandes
parties de l’art} voilà celles qui ontafluré à Ra-
P E I
phàël le feeptre de la peinture. Toutesces parties
fe trouvent, en un dégré éminent dans.les belles
ftatues antiques : pouvons-nous mêflie^aifon-
nablement préfumer qu’elles ne fe trouvoient
pas au même degré , dans les beaux tableaux
des grands peintres de la Grece ? Mais fi les
belles peintures antiques ayoient le mérite de
réunir ces parries fupérieurès de l’art, comme
l’avouent même ceux qui veulent dégrader
les peintres, anciens , combien ne devoient-elles
pas l’emporter fur les ouvrages modernes qui,
n’offrant ces parties que dans un degré inférieur,
brillent par les alléchemens du coloris , par ces
recherches de clair-obfcur qu’on appelle magiques,
par le fracas de la compofition , par des
grouppes artiftement agencés, par ce maniment
de pinceau qu’on nomme gouftofe? En paroiflant
n’attaquer que les anciens, on détrône Raphaël
lui-même ; pour mettre à fajplace|des*artiftes d’apparat
, des peintres décorateurs. Il n’excelloit
pas dans ces parties .inférieures de l’art qu’on
met à fi haut prix ; il ne réunifloit pas au même
dégré que les anciens ftaruaires les parties éminentes
que dévoient pofleder auffi les grands
peintres de l’antiquité ; & cependant il eft le
plus grand des peintres qui foient nés de puis la
renaiflance des arts.. Ce qui peut étonner , c’eft
que les détraéleurs des peintres antiques, avouent
la fupériorité de Raphaël fur les peintres qui l’ont
fiïivi, & cet aveu , peut-être peu fincere dans
leur bouche , ne leur fait pas ièntir l’inconfé-
quence de leur raifonnement.
La couleur brillante des écoles Vénitienne
I & Flamande convient peu au grand genre de
l’hiftoire , & ne peut-être juftement préférée à
la grande pureté du deffin , à la fuprême beauté
des formes , à la profonde fcience de l’expref-
fion.
Il reflera toujours des amateurs du grand &
du beau qui reconnoîtront que fi, depuis Raphaël
, on a perfeélionné certaines ‘parties de
l’art , on n’a cependant pas égalé cet illuftre
maître. Ces parties que l’on a perfectionnées ne
font que fecondaires ; mais on eft devenu plus
foible dans les parties principales, & ce n’eft
pas fur leur fupériorité dans des parties inférieures
que les artiftes récens pourront établir
juftement la lupériori'té de leur talent fur celui
de Raphaël & des peintres de l’antiquité.
Par rapport à la couleur, il faut établir deux
époqHes chez les anciens : celle de Polygnote
& de fes premiers, fuccefleurs , celle des peintres
qui ont fleuri dans les âges luivans.
Le coloris de Polygnote étoit dur, fa manière
avoit quelque chofe de fauvage : mais fon deffin
étoit du plus grand caraélère, Dans les âges
fuivans là couleur étoit devenue plus variée ,
plus brillante , plus harmonîeufe 3 & la manoeuvre
plus agréable ; mais le deffin étoit
deyenu moins exaél & moins pur. Auffi les
P E I ; 661
véritables connoifleurs continueient-ils^ de pré-
férer les ouvrages de l’ancienne école, comme
aujourd’hui les juges févères , les amateurs dir
: vrai beau préfèrent les ouvrages des anciennes
écoles romaine & florentine aux tableau»
plus brillans des maîtres poftérieurs.
Je ne crois pas que 3 dans aucun temps, les
, peintres Grecs aient porté la couleur jufqu’au
preftige de celle > du Titien ou de Rubens :
mais il faudrait s’appuyer fur quelque chofe
dé plus que de foibles conjectures, pour nier
qu’ils aient pu avoir du moins-une couleur agréable
: on fait qu’ils ont trafiç des genres qui
n’empruntent qu’à cette partie leurs moyens de
plaire , & c’eft une aflez forte préfomption en
faveur de leur coloris : en.fait auffi qu’ils ont
mérité les reproches,des connoifleurs pour avoir
facrifié aux charmes, de la;,couleur des parties
plus importantes : cés reproches fe trouvent
dans Pline & dans Denys d’Halycarnafle. Mengs
dit qu’on voit à Rome la figure d’une Rome
tromphante , peinte à ce qu’on prétend du temps
de Conftantin , qui eft d'un très bon ton de
couleur. Le temps de Conftantin étoit loin d’être
le bel âge de la peinture. (*)
Quant-.au trayail de la main, ils n’avoient pas
fans doute la manoevre qui ne convient qu’à la
peinture en huile & que n’admettoient ni la
frefque, ni la détrempe, ni l’encauftique ; je fuis
également perfuadé qu’ils n’avoient pas plus de
ce que nous appelions efprït dans le travail de
la peinture , que leurs grands écrivains n’a-
voient de ce que nous appelions efprit en littérature
: c’eft un mérite fubalterne que , dans,
tous les genres, les Grecs ont rega^ûé comme
indigne d’eux : mais on loue la facilité du faire
& la touche de la noce aldobrandine ; des artiftes
très eftimables , qui ont bien vu les peintures
d’Hérculanum , aflurent que plufieurs de
ces morceaux font très bien peints, avec une
franchife fçavante & d’une très bonne frefque :
ils ajoutent qu'ils font d’une bonne couleur.
On fait que les anciens ont traité des fujets
qui fuppofoient de grands effets de clair-obfcur :
tel étoit celui de cet enfant qui fouffloit un feu
dont fa bouche & l’appartement étoient éclairés.
Peut-être cependant n’o.nt-îls pas .pouffé cette
partie jilfqu’à cet idéal que nous appelions magique
; mais ils la poifédoient aflez bien pour
( * ) Dans la plupart des frefques d’Italie, on voit fouvent,
dit M. Cochin une draperie bleue ou rouge , ombrée bonnement
avec Iê même bleu ou le même rouge , où feulement
il eft entre moins de blanc, mais fans aucun mélange
ou rupture d’une autre couleur qui puilfent falir & rompre
ce bleu ou ce rouge. C’eft un grand défaut de couleur ,
qui n’empêche cependant pas de mettre les auteurs de ces
frefques au nombre dès plus grands maîtres. Des imperfections
dans la couleur des peintres antiques, ne doivent
donc pas les dégrader à nos yeux.