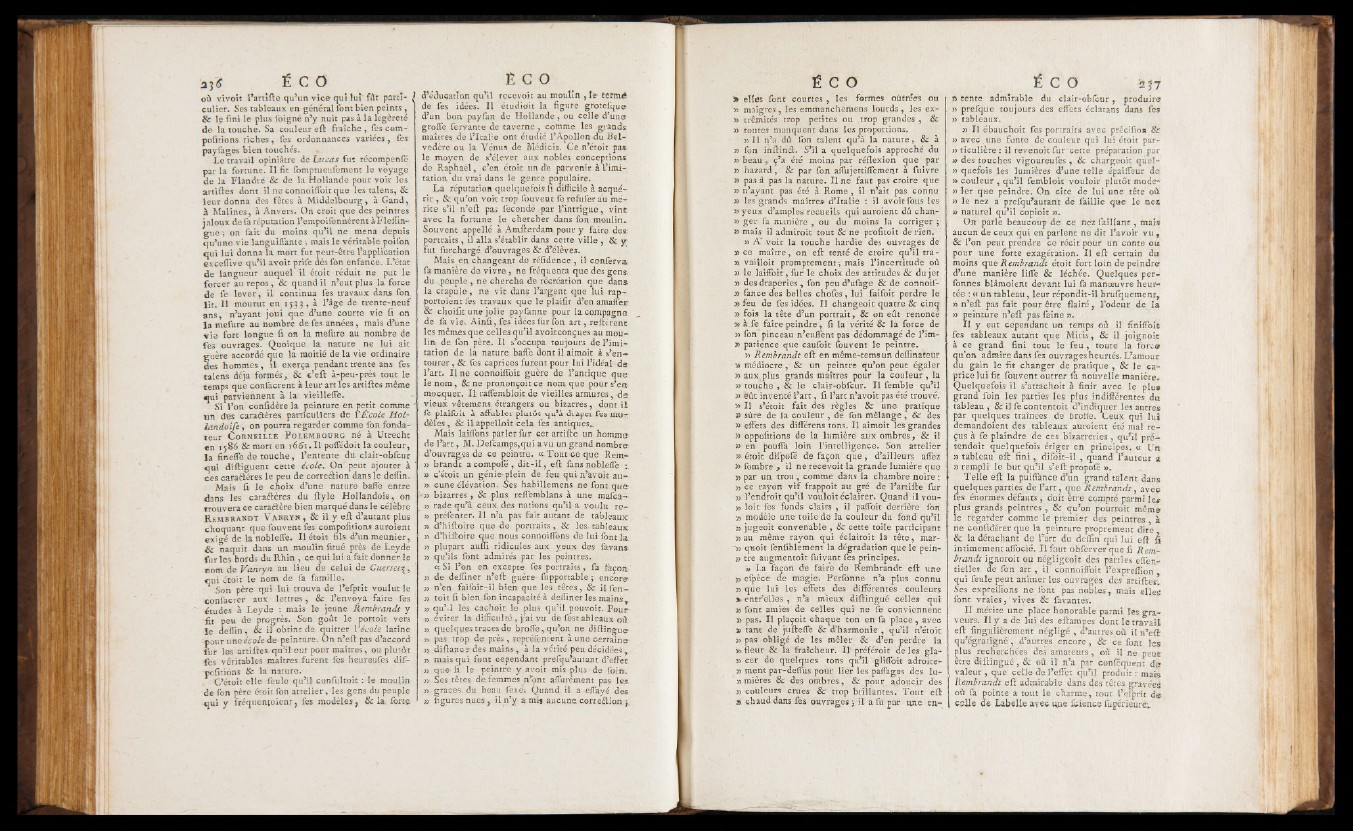
236 É C O
où vivoît l’ artifte qu’un v ic e qui lui fût parti- l
culier. Ses tableaux en général font bien peints,
& fo fini le plus foigné n’y nuit pas à la légèreté
d e la touche. Sa couleur eft fraîche , fes com-
pofitions rich e s, les ordonnances variées, fes
payfages bien touchés.
Le travail opiniâtre de Lucas fut récompenfé
par la fortune. I l fit fom.ptueufement le voyage •
de la Flandre & de la Hollande pour voir les
artiftes dont il ne con.noiffoit que les talens, &
leu r donna des fêtes à Middelbourg, à Gand,
à Malines, à Anvers. On croit que des peintres
jaloux de fa réputation l’empoifonnèrent a Flelfin-
gue -, on lait du moins qu’il ne mena depuis
qu’une vie languiflante -, mais le véritable poifon
qui lui donna la mort fut peut-être l’application
exceflive qu’il avoit prifé dès fôn enfance. L’état
de langueur auquel il étoit réduit ne put le
forcer au repos, & quand il n’ eut plus la force
de fe le v e r , il continua fes travaux dans fon
litv II mourut en 1 5 3 3 , à l ’âgè de trente-neuf
ans, n’ayant joui que d’une courte vie fi on
la mefure au nombre de fes années , mais d’une
v ie fort longue fi on la mefure au nombre de
fes ouvrages. Quoique la nature ne lui ait
guère accordé que la moitié de la vie ordinaire
des hommes, i l exerça pendant trente ans fès
talens déjà formés,. & e’eft à-peu-près tout le
temps que confacrent à leur art les artiftes même
qui parviennent à la vieilleffè.
Si l’ on confédéré la peinture en petit comme '
un des caractères particuliers de VÉcole Hol-
lan d o ife , on pourra regarder comme fon fondateur
C o rn e il l e P oxembourg né à: Utrecht
en 1 5 8 6 & mort en 1 6 6 1 . I l poffédoit la couleur ,
la fineffè de touche, l’ entente du- clair-obfcur
qui diftiguent cette école. On peut ajouter à ’ces caraétéres le peu de correction dans le deflin.
Mais fi le choix d’une nature baffe entre
dans les caractères du ftyle Hollandois, on
trouvera ce caraCtère bien marqué dans le célèbre
R embrandt V anry-n , & il y eft d’autant plus
choquant que fouvent fes compofitions auroient
exigé de la nobleffe. I l étoit fils d’un meunier,
& naquit dans un moulin finie près de Le.ydè
fur les bords du Rhin , ce qui lui a fait dbnner le
nom de Vanryn au. lieu de celui de Guerret£ ,
qui étoit le nom de fa famille ;
Son père q,ui lui trouva de l’efprit voulut le
confacrer aux le ttre s, & l’ ënvoya faire fes
études à Leyde : mais le jeune Rembrandt y
fit peu de progrès. Son goût le portoit vers
le deffin, 8c il obtint de quitter Y école latine
pour une école depeinture. On n’ eft pas d’accord
fur les artiftes, qu’il eut pour maîtres , ou plutôt
fes véritables maîtres furent fes heureufes dif-
pcfitiôns & la nature.
C’ étoit e lle feule qu’il c.onfûltoit : le moulin
de fon père étoit fon attelier, les gens du peuple
qui y fréquemcien.t, fes modèles, & Isa forte 1
Ê c o
\ d’éducation qu’ il recevoit au moulin , le tertnrf
de fes idées. I l étudioit la figure grotefque
d’ un bon payfan de Hollande, ou celle d’une
groffe fervante de taverne, comme les grands
maîtres de l’ Italie ont étudié l’Apollon du B e lvédère
ou la Vénus de Médicis. Ce n’étoit pas-
le moyen de s’ élever aux nobles conceptions
. de Raphaèl, c’en étoit un d'e parvenir à l’imitation
du vrai dans le genre populaire.
L a réputation quelquefois li difficile à acquérir
, & qu’on voit trop fouvent fe refufer au mérite
s’il n’ eft pas fécondé par l’intrigue, vint
avec la fortune le chercher dans fon moulin»
Souvent appelle à Amfterdam pour y faire des^
portraits , il alla s’établir dans cette ville , & y
fut furchargé d’buvrages & d’élèves.
Mais en changeant de réfidence, il conferva
fa manière de v iv r e , ne fréquenta que des gens,
du péuple , ne chercha de récréation que dans.
I la crapule, ne vit dans l ’argent que lu i rap-
| portoient fes travaux que le plaifir d’en amaffer
& choifit une jolie payfanne pour la compagne
de fa vie. Ainfi, fes idées fur fon a r t , relièrent
les mêmes que celles qu’il avoitconçues au mou*
; lin; de Ion père. I l s’ occupa toujours de l ’imitation
de la nature, baffe dont i l aimoit à s’ èn—
tourer, & fes caprices furent pour lui l?idéal de
l ’art. U ne connoiffoit guère de l’antique que
le nom, & ne prononçoitce nom que pour s’eit
mocquer. I l raffèmbloit de vieilles armures, de
' vieux vêtemens. étrangers ou bizarres, dont i l
fè plaifôit à affubler plutôt qu’ à draper fes mo^
dèles, & iL appelloit cela fes antiques..
Mais laiffons parler fur cet artifte un homme
de l’a r t, M. Defcamps,qui a vu un grand nombre
d’ôuvrages de ce peintre, d, Tout -ce que Rem»
*
» brandt a compofé , d i t - i l , eft fans nobleffe ;.
» c’étoit un génie-plein de feu qui-n’ âvoit au-
». cune élévation. Ses habillemens ne font que
-» bizarres , & plus reffemblans à une mafca-
» rade qu’a ceux des nations qu’il a. voulu re»
» préfenter. I l n’a pas fait autant de tableaux
» d’ hiftoîre que de portraits, & les, tableaux
» d’ hiftoire que nous connoiffons de lui font la.
» plupart auüi ridicules aux yeux des favans
» qu’ils font admirés par- les peintres.
ce.Si l’bn en excepte fes portraits, fa façôn
» de defïïner n’ eft guère- fupportable ; encore
» n’en faifoit-il bien que les têtes , & il fen»
» toit fi bien fon incapacité;à defliner les mains»
» qu’ l lés cachoit le plus qu’ il, pouvoit. Pouf
» éviter la difficulté, j’ai vu de festableaiix où
» quelques traces de broffe,.qu’on ne diftingue'
» pas trop de près , représentent à une. certaine
» ’diftatiG3: des mains-, à la vérité peu décidées,
» mais qui font cependant prefqu’ àutant d’effet
» que-fi le- peintre y avoit mis plus-de foin.
» Ses têtes de femmes n’ont affurément pas les
» grâces du beau fexé;. Quand il a effayé des
» » figures nues, il n’y a. mis aucune corredionj,
Ê c o
fe elles font courtes, les formes oütréeS ou
» maigres, les emmanchemens lourds, les ex-
» trêmités trop petites ou ,trop grandes , &
» toutes manquent dans les proportions.
» 1 1 n’a dû fon talent qu’ à la nature, & à
» fon inftind. S’il a quelquefois approché du
» beau , ç’a été moins par réflexion que par
» hazard, & par fon affujettiffement à fuivre
» pas â pas la' nature. I l ne faut pas croire que
» n’ayant pas été à Rome, il n’ait pas connu
» les grands maître» d’ Italie : il avoit fous les
» yeux d’amples recueils qui auroient dû chan-
» ger fa manière , ou du moins la corriger ;
» mais il admiroit tout & ne profitoit dé rien.
» A ' ,voir la touche hardie des ouvrages de
» ce maître, on eft tenté de croire qu’il tra-
» vailloit promptement-, mais l’incertitude où
» le laiffoit, fur le choix des attitudes & du jet
» des draperies , fon peu d’ufage & de connoif-
» fance des belles chofes, lui faifoit perdre le
» feu de fes idées. I l changeoit quatre & cinq
» fois la tête d’ un portrait, & on eût renoncé
» à fe faire peindre, fi la vérité & la force de
» fon" pinceau n’ euffent pas dédommagé de l’ im-
» patience que caufoit fouvent le peintre.
» Rembrandt eft en même-tems un deflinateur
» médiocre, & un peintre qu’on peut égaler
» aux.nlus grands maîtres pour la couleur, la
» touche , & le clair-obfcur. I l femble qu’ il
» ëût inventé l’a r t , fi l’art n’avoit pas été trouvé.
» 1 1 s’étoit fait des règles & une pratique
ï> sûre de la couleur , de fon mélange, & des
» effets des différens tons. I l aimoit les grandes
» oppofitions de la lumière aux ombres, & il
» en pouffa loin l ’intelligence. Son attelier
» étoit difpofe de façon q u e , d’ailleurs affez
i> fombre , il ne recevoit la grande lumière que
» par un trou , comme dans la chambre noire :
» ce rayon v i f frappoit au gré de l’ârtifte fur
» l’ endroit qu’ il vouloit éclairer. Quand ilvo u -
» loit fes fonds clairs , il paffoit derrière fon
» modèle une toile de la couleur du fond qu’ il
» jugeoit convenable , .& cette toile participant
» a u même rayon qui éclairoit la tête, marqtioit
fenfiblement la dégradation que le pein-
» tre augmentoit fuivant fes principes.
» La façon de faire de Rembrandt eft une
» efpèce de magie. Perfonne n’ a plus connu
» que lui- les effets des différentes couleurs
% entr’elles , n’a mieux diftingue celles qui:
» fo n t amies de celles qui ne fe conviennent
» pas. I l plaçoit chaque ton en fa pla c e , avec
» tant de joifteffe & d’harmonie , qu’il n’étoit
» pas obligé de les mêler & d’en perdre la
».fleur & la fraîcheur. 1 1 ' préféroit de les gla-
» cer de quelques tons qu’ il gliffoit adroite-
» ment par-deffus pour lier les paffages des l:u-
>5 mières & des ombres, & pour adoucir des
» couleurs crues & trop brillantes. Tout eft
» chaud, dans fes ouvrages j il a fu par une enÊ
C O ’2 ? 7
ï> tente admirable du clair-obfcur, produire
» prefque toujours des effets éclatans dans fes
» tableaux.
» I l ébauchoit fes portraits avec précifion &
» avec , une fonte de couleur qui lui étoit par-
» ticulière : il revenoit fur cette préparation par
» des touches vigoureufes , & chargeoit quel-
» quefois les lumières d’ une telle épaiffeur des
» couleur , qu’il fembloit vouloir plutôt mode*
» 1er que peindre. On cite de lui une tête où
» le nez a prefqu’autant de faillie que le nez
» naturel qu’ il copioit ».
On parle beaucoup de ce fléz Taillant, mais
aucun de ceux qui en parlent ne dit l ’ avoir vu ,
& l’ on peut prendre ce récit pour un conte ou
pour une forte exagération. I l eft certain du
moins que Rembrandt étoit fort loin de peindre
d’ une manière iiffe & léchée. Quelques per-
fonnes blâmoient devant lui fa manoeuvre heurtée
: « un tableau, leur répondit-il brufquement,
» n’ eft pas fait pour être flairé r l’odeur de la
» peinture n’ eft pas faine».
I l y eut cependant un temps où il finiffoie
fes tableaux autant que M iris, & il joignoit
à ce grand fini tout le feu , toute la fore»
qu’on admire dans fes ouvrages heurtés. L’amour
du gain le f i t changer de pratique , & le ca**
price lui fit fouvent outrer fa nouvelle manière.
Quelquefois il s’attachoit à finir avec le plu»
grand foin les parties les plus indifférentes du
tableau , & il fe contentoit d’ indiquer les autre»
par quelques traînées de broffe. Ceux qui lu i
demandoient des tableaux auroient été mal reçus
à fe plaindre de ces bizarreries , qu’ il pré—
tendoit quelquefois ériger en principes. « Un
» tableau eft f in i , difoit-il , quand l’auteur a
» rempli le but qu’ il s’ eft propofe »,
T e lle eft la puiffance d’un grand talent dans
quelques parties de l’ art, que Rembrandt, avec-
fès énormes défauts , dort être compté parmi je *
plus grands peintres , & qu’on potirroit même
le regarder comme le premier des peintres, à
ne confidérer que la peinture proprement dite
& la détachant de l’ art du deffin qui lui eft fj
intimement affocié. I l faut obferver que fi Rembrandt
ignoroit ou négligeoit des parties effen-
tielles de fon a r t , il connoiffoit l’ exprefîion
qui feule peut animer les ouvrages des artiftes.
Ses expreffions ne font pas nobles, mais e lle s
font vraies, vives & lavantes.
I l mérite une place honorable parmi les graveurs.
I l y a de lui des eftampes dont le travail
eft fingulièrement négligé , d’ autres où il n’eftr
qu’égratigné, d’ autres encore, & ce font le s
plus recherchées des amateurs , où il ne peuc
être diftingué, & où il n’a par conféquent cfe
l, valeur , que celle àe l’effet qu’ il produit : mais-
Rembrandt eft admirable dans des têtes gravées
où fa pointe- a tout le charme, tout l’ efprit d©
cplle de Labelle avec une foien.ee fûpérieuréw