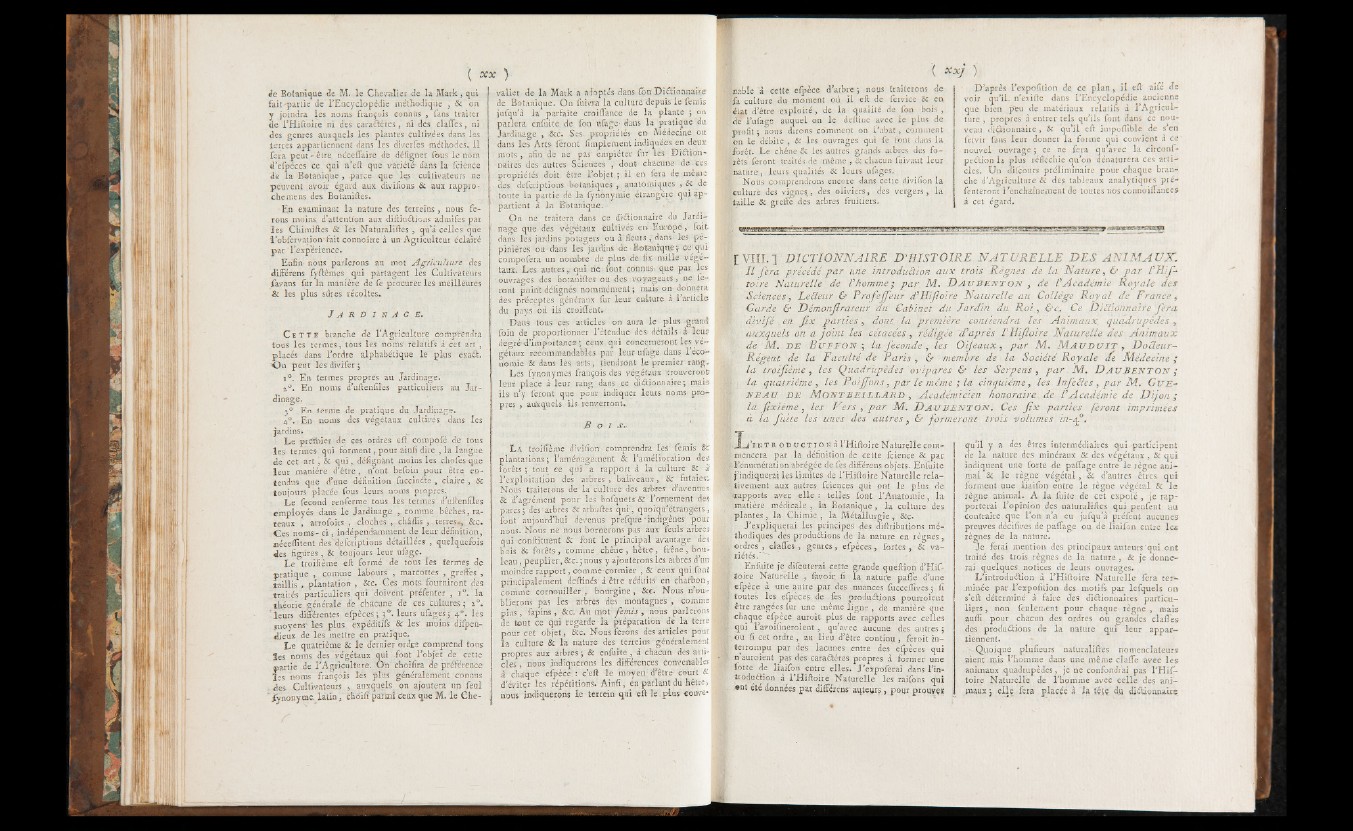
de Botanique de M. le Chevalier de la Mark, qui
fait'partie de l'Encyclopédie méthodique , & on
y joindra les noms françois connùs , fans traiter
de l ’Hiftoire ni des caractères , ni des claffes, ni
des genres auxquels les plantes cultivées dans les
terres appartiennent dans les diverfes méthodes., 11
fera peut-être néceffaire de défigner fous le nom
d’efpéces ce qui n’eft que variété dans la fcience
de la Botanique, parce que less cultivateurs ne
peuvent avoir égard aux divifions & aux rapproche
mens des Botaniftes.
En examinant la nature des ferreîns, nous ferons
moins, d’attention aux diftinÇtions admifes par
le s Chimiftes & les Naturaliftes , qu’à celles que 1
l ’obfervationffait connoîrre à un- Agriculteur éclairé
par l ’expérience*
Enfin nous parlerons au mot Agriculture (les
différens fyftêmes qui partagent les Cultivateurs
favans fur la manière de fe procurer les meilleures
& les plus sûres récoltes,.
J a r d i n a g e .
C e t t e branche de l’Agriculture comprendra,
tous les termes, tous les noms relatifs à cet art ,
placés dans l ’ordre alphabétique le plus éxaCl.
On peut les divifer 5
i ° . En termes propres au Jardinage.
2°. En noms d’uftenfil'es particuliers au Ja rdinage.
20. En terme de pratique du Jardinage.
40. . En noms des végétaux cultivés dans les
jardins* ;■
L e préïhier de ces ordres eft. compofé de tous
les termes qui forment, pour ainfi dire , la langue
de cet a r t , & qui,. défignant moins les chofes que
leur manière d’être , n’ont befoin, pour être entendus
que d’une définition fuccitnSe , claire -, &
toujours placée fous leurs noms propres;
L e fécond renferme tous les termes. d’uftenfiles
employés dans le Jardinage r comme bêches, râteaux
, arrofoirs , cloches ,. châ/fis , terres*,, &c.
Ces noms-ci., indépendamment de leur définition,
néceffitent des' defcriptions détaillées , quelquefois
des figures , & toujours leur ûfage.
Le troifième eft formé de tous les termes de
pratique , comme labpurs' , marcottes , greffes ,
taillis , plantation , &c. Ces móts. fourniront des
traités particuliers, qui'doivent préfénter , i° . la
théorie générale de chacune de ces cultures; 20.
! leurs différentes efpèces ; 3*. leurs ufages; 40. lés
moyens' les plus, expéditifs & les moins difpen-
dieux de les mettre en pratique.
L e quatrième & le dernier ordre comprend tous
les noms des végétaux qui .font l’objet de cette
partie de rAgricùlture. On çhoifira de préférence
le s noms françois les plus généralement connus
, des Cultivateurs > auxquels on ajoutera un feul
' fvnonyrae latin , choifî parmi Ceux que M. le Chevalier
de la Mark a adoptés dans (on Diétionnahe
de Botanique. On fuivra la culture depuis le femîs
jufqu’à la; parfaite croiffance de la plante ; on
parlera enfuite de fon ufage- dans la pratique du
Jardinage , &c. Ses- propriétés- en Médecine ou
dans lès Arts feront Amplement indiquées en deux
mots , afin de ne pas empiéter fur les DiCtion-
nazies des au-très Sciences , -dont- chacune dé Ces
propriétés doit être l ’objet ; il en fera de meme
des defcriptions botaniques , anatomiques , 8c de
toute la partie de là fynônymie étrangère qui appartient
a la Botanique.
O ri ne traitera, dans ce dictionnaire du Jardi—
nage que des végéta-ux cultivés en Europe, fait
dans les jardins potagers ou à flèurs ; dans les pé^-
piniêres ou d'ans les jardins de Botaniquie ce{ qui
compofera un nombre de plus de fix- mille végétaux.
Les autres ,; qui né font connus-, que par les
•ouvrages des botaniftes ou des-: voyageurs , ne. feront
point défignés nommément; mais; on- donnera
des préceptes généraux fur leur culture a 1 article-
du pays où iis croiffent*
Dans tous eès articles on aura le plus grand1
foin de proportionner l ’étendue des détails va leur?
degré--d’importancs ; ceux qui concerneront les végétaux
recommandables par leur ufa'ge dans l ’eço-
nomie & dans les arts, tiendront le premier rang.
Lés fynonymes françois des végétaux trouveront
1-eui place à leur rang dans ee dictionnaire; mais
ils n’y feront que pour indiquer leurs- noms propres
, auxquels ils renverront.
B o l s .
L a troifième divifion' comprendra les" fémis &
plantations ; l ’aménagement & l ’amélioration des
forêts ; tout ee qui a rapport à la culture & V-à
l ’exploitation dès arbres , baliveaux, St futaies:
Nous traiterons de la culture-dés arbres d?avenifes-
8c d’agrément pour les bofquets' 8c l ’ornement des
parcs ; des arbres 8c arbuftes qui-, quorqurétrangérs ,
font aujourd’hui devenus prefqué - indigènes pour
nôus. Nous ne nous bornerons pas’ aux feüls arbres
quî'cbnftituent 8c font le principal avantage des
bois & forêts, comme 7 chêne-, hêtre, frêne, bouleau
, peuplier; &c: ; nous y ajouterons les arbres d’un
moindre rapport, commè-cormier , & ceux qui. font
principale ment deftinés' à être réduits' en charbon,
comme cornouiller y bbürgrne, &c. Nous n?b u -.
b lierons pas les arbres des montagnes , comme
pins, fapins , &c. Au mot fem is , nous parlerons
de tout ce qui regarde la préparation de la terre
pour cet objet., &c. Nous ferons dès articles pour
la culture & la nature des térreins - généralement |
propres aux arbres ; & enfuite , à chacun des articles
, nous indiquerons les différences convenables ;
à chaque efpèce: : c’eft le moyen d’être-court &
d’éviter les répétitions. Ainfi, en parlant du îiêtré,
nous indiquerons le terrcin qui eft le . plus coiwekable
à Cette efpèce d’arbre ; nous traiterons de
[fa culture du moment où il eft de fervice & en,
état d’être exploité, de la qualité- de fon bois ,
de l ’ufage auquel on le deftine avec le plus de
profit; nous dirons comment on l ’abat, comment
on le débite , 8c .les ouvrages qui fe font dans la
forêt. Le chêne & les autres grands arbres des forêts
feront traités de même ,- & chacun fuivant leur
nature. leurs qualités 8c leurs ufages.
ï. Nous comprendrons encore dans cette divifion la
culturè des vignes, des oliviers, des vergers, la
taille & greffe des arbres fruitiers.
D’après l ’expofitîon de ce p lan , il eft aifé de
voir qu’il, n’exifte dans l ’Encyclopédie ancienne
que bien pou de matériaux relatifs à l ’Agriculture
, propres à entrer tels qu’ils font dans ce nouveau
dictionnaire, Sc "qu’il eft impoflïble de s’eil
fervir fans leur donner la forme qui convient à ce
nouvel ouvrage; ce ne fera qu’avec la circonf-
p-eCtion la plus réfléchie qu’on dénaturera ces articles.
Un dite ours préliminaire pour chaque branche
d’Agriculture & des tableaux analytiques piefen
terom l ’ enchaînement de toutes nos connoiffances
à cet égard.
[V IH .] DICTIONNAIRE D'HISTOIRE NATURELLE DES A N IM A U X . \ Il fera précédé par une introduction aux trois Règnes de la Nature, & par PHif*
i taire Naturelle de Vhomme ; par, M. D au b en to n , de V Académie Royale des Sciences, Lecteur & Profejfeur d'Hfioirè Naturelle au Collège Royal de France $ Garde & Démonflrateùr du Cabinet du Jardin du Roi,, &c. Ce Dictionnaire fera v dïvifè en fix parties, dont la première contiendra les Animaux,; quadrupèdes y
h auxquels on a joint les cétacées, rédigée d'après VHfioire Naturelle des Animaux deM. de Bu F F ON y la fécondé , les Oijeaux, par M. Ma u d u it , Docteur- Régent dé la Facidté de Paris , & membre de la Société Royale de Médecine ;
1' la troifième , les Quadrupèdes ovipares & les S erp eus , par - M. D A U B EN TO N ; la quatrième , les Poifjons, par le même ; la cinquième, les Infectes , par M. Gue- Ne a u de M o n tbeillArd , Académicien honoraire^ de VAcadémie de Dijon;
I; la fixième, les Vers , par M. D a u b e n t o n . Ces fix parties feront imprimées à la fuite les unes dès autres, & formeront trois volumes in -f.
JL i’r KTRODUCTiOKa l ’Hiftoire Naturelle commencera
par la définition de cette fcience & par
l ’énumération abrégée de les différens- objets. Enfuite
j ’indiquerai les limites de l ’Hiftoire Naturelle rela-
. tivement aux autres fciences qui ont le plus de
«rapports avec elle : telles font rAnatomie, la
matière médicale , la Botanique, la culture des
plantes , la Chimie , la Métallurgie , &c.
J ’expliquerai les principes cfes difîributions méthodiques
des produirions de la nature en règnes,
ordres , claffes , genres, efpèces , fortes , 8c variétés.”
" '
Enfuite je difeuterai cette grande quçftion d’Hif-
ioire Naturelle , favoir, fi la nature paffe d’une
efpèce à une autre par des nuances fucceftives ; fi
toutes les efpeces, de fies produirions pourroient
être rangées fur une même ligne , de manière que
chaque efpèce auroit plus de rapports avec celles
qui l ’avoifineroient, qu’avec aucune des autres;
ou fi cet ordre, au lieu d’être continp , feroit interrompu
par des lacunes entre des efpèces qui
n’auroient pas des cara&ères propres à former une
forte de liaifon entre elles. J ’expoferai dans l’in-,
trbduélion à l ’Hiftoire Naturelle les raifons qui
•nt été données pat différens aqteur?, pour prouyçj
qu’il y a des êtres intermédiaires qui participent
de la nature des minéraux & des végétaux, & qui
indiquent une forté de paffage entre le règne animal
& le règne végétal, 8c d’autres êtres qui
forment une liaifon entre le règne végétal 8c le
règne animal. A la fuite de cet expofié , j.e rapporterai
l ’opinion des naturaliftes qui penfent au
contraire que l ’on n’a eu jufqu’à préfent aucunes
preuves dêcifives de paffage ou de liaifon entre les
règnes de la nature.
Je ferai mention des principaux auteurs’qui ont
traité des trois règnes de la nature , & je donnerai
quelques notices de leurs ouvrages.
L ’introduélion à, l ’Hiftoire Naturelle fera ter-
.minée par l ’expofition des, motifs par lefquels on
s’eft déterminé' à faire des dictionnaires particuliers
, non feulement pour chaque règne , mais
auffi pour châcun des ordres ou grandes claffes
des productions de la nature qui leur appartiennent.
- Quoique plufîeurs naturaliftes nomenclateurs
aient mis l ’homme dans une même claffe avec les
animaux quadrupèdes, je ne confondrai pas l ’Hif—
toire Naturelle . de l’homme avec celle des animaux
j elle fera placée à la têlç du, dictionnaire