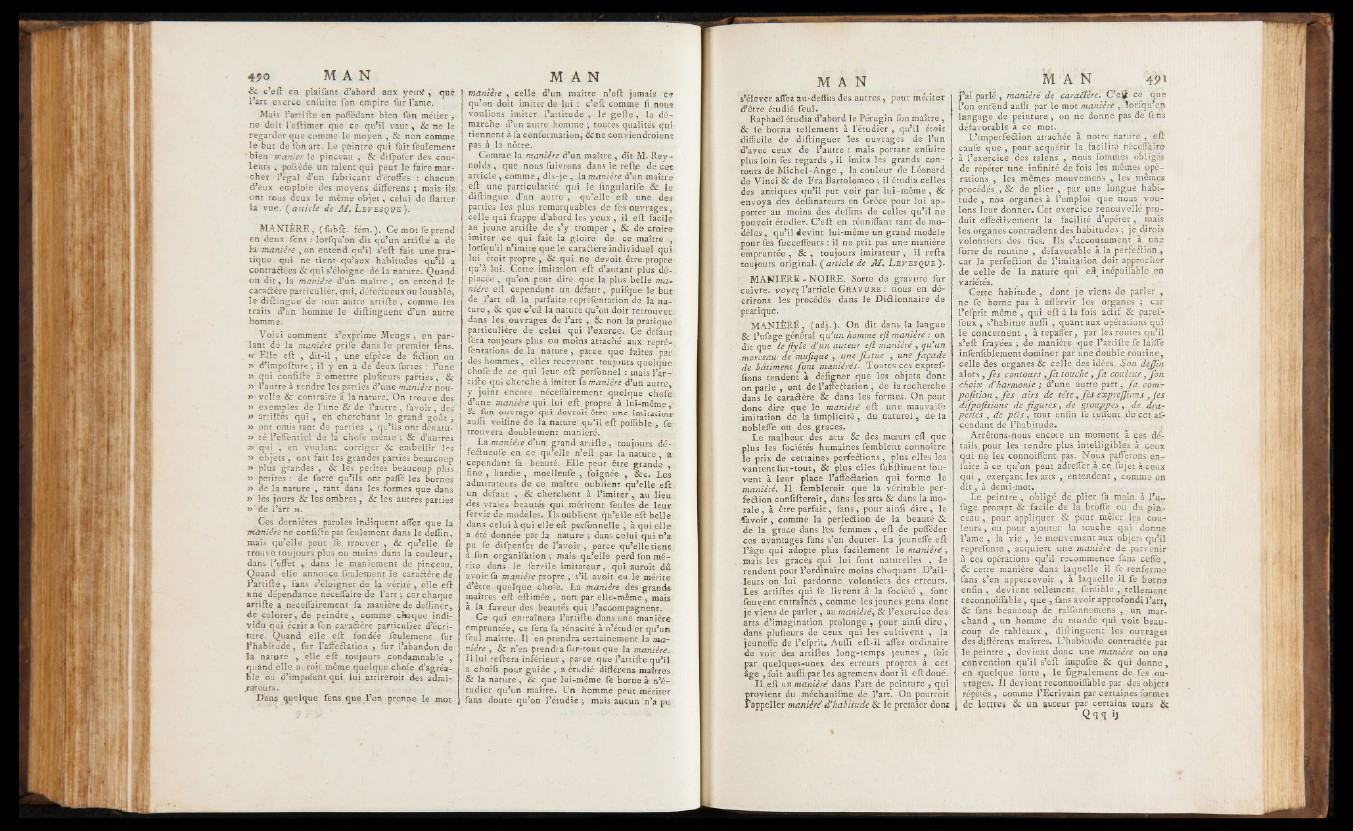
■ & c ’eft en plaifant d’abord aux yeux? qué
1 art exerce erifuite Fon empire fur Famé.
Mais l’ artifte en poffédant bien fôn métier ,
ne doit l’eftimer que ce qu’ il v a u t , & ne le
regarder que comme le moyen , & non comme
le but de fon art. Le peintre qui fait feulement
bien manier le pinceau , & difpofer des couleurs
, pofsède un talent qui peut le faire marcher
l’égal d’un fabricant d’étoffes : chacun
d’ eux emploie des moyens differens ; mais ils:
•ont tous deux le même o b je t, celui de flatter
la vue. ( article de L ev e sq u e ).
M A N IÈ R E , (fubft. fém.). Ce mot le prend
en deux fens : lorlqu’on dit qu’ un artiftè a de
la maniéré , on entend qu’ il s'êft fait une pratique
qui ne tient qu’aux habitudes qu’ il a
contractées & qui s’ éloigne de la nature. Quand
on d i t , la manière d’un maître , on entend le
caraâère particulier, qui, défectueux ou louable,
le diflingue de tout autre a r tifte , comme les
traits d’ un homme le diftinguent d’ un autre
homme.
Voici comment s’ exprime Mengs- ; en parlant
de la manière prife dans le premier fens.
« E lle eft , dit-il , une efpèce de fiction ou
» d’ impôfture -, il y en a de deux fortes : l’ une
» qui confifte à' omettre plufieurs parties , &
» l’ autre à rendre le s parties d’ une manière nou-
» velle & contraire à la nature. On trouve des
» exemples de l’une & de l’autre , fa vo ir, des'
» artiftes qui , en cherchant le grand goût ,
» ont omis tant de parties , qu’ ils ont dénatu-
» ré l’ effentiel de la chofe même •, & d’autres
» qui , en Voulant corriger & embellir les
» objets , ont fait les grandes' parties beaucoup
» plus grandes , & les petites beaucoup plus
» petites : de forte qu’ ils ont pafie les bornes
» de la nature , tant dans les formes que dans
» les jours & les ombres, & les autres parties
»"'de l’àrt ».
Ces dernières paroles indiquent affez que la
mànière ne confifte pas feulement dans le deffin,
mais qu’ elle peut fe trouver , & qu’ elle fe
trouvé toujours plus ou moins dans la couleur,
dans l ’effet , dans le maniement de pinceau.
Quand elle annonce .feulement le caractère de
l ’a r tifte , fans s’éloigner de la vérité , elle eft
une dépendance néceffaire de l’art \ car chaque
artifte a néçeffairement fa manière de deflïner,
de colorer, de peindre, comme chaque individu
qui écrit a fon caractère particulier, d’écriture.
Quand elle eft fondée feulement fur
l ’habitude, fur l’affedation , fur l’abandon de
la nature , elle eft toujours condamnable
quand e lle adroit même quelque chofe d’agréable
ou d’ impofant qui lu i, attireroit des admirateurs.
Dans quelque fens que l’ on prenne le mot
manière , celle d’ un maître n’ eft jamais ce
qu’on doit imiter de lui : c’ eft comme li nous
voulions imiter l’ attitude , . le gefte , la démarche
d’ un autre homme ; toutes qualités qui
tiennent à fa conformation, & n e conviendraient
pas à la nôtre.
Comme la manière d’ un maître , dit M. Re y nolds
, que nous fuivrons dans ie refte de cet
article , comme, dis-je , la manière d’un maître
eft une particularité qui le fingularife & le
diftingue d’un autre , qu’ elle eft une des
parties les plus remarquables de fes ouvrages,
celle qui frappe d’abord les yeux , il eft facile
au jeune artifte de s’ y tromper , & de croire
imiter ce qui fait la gloire de ce maître
lorfqu’il n’ imite que le caractère individuel qui
lui étoit propre, 8c qui ne de voit être propre
qu’ à lui. Cette imitation eft d’autant plus déplacée
, qu’on peut dire que la plus belle ma»
nière eft cependant un défaut, puifque le but
de l’art eft la parfaite repréfentation de la nature
, & que c’eft la nature qu’on doit retrouver
dans le souvrag e s de l’art , & non la pratique'
particulière de celui qui l’ exerce. Ce défaut
fera toujours plus ou moins attaché aux repré-
fentations de la nature, parce que faites par
des hommes , elles recevront toujours quelque
chofe de ce qui leur eft perfonnel : mais l’artifte
qui cherche à imiter la manière d’ un autre,,
y joint encore néçeffairement quelque chofe*
d’ ime manière qui lui eft propre à lui-même ,.
& fon ouvrage qui devrait être une imitation-
auffi voifine de la nature qu’ il eft poffible , fe
trouvera doublement manière.'
La manière d’ un grand artifte., - toujours dé-
féclueufe en ce qu’elle n’ eft pas la nature, a.
cependant fa beauté. E lle peut être grande
fine , hardie , moëlleufe , foignée , & c . Les
admirateurs de ce maître oublient qu’ elle eft:
un défaut , & cherchent à l’imiter r au lieu
des vraies beautés qui méritent feules de leur
fervir de modèles. Ils oublient qu’ elle eft belle
dans celui à qui e lle eft perfonnel le , à qui elle
a été donnée par la nature -, dans celui qui n’a
pu fe difpenfer de l ’avoir , parce qu’ elle tient
a fon organifation -, mais qu’ elle perd l’on mérite
dans le fervil.e imitateur, qui auroit dû
avoir fa manière propre., s’ il. avoit eu, le mérite
d’être quelque chofe. La manière dès grande
maîtres eft eftimée , non par elle-même, mais
à la faveur des beautés qui l’ accompagnent.
Ce qui enrraînera l ’artifte dans une manière
empruntée, ce fera fa ténacité à nfétudier qu’ un
feul maître. H en prendra certainement la manière
, & n’en prendra fur-tout que la manière.
I l lui reftera inférieur , parce que l’ artifte qu’ il
a choift pour guide , a étudié différens maîtres
& la nature, & que lui-même fe borne à n’étudier
qu’ un maître. Un homme peut mériter
fans doute qu’on l’étudie-, mais aqcun n’a pu
s’ élever affez au-defliis des autres, pour mériter
d’ être étudié feul.
Raphaël étudia d’ abord le Pérugin fon maître,
& iè borna tellement à l ’étudier , qu’ il étoit
difficile de diftinguer les ouvrages de l’ un
d’avec ceux de l’ autre •: mais portant enfuite
plus loin fes regards , il imita les grands con- :
tours de Michel-Ange , la couleur de Léonard ;
de Vinci & de F ra Bartolomeo -, il étudia celles
des antiques qu’ il put voir par lui-même , 8c
envoya des deflinateurs en Grèce pour lui ap- ;
porter au moins des deflins de celles qu’ il ne j
pouvoit étudier. C’ eft en réunifiant tant de modèles
, qu’ il devint lui-même un grand modèle
pour fes fucceffeurs : il ne prit pas une manière ■
empruntée , & , toujours imitateur , il refta
toujours original, (a rticle de M . L e v e s q v e ).
M ANIER E - NO IR E . Sorte de . gravure fur
cuivre. voye\ l’article Gr a v u r e : nous en décrirons
les procédés dans le Diélionnaire de
pratique.
M A N IÉ R É , ;(ad j.). On dit dans la langue
& l’ufage général qu’«n homme ejl maniéré : on
dit que le fty le d ’un auteur eft maniéré , qu’un
morceau de mufique , une fiatite , une fa ç a d e \
de bâtiment fo n t maniérés. Toutes ces expref-
fions tendent à défigner que les objets dont
on parle , ont de l ’affeélation , de la recherche
dans le caradère & dans les formes. On peut i
donc dire que le maniéré eft une mauvaife
imitation de la fimpliciré , du naturel, de la
nobleffe ou des grâces.
Le malheur des arts & des moeurs eft que
plus les fociétés humaines femblent connoître
le prix de certaines perfections, plus elles les ?
vantent fur-tout, 8c plus elles fubftituent fou-
vent à leur place l’ affectation qui forme le
maniéré. I l fembleroit que la véritable per-
feélion confifteroit, dans les arts & dans la morale
, à être parfait, fans , pour ainfi fiire , le
lavoir , comme la perfection de la beauté &
de la grâce dans l’es femmes , eft de pofféder
ces avantages fans s’en douter. La jeuneffe eft
l’âge qui adopte plus facilement le maniéré \
mais les grâces qui lui font naturelles , le
rendent pour l’ordinaire moins choquant, D’ailleurs
on lui pardonne volontiers des erreurs.
Les artiftes qui fe livrent à la fociété , font
fouvent entraînés , comme les jeunes gens dont
je viens de parler , au maniéré, & l’ exercice des
arts d’ imagination prolonge , pour ainfi d ire ,
dans plufieurs de ceux qui les cultivent , la
jeuneffe de l’ efprit. Auffi eft-il affez ordinaire
de voir des artiftes long-temps jeunes , foit
par quelques-unes des erreurs propres à cet
âge ,,foit auffi par les agrémens dont il eft doué.
I l eft un maniéré dans l’ art de peinture , qui
provient du méchanifme de l’ art. On pourrait
l ’appellér maniéré d'habitude 8c le premier dont
j ’ai parlé, maniéré de caractère. C’ e $ ce que
l’on entend aufli par le mot manière r Torfqu’ en
langage de peinture , on ne donne pas de fens
défavorable a ce mot.
L’ imperfeétion attachée à notre nature , eft
caufe que , pour acquérir la facilité néceffaire
à l’ exercice des talens , nous femmes obligés
dé répéter une infinité de fois les mêmes operations
j les mêmes mouvemens , les mêmes
procèdes., 8c de plier , par une longue habitude
, nos organes à l’ emploi que nous vou lons
leur donner. Cet exercice renouvellé produit
effeéUvement la facilité d’operer, mais
les organes contractent des habitudes ; je dirais
volontiers des tics. Ils s’ accoutument à une
forte de routine , défavorable à la perfection,,
car la perfection de l’ imitation doit approcher
de celle de la nature qui eft- inépuifable en
variétés.
Cette habitude , dont je viens de parler ,
ne fe borne pas à afièrvir les organes ; car
l’ efprit même , qui eft à la fois aCtif & paref-
feux , s’habitue auffi , quant aux opérations qui
le concernent , à repàffër, par lès routes qu’ il
s’ eft frayées -, de manière.-que.l’artifte fe laiffè
infenfiblement dominer par une double routine,
celle des organes & celle des idées. Son deffin
alors , fe s contours , f a touche , f a couleur ,fo n
choix d'harmonie ; d’ une autre part, f a com-
pofition , f e s airs de tè te , fes.exprefiion s, fes
difpofitions de fig u r e s , de grouppes . de drap
e rie s , de p lis , tout enfin fe reffent ,de cet ascendant
de l’habitude.
Arrêtons-nous encore un moment à cps détail^
pour les rendre plus intelligibles à ceux
qui rie les. connoiffent pas. Nous pafferons en-
fuite à ce qu’on peut adreffer à,çe,fiijet à-ceux
qui , exerçant les arts , entendent, comme on
dit ,• à demi -mot.
Le peintre obligé de. plier fa main à l’ u-
fage prompt & facile de la broffe ou du pin^-
ceau , pour appliquer & pour mêler les couleurs
, ou pour ajouter la touche qui donne
l’ame , la vie , le mouvement aux objets qu’ il
repréfente , acquiert une manière de parvenir
à ces opérations qu’il recommence fens c effe ,
& cette manière dans laquelle il fe renferme
fans s’ en appercevoir , à laquelle j l fe borne
enfin , devient tellement fenfible , : tellement
reconnoiffable, que , fans avoir approfondi Fart,
& fans beaucoup de raifonnemens , un marchand
, un homme du monde qui voit beaucoup
de tableaux , diftinguent les ouvrages
des différens maîtres. L’habitude contractée par
le peintre , devient donc une manière ou une
convention qu’il s’ eft: impofée & qui donne,
en quelque forte , le fin a lem en t de fes ouvrages.
I l devient reconnoiffable par des objets
répétés , comme l ’Ecrivain par certaines formes
de lettres & un auteur par certains tours 8s