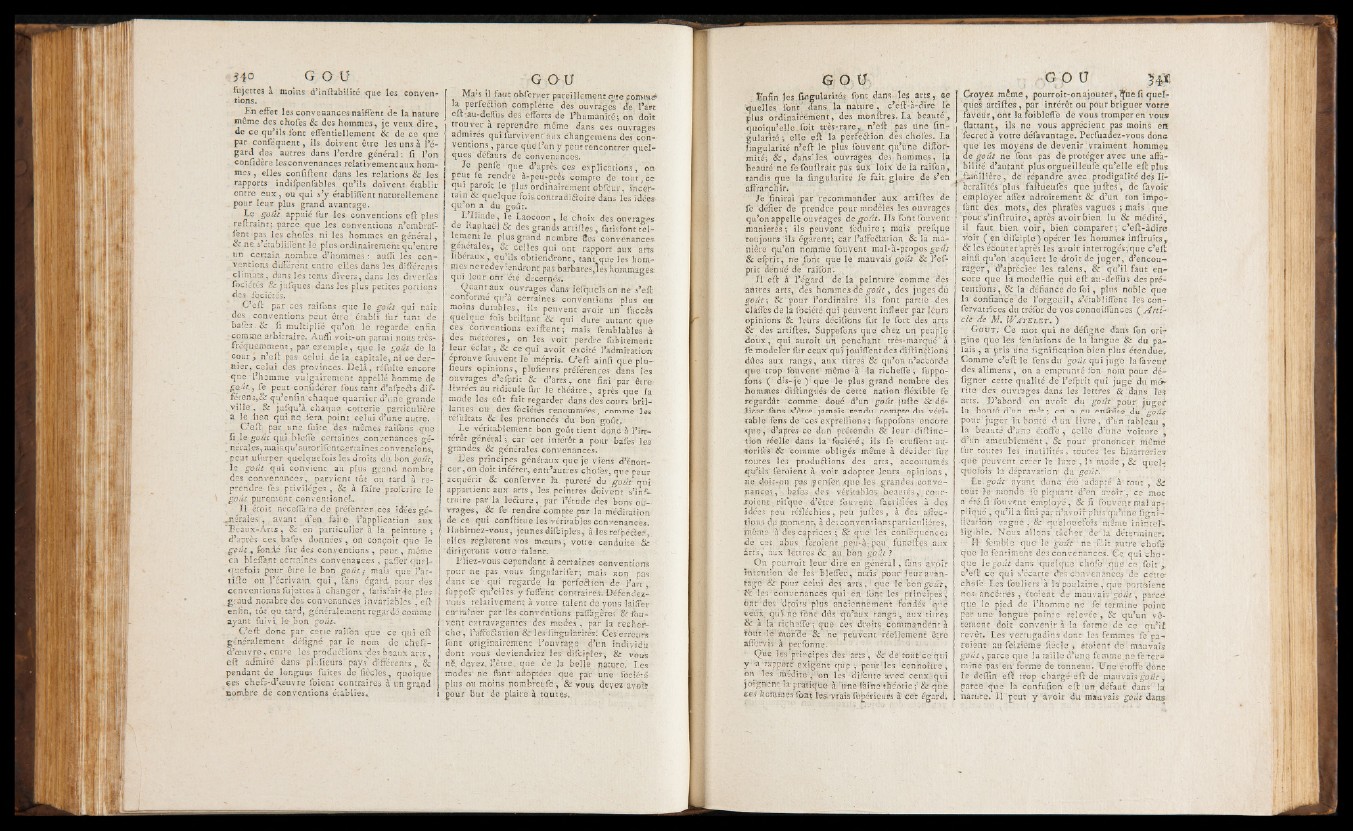
lujettes à moins d’inftabilité que les Conventions.
En effet les convenances naiffent de la. nature
même des chofes & des hommes, je veux dire,
de ce qu’ils font effentiellement 8c de ce que
par conlequent, ils doivent être les uns à l’égard
des autres dans l ’ordre général : fi l’on
confidere les convenances relativement aux hommes
, elles confident dans les relations & les
- apports indifpenfables qu’ ils doivent établir
entre e u x , ou qui s’ y établirent naturellement
pour leur plus grand avantage.
Le goût appuie fur les conventions eft plus
refirarnt; parce que les conventions n’ embraflent
pas les chofes ni les hommes en général,
& ne s’établifient le plus ordinairement qu’entre
un certain nombre, d’hommes : aufii les conventions
différent entre elles dans les, différents,
climats., dans les tems divers, dans les diverfes:
fociétés 8c jufques dans les plus petites portions
des fociétés. \
C’ efb par ces raifbns que le goût qui naît
des conventions peut être' établi fur tant 'de
bafes. & fi multiplie qu’on le régarde enfin
comme arbitraire. Auffi voit-on parmi nous très-
frequeinnient, par exemple", que le goût de la
cour 9 n’ efî pas celui de la capitale, ni ce dernie
r, celui des provinces. D elà , réfulte encore
que l’homme vulgairement appelle homme de
g o û t , fe peut eonfidérer fous tant d’afpe&s dif-
fë iehs,& qu’enfin'chaque quartier d’ une grande
v i l l e , & j.ufqu’à. chaque -c.otterie particulière
a le fien qui ne fera point celui d’ une autre, i *
C’ e fi par . une fuite, des mêmes raiforïs que
û le-goût qui bfoffe certaines convenances ge-
. nérales,mais.qu’aiitori lenteur ;aihes.con\réntions,
peut ufurper 'quelquefois les droits du. bon goût,
le goût qui convient au plus grand nombre "
des convenances, parvient tôt ou tard à reprendre
fes privilèges , 8c à faire ’pbolcrire le
\ go tic purement conventioneL
I l étoit nécefia:re de prefenter- .ces ideés gén
é ra le s ., avant d’en, faire- l’application aux
'Bcàux-Àrts , 8c 'en particulier a là peinturé ; -
d’après ces, bafes données , on conçoit que le
fondée fur des conventions, peut-, même -
en bleffant certaines convenascès , g&ffer miel-
que foi s pour être le bon goût.; mais que Fortifie
ou. l’ écrivain qui", fans egard pour des -,
conventions fujettes a changer , iàtisfait'iéj plus i
grand nombre des convenances invariables-, e fi ï
enfin, tôt qu. tard, généralement regarde comme :
ayant fuivi. le- bon ‘goût-. - ' -
C’ eft donc par cette raifon que ce qui eft
généralement défig/ié par Je nom de chefs-
d’oeuvre, e n fe , les. producHons.~dès beaux-- arts
e fi admire" dans'plufieürs' pays' d i f fé r e n t s 8c
pendant de longues fuites de fiècles, quoique ; 1
, çes chefs-d’oeuvre foierit contraires. a un grand
sombre de conventions établies*' ip U “
Ma>s il faut obferyer pareillement qge pomme1
la perfection complétte dès ouvràges de l’art
eft-au-d'efliis des efforts de l’humanité; on doit
trouver à reprendre même dans ces ouvrages
admires qui furvivènt aux charigemens des conventions
, parce que l ’on y peut rencontrer quelques
défauts de convenances.
Jë .penfq que d’ après, ces explications, on
peut fe rendre à-peu-près compte de tout.e e
qui paroît le plus ordinairement obfçur, incertain
& quelque fois, contradictoire dans les idées
! qu on a du goût.
L Iliad e , le Lâocoon, le choix dès ouvrages
de Raphaël 8c des grands artiftes, fatisfont tellement
le plus grand nombre des convenances-
generales, & celles qui ont rapport aux arts
liberaux,, qu’ils obtiendront, tant que ïes hommes
neredevîendront pas barbares,îés hommages,
qui leur ont été décernés;.
Quant aux ouvrages dans lelquels on ne s’ efl
conforme qu’à certaines, conventions ' plus ou
moins durables, ils peuvent avoir urr fuçcès
quelque fois brillant 8c qui dure autant que
ces conventions e xifient; mais femblables à-
des météores, on les voit perdre fubitemeiit
leur éclat j 8c ce quf avoi-t excité l’admiration-
éprouve fouvent le mépris. C’ efi ainfi que plü-
fieurs opinions, plufieurs préférences dans lès
ouvrages d’ efprit & d’arts, ont fini par être?
■ livrées au ridicule fur le théâtre, après que îa
mode les eût fait regarder dans des cours brillantes
ou des fociétés renommées, comme les
réfultats & le s prononcés du bon goût.
Le véritablement bon goût tient ddri.càl’ in-
térêt général ; car- cet intérêt à pour bafes1 les
grandes 8c générales convenances.
Des principes généraux que. je viens d’énoncer,
on doit inférer, entr’àutres chofes, que pour
acquérir 8c conferver là pureté du goût- qui
appartient aux arts, Tes peintres doivent s’in f-
truire p ar la leécure, par Fétu de des bons ouvrages,
8c fe rendre'compte par la méditation
de ce qui conftitue les .véritables convenances.
Habituez-vous, jeunes difbipJes,; a ie s refpèéler,
elles régleront vos moeurs, votre- conduite &
dirigeront votre talent..
Pliez-vous cependant à certaines conventions
pour ne ..pas. vous fing.ularifer; mais non pas.
dans ce qui regarde; la- pérfeâibn- de- F a rt,.
fuppofé qu’elles y fufient contraires. Défendez-
vous relativement, à votre- .talent de vous laifier
entraîner par lés cbnventions pafTageres" 8c Souvent
extravagantes des modes , par la recherc
h e , l’àffeifiati.on 8r lés fifiguiàfirési CeSerféâfs
font originairement Fouvrag.e- d’ün individu
dont vous deviendriez7 les* dificiples-, & vous
né, devez.L’ êtue.qtie d é jà belle nature. Les
modes1 ne font'" adoptées que par une fociété
plus ou moins nombreufé} & vous deyez ayoit
pour but ’ de plaire a tqutes.
Enfin le$ fmgularités; font dansées arts,, ee
quelles, font dans, la nature, c ’efDà-dïre le
pîiis ordinairement, dés monftres. La beau.te.,
quoiqu’ e lle . foit .très-rare,,, nfoft pas üne fin-
gularité ; elle efi la pèrfèéHon des chofes. La
fingularité n’ efi le plus fouvent qu’ une difformité;
dans'lès ouvragés des'hommes, la
beauté në fé fôüftràit pas auic loix de la raifon ,
tandis que. la fingularité fe fait, gloire dé s’en
affranchir
Je finirai par 'recommander aux artiftès de
fe défier de prendre pour modèles les ouvragés
qu’on appelle ouvrages de goût. Ils font iouvent
maniérés; ils peuvent féduire ; niais préfque
toujours ils égaient; car l’ affeétarion 8c la manière
qu’ on nommé fouvent mal-à-propos goût
8c elpf.it', ne font que le mauvais' 'go-pi 8c ,1’el-
prit dénué de raifon; ..
I l efi à l’égard de là peinturé comme dés
antres arts, des hommes dé goût , des juges du
goût ; & 'p o u r Fordïnàire ils font partië des
clafies de la fociété qui peuvent rnflner par leurs
opinions & leurs décifions fur le fort dés arts
8c des artiftes. Siippofons que: chez ufi peuple
doux, qui auroit un penchant ' tfès-inarqiié a >
fe modeler fur ceux qui jouiffent de3 diftinciiohs
dûes aux rangs, aux'titrés & qu’on ifaccorde
que trop fouvent7 même à la richeffé ; fuppo-
fons ( dis-je que le plus grand nombre des
hommes diftingués d-e cëtte nation flexible fe
regardât |comme doué d’ un goût jufie & délicat
fans s’ être jamais rendu compte du véritable
fens de 'ces' exprefïions ; fuppofons' encore
q u e , d’après ce don prétendu fx leur difiinc-
tio-n réelle dans la' fociété ,- ils -fe crufient aii-
rorifës' & comme obligés même à décider fur
toutes les produélions des arts, accoutumés
qu’ ils' feroient à- voir 'adopter leurs- opinions ,
ne doit-on. pas {genfer .que .fos ^grandéSiConve-
jiances bafes -,.dés vé.rkabl.es, ■ beautés c<xur-
«rpient rilquev;d’eti',é: fouvent,-facri.nées à des
idées peu réfléchies, peu juft'es, à des.afiec-
tipn.s dp jjjpmentj à dqsçonye^tian§particjiljère's,
même à'"des caprices ;. 8c que" lés 'cpnféquënces
de cet, abus . forojérit .pëii-àypeu ( funefies aux
arts,’ aux" lettres'& au bon goXii ?
On pourrait leur dire en généràl , fans "avoir
tntention dé-fes'Blefiér , 'mais”;pourXétiràvàn-
ifâg^ 8é pour celui des" àiTs, que lé bbn'géïîr,
8c le s j "convenancës qui én font les'■ principes-;
bnt‘;des droits- -plus anciennement "fondés? épie
ceux, qùt.fi'e font dûs qVâiix rangs -, !âùx' titres
8c a la- richefie ; "que ë.és' droits .ë'ommandërit à
ïôii't Jd ' monde 8c ne' peuvent réellement être
àftenjs -à per forme."
' Qée les principes des arts , 8c de t-out;ce qui
y -a rapport' exigent qir^^^pour‘ les ’éonhoîtrej
on -lés -médité-;!îon les -difcUte avec1 ceux -qui
joignent la*pratique à ’tme fàihé t-héôrie y 8c qti;e
«es hommes1 font lés.‘yrais fügérieuis à- cét égard;
Croyéz même, pourroit-onajqutef,^nëfi quef*
qües artiftes, par intérêt ou pour briguer votre
favéur, ont la foibleffe de vous tromper en vous
flattant, ils ne vous apprécient pas moins en
Teçret à votre défavantage. Perfuadez-vous dons
que lés moyens de devenir vraiment hommes
de goût në font pas de protéger avec une affabilité
d’autant plus orgueilléufe qu’elle e fi plus
^ fa im liè réd é : répandre avec prodigalité des Ii-
r béraTitqs',pliis fallu eu fes que jufteS, dé favoir
employer affeZ adroitement 8c d’un ton imposant
des' mots, dés phrafes vagues ; mais que
pour s’ inftruire, après avoir bien lu & médité,
il faut., bien vo ir, bieh comparer; c’ efi-àdire
Voir ( en difcjpleyopérer les hommes infiniitsy
& les ecoütef'aprë.t lés avoir interrogés;que c’eft
ainfi qu’on acquiert le droit de juger, d’ encourager,“
d’ aprecier les talens, 8c qu’il faut encore
que là modéftie qui e fi aii-deffus des prétentions
, 8c la défiance de fo i , plus noble que
la confiance de Forgea i l , s’établifient les con-
fervatrfees du tréfor de vos connoifiances { Artï~-
ch de M, W/tTELÉT. )
G o û t ; Ce mot qui ne défigne dans fon origine
que lès fonfàtions' de la langue 8c du palais
, à^ pris une lignification bien plus étendue.
Comme c’ e îl le fens du goût qui jugé la faveuè
dès àlimens , on a emprunté fon nom pour dé-
figner cette qualité de Fefprit qui juge du m écrite
des ouvrages dans lés lettres & dans les
arts. D’abord on avoir du goût' pour; ju g e r
la bonté d’un mit ; ch a ’■ ëil enfo-ite du. ‘goût
pour juger /la bonté d un liv re , d’ un tableau
la béante d’ ufie étoffe j celle d’une Voiture ,
d’ irn ameublement, & pour prononcer même
fur toures les . inutilités, routés; les bizarreriev
.qiië peuvent créer le lu x e , la mode , & quel-;
q-ii-efois îa dépravation' du goût.'
L e .g o û t ayant donc été adapté à - rout , &
tout-lé- mondé fe piquant d’en avoir , Ce mot
à été. fi Tou vent employé, & fi fouvefir mal àp--
plïqüé.j qu’il a fini par n’ aV o i r p ÎU s;qh’:d n e figni-
iicattoh v?.gfie , & quelquefois meme in in tel-
figibî'è. Nous allons tâcher "de-la déterminer;
• flj femb-le que- l è 'gcmr ne Jo ie ; antre choTé
que le fentiment des convenances. C e qui choque
le goût dans quelque choie ’.que c e \ fo ir,.
c’ë f i ce qui s’écarte dés cbnvenàncé^ de cëtte?.
chérë-'Les fouliers à la poulain e , que portôient
rtos< àftéêti'és ,- etefient •de’"mauvais , parce
que le pied de i’Jiomme në fe' te'r.iriine point
phé une- lotigiiè-' pomre;- relevée-, & qu’uii vêtement
doit convenir à la forme de ce qu’ il
revêt." Les vertugadins dont les femmes fe pa-^
roient au feiziëme fiécle , étoienf de' mauvais
goû t, parce que la raille d’ une femme ne fe te r -
ratrié pas-en* forme de tonneau. Lfoe“ étoffe dont
le dé {fin e fi trop chargé^ efi- de mauvais go üt l
parce que là confufiom efi;un défaut dans’ la
nature. I l peut y avoir du mauvais goût dans