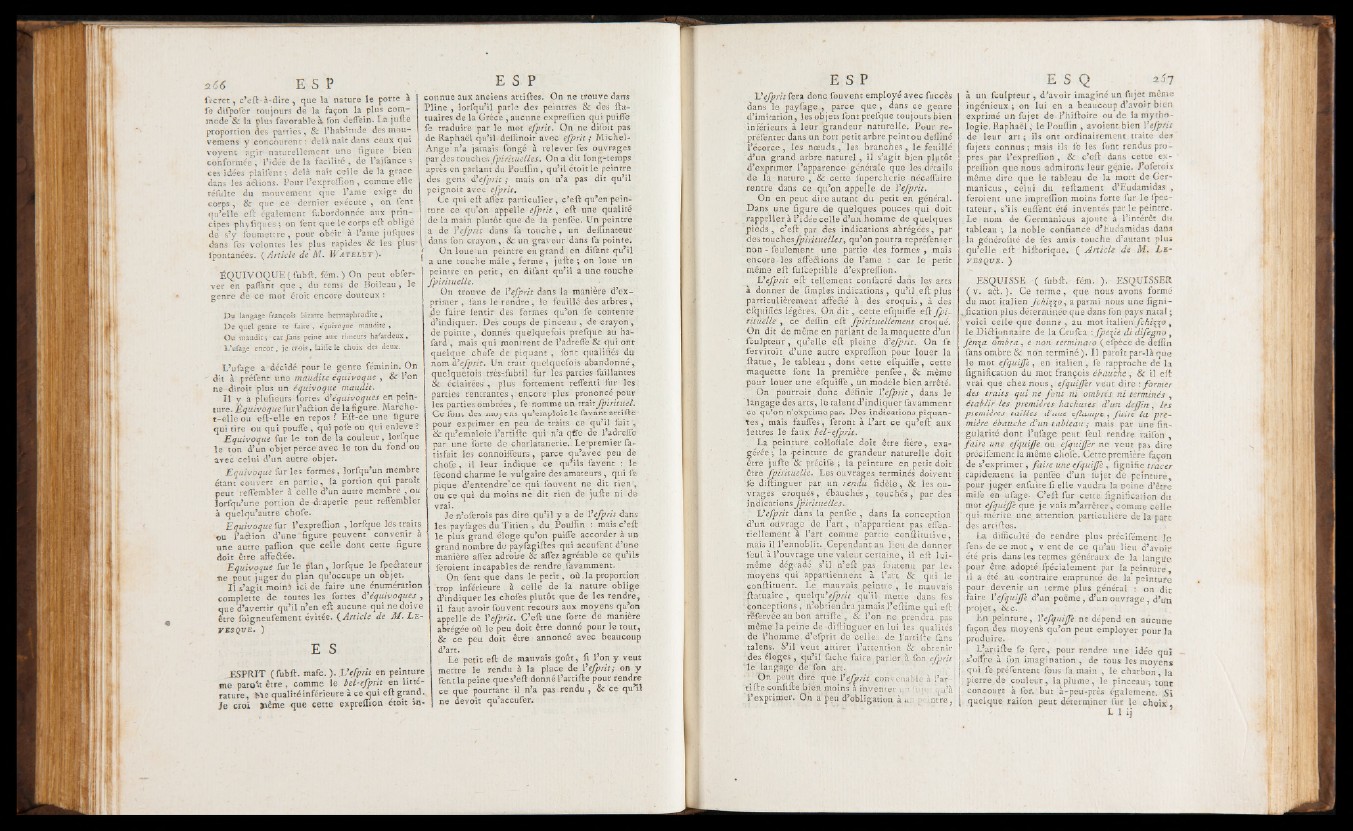
2 66 E S P
fe c re t , c’ e ft-à -d ire , que la nature le porte a
fe difpofer toujours de la façon la plus commode
& la plus favorable à fon deffein. La jufte
proportion des parties , & l’habitude des mou-
vemens y .concourent *. delà naît dans ceux qui
voyent agir naturellement une figure bien
conformée, l’ idée d e là fa c ilite, de l’aifance ;
ces idées plaifent ■, delà naît celle de la grâce
dans les actions. Pour l’expreflion , comme elle
réfulte du mouvement que l’ ame exige du
corps, & que ce dernier exécute , on lent
qu’ elle eft également fubordonnée aux principes
phyfiques •, on fent que le corps eft obligé
de s’ y foumettre , pour obéir à l’ ame jufques
dans fes volontés les plus rapides & les plus*
lpontanées. ( Article de M. U'a t e l e t ).'
ÉQUIVOQUE (fub ft. fém.) On peut obfer-
ve r en paffant que , du tems de Boileau , le
genre de ce mot étoit encore douteux :
Du langage françois bizarre hermaphrodite,
De qu el genre te faire, équivoque maudite ,
Ou maudit; car .fans peine aux rimeurs ha sa rd eu x,
L’ufage encor, je crois, lai fie le ch o ix des deux.
L ’ufage a-décidé pour le genre féminin. On
" dit à préfent une maudite équivoque , 8ç l’on
ne diroit plus un équivoque maudit.
I l y a plufieurs fortes d’ équivoques en peinture.
Équivoque furl’ a&ion de la figure. Marche
E S P
connue aux anciens artiftes. On ne trouve dans
Pline , lorfqu’ il parle des peintres & des Actuaires
de la Grèce, aucune expreftion qui puiffe
fe traduire par le mot efprit. On ne difoit pas
de Raphaël qu’ il-delfinoit avec efprit ,* Michel-
Ange n’ a jamais fongé à relever fes ouvrages
par des touches fpirituelles. On a dit long-temps
après en parlant du Pouflin, qu’ il étoit le peintre
des gens à?efprit ; mais on n’a pas dit qu’ il
peignoit avec efprit.
Ce qui eft affez particulier, c’ eft qu’ en peinture
ce qu’on appelle e fp r it , eft une qualité
de la main plutôt que de la penfée. Un peintre
a de l’efprit dans fa touche , un deflinateur
dans fon crayon, & un graveur dans fa pointe.
On loue un peintre en grand:en difant qu’ il
a une touche mâle , ferme , jufte ; on loue un
peintre en petit, en difant qu’ il a une touche
fpirituelLe.
On trouve de l’ efprit dans la manière d’exprimer
, l'ans le rendre, le feuille des arbres ,
de faire fentir des formes qu’on fe contenté
d’ indiquer. Des coups de pinceau , de crayon ,
de pointe , donnés quelquefois prefque au ha-
fard , mais qui montrent de l’adreffe & qui ont
quelque chofe de piquant , font qualifies du
nom & efprit» Un trait quelquefois abandonné y
quelquefois très-fubtil îur les parties fai-llantes
& éclairées ., plus fortement reffenti fur les :
parties rentrantes , encore plus prononcé pour
les parties ombrées, fe nomme un trait fpirituél.
elle ou e ft-elle en repos ? E f t - « une figure Ce font des moyens ^ ’emploie le favantamftfe
- r - • 1 1 — pour lait ,
q u i'n ’a adreffe
qui tire ou qui pouffe , qui pofe ou qui enlève ?
Equivoque fur le ton de la couleur 3 lorfque
le ton d’ un objet perce avec le ton du fond ou
avec celui d’ un autre objet.
Equivoque fur les formes , lorfqu’ un membre
étant couvert en partie, la portion qui pâroît
peut reffembler à celle d’ un autre membre , ou
lorfqu’une portion de -draperie peut reffembler
à quelqu’ autre chofe.
Equivoque fur l ’ expreflion , lorfque lès traits
ou l’ a&ion d’ une figure peuvent convenir à
une autre paflion que celle dont cette .figure
doit être afleélée.
Equivoque fur le plan, lorfque le fpe&ateur
ne peut juger du plan qu’occupe un objet. ^
I l s’ agit moini ici de faire une énumération
complette de toutes les fortes d'équivoques ,
que d’avertir qu’il n’ en eft aucune qui ne doive
être foigneufement évitée. ( Article de M . L e -
V E S Q U E . )
E S
JE SP R IT (fubft. mafe. ) . Vefprit en peinture
me parolt être , comme le bel-efprit en littérature,
Me qualité inférieure à ce qui eft grand.
J e croi *iême que cette expreftion étoit inpour
exprimer en peu de traits ce qu il fait .
8c qu’ emoloie l’ artifte qui n’a qffe de l’ adreffe
par une forte de charlatanerie.,Le;premierfa-
tisfait les connoiffeurs , parce qu’ avec peu dé
ch oie , il leur indique ce qu’ ils favent : le
fécond charme le vulgaire des amateurs, qui lë
pique d’ entendre" ce qui fouvent ne dit rien ,
ou ç e qui du moins ne dit rien de jufte ni de
vrai. ||
Je n’ oferois pas dire qu’il y a de Vefprit dans
les payfages du T itien , du Pouflin : mais c’ eft
le plus grand éloge qu’on puiffe accorder à un
grand nombre du payfagiftes qui accufent d’une
manière affez adroite 8c affez agréable ce qu’ ils
feroient incapables de rendre.favamment.
On fent que dans le petit , où la proportion
trop inférieure . à celle de la nature oblige
d’ indiquer les chofes plutôt que de les rendre,
il faut avoir fouvent recours aux moyens qu’on
appelle de Vefprit. C’ eft une forte de manière
abrégée où le peu doit être donne pour le tout,
& ce peu doit être annoncé avec beaucoup
d’art.
Le petit eft de mauvais goût, fl l’on y veut
mettre le rendu à la place de l’ efprit; on y
fent la peine que s’ eft donné l’artifte pour rendre
ce que pourtant il n’a pas rendu , & ce qu’il
ne devoir qu’ accufer.
E S P
L'efprit fera donc fouvent employé avec fuccès
dans le payfage., parce q u e , dans ce genre
d’ imitation, les objets font prefque toujours bien
inférieurs à leur grandeur naturelle. Pour re-
préfenter dans un fort petit arbre peint ou defliné
l’écorce, les noeuds., les branches, le feuille
d’ un grand arbre naturel, il s’agit bien plutôt
d’exprimer l’apparence- générale que les détails
de la nature , & cette fupercherie néceffaire
rentre dans ce qu’on appelle de l'efprit.
On en peut dire autant du petit en général.
Dans une figure de quelques pouces qui doit
rappeller à l’ idée celle d’ un homme de quelques
pièids , c’ eft par des indications abrégées, par
des touchesfp irituelles, qu’on pourra repréfenter
non - feulement une partie des formes } mais
encore les affrétions de l’ame : car le petit
même eft fulceptible d’ expreflion.
E'efprit eft tellement confacré dans les arts
à donner de Amples indications, qu’ il eft plus
particulièrement affe.éié à des croquis, à des,
efquifles légères. On d i t , cette efquifle eft f p i :-
ritiielle , ce deflin. eft fpirituellement croqué.]
On dit de même en parlant de la maquette d’un i
fculpteur, q u e lle eft pleine d’efprit. On fe
ferviroit d’ une autre expreftion pour louer la
ftatùe, le tableau , dont cette efquifle, cette
maquette font la première penfée, & même
pour louer une efquifle, un modèle bien arrêté.
On pourroit donc définir l'e fp r it , dans le
langage des arts., le talent d’ indiquer favamment
ce qu’on n’exprime pas. Des indications piquant
e s , mais fauffes , feront à l’ art ce qu’eft aux
lettres le faux bel-efprit.
La peinturé colloflale doit être fière, exagérée
; la -peinture de grandeur naturelle doit
être jufte 8c précife -, la peinture en petit doit
être fpirituelLe. Les ouvrages, terminés doivent
fe diftinguer par un rendu fid èle, 8c les ouvrages
croqués , ébauchés ,. touchés , par des
indications fp irituelles.
Uefprit dans la penfée , dans la conception
d’un ouvrage de l’a r t , n’ appartient pas effen-
tiellement à l’ art comme partie conftitutive,
mais il l ’ ennoblit. Cependant au lieu de donner
feul a l’ouvrage une valeur certaine, il eft lui-
même dégradé s’ il n’ eft pas foutenu par les
moyens qui appartiennent a l’ art. & qui le
çonftituent. Le mauvais, peintre , l e mauvais:
ftatuaire , quelqu’ e/Jpm. qu’il mette dans fes
conceptions , n’ obtiendra jamais l’ eftime qui eft
rtfervée au bon artifte', 8c l’on ne prendra pas
même' la peine de -diftinguer en lui les qualités
de l’homme d’ efprit de 'celles de l’artifte fans
talens. S’ il veut attirer l’attention & obtenir
des éloges , qu’ il fâche faire parler.à fon efprit
‘ le langage de’ Ton art.
On peut dire que Ÿ efprit convenable à j ’ ar-j
tifte.confi.fte bien moins a inventer un iujer qu’à
l ’ exprinier. On à peu d’obligation à un peintre
E S Q 257
à un fculpteur , d ’avoir imaginé un fujet même
ingénieux; on lui en a beaucoup d’avoir bien
exprimé un fujet de - l’hiftoire ou de la mythologie.
Raphaël,' le Pouflin , avoient bien l'efprit
de leur art ; ils ont ordinairement traité des
fujets connus ; mais ils fe les font rendus propres
par l’ expreflion, 8c c’eft dans cette ex-
pr'efliôn que nous admirons leur génie. J’oferois
même dire que le tableau de la mort de Ger-
manicus, celui du teftament d’Eudamidas ,
feroient une impreflion moins forte fur le fpec-
tateur, s’ ils euffent été inventés par le peintre.
Le nom de Germanicus ajoute a l’intérêt du
tableau ; la noble confiance d’ Eudamidas dans
la générofité de fes amis touche d’ autant plus
qu’ elle eft hiftorique. ( Article de M. L e v
é s que. )
ESQUISSE ( fubft. fém. ). ESQUISSER
( v . aét. ), Ce terme , que nous avons formé
du mot italien Jchi-tfo, a parmi nous une lignific
a t io n plus déterminée que dans fon pays natal ;
'v o ic i celle que donne, au mot italien fe h i^ o y
le Dictionnaire de la Crufca :. fpezie di difegno ,
fen \a ombra, e non terminaro (efpèce de deflin
fans ombre 8c non terminé). I l paroît par-là que
le mot efquijfe, en italien, fe rapproche de la
lignification du mot françois ébauche, 8c il eft
vrai que chez nous, efquijfer veut dire '.former
des traits qui ne fo n t ni ombrés ni terminés ,
établir les premières hachures d'un deffin, Les
premières tailles d’une efiampe, fa ir e la p remière
ébauche d'un tableau ; mais par une fin-
• gularité dont l ’ufage peut feul rendre raifon ,
fa ir e une efquijfe ou efquijfer ne veut pas dire
précifément la même chofe,-Cette première façon
de s’ exprimer , fa ire une efquijfe ,. fignifie tracer
rapidement la penfée d’ un lujet de peinture,
pour ju g e r enfuite fi elle vaudra la peine d’être
mile en ufage. C’ eft fur cette lignification du
mot efquijfe que je vais m’arrêter , comme celle
' qui mérite une. attention particulière de la part
des artiftes.
La difficulté de rendre plus précifément le
fens de ce m o t, v ent de ce qu’au lieu d’avoir
été pris dans les termes généraux de la langue
pour être, adopté Spécialement par la peinture
il a été. au .contraire emprunte de la peinture
pour devenir un terme plus général : on dit
faire l 'efquijfe .d’ un poëmë, d’ un ouvrage, d’ un
projet, & ç .
En peinture, Vefquijfe ne dépend en aucune
. façon des moyens qu?on peut employer pour la
produire.
l^ lr iifte fe fe r t , pour rendre une idée qui
s?offre à fon, imagination , de tous les moyens
. qui fe préfentent fous fa.main , lë charbon, la
pierre :de couleur., la plume, le pinceau ; tout
concourt à for, but à-peu-près également. .Si
I quelque raifon peut déterminer fur le choix
t i :: 3