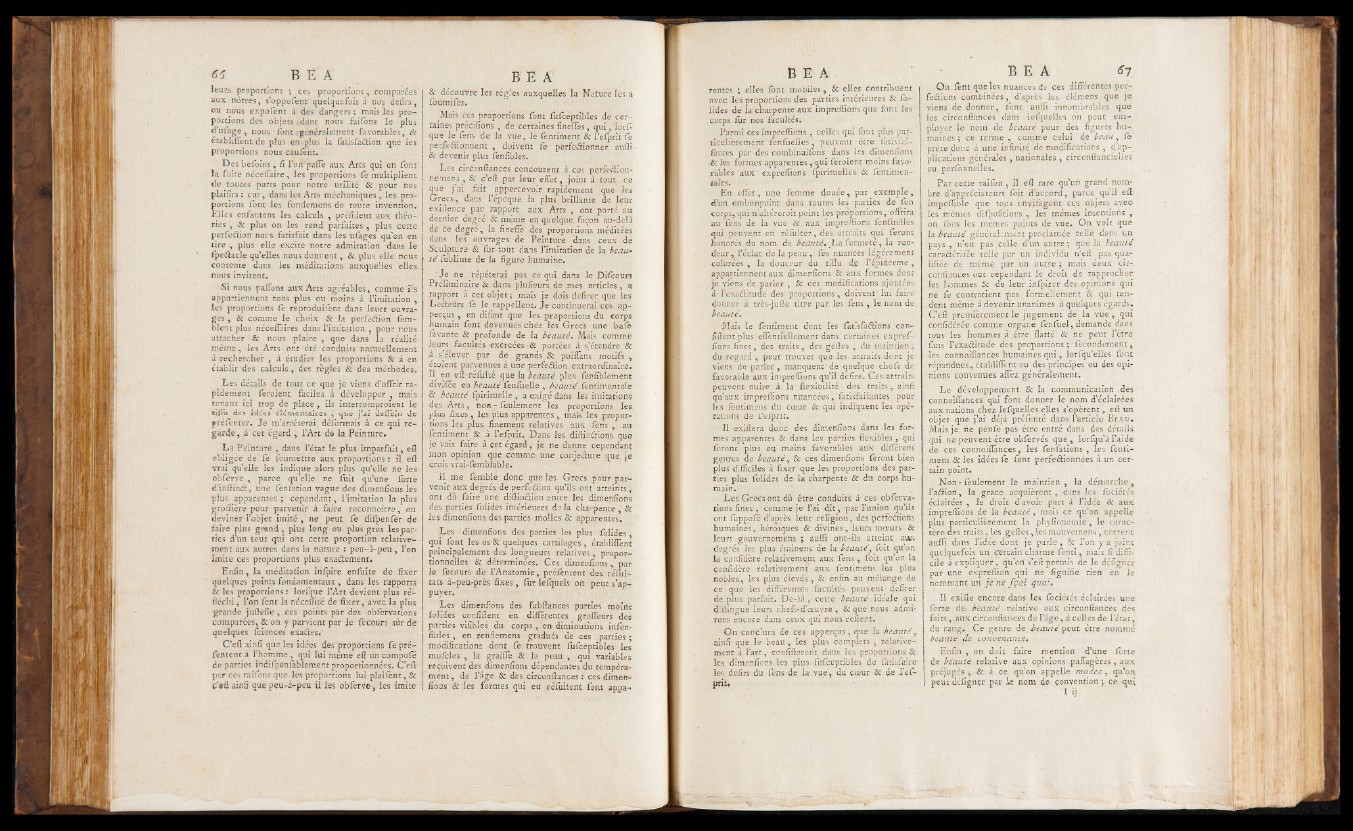
leurs proportions ; ces proportions, comparées"
aux nôtres, s’oppofent quelquefois à nos defirs,
ou nous expo fent à des dangers ; 'mais le s proportions
des objets -„dont nous faifons le plus
dufage , nous font jgéaéxalement favorables, &
etabliuent de plus en plus la fatisfaâion que les
proportions nous, caufent;
Des befoins , fi l’oii'paffè aux Arts qui en font
la fuite néceffàire, les proportions fe multiplient
de toutes parts pour notre utilité & pour nos
plaifirs : car, dans les Arts méchaniques, les proportions
font les fondemens de toute invention.
Elles enfantent les calculs , préfident aux théories
, & plus on les rend parfaites , plus cette
perfeétio.n nous fatisfait dans les ufages qu'on en
tire , plus elle excité notre admiration dans le
fpeétacle qu’elles nous donnent, & plus elle nous
contente dans les méditations auxquelles elles,
nous invitent.
S i nous paffons aux Arts agréables, comme ils
appartiennent tous plus ou moins à l’imitation ,
les proportions fe reproduifent dans leurs ouvrages
, & comme le choix & la perfection fem-
blent plus néceflàires dans l’imitation , pour nous
attacher & nous plaire , que dans la réalité
même, les Arts ont été conduits naturellement
à rechercher , à étudier les proportions & à en
établir des calculs , des règles & des méthodes.
Les détails de tout ce que je viens d’offrir rapidement
feroient faciles à développer , mais
tenant ici trop de place , ils interromproient le
tifîù des idées élémentaires , que j’ai deffein de
préfenter. J e m’arrêterai déformais à ce qui regarde
, à cet égard , l’Art de la Peinture,
L a Peinture , dans l’état le plus imparfait, eft
obligée de fe foumettre aux proportions : il efl
vrai qu’elle les indique alors plus qu’elle ne les-
ôbferve , parce qu’elle ne fuit qu’une forte
d’inflinél, une fenfation vague des dimenfions les
plus apparentes ; cependant, l’imitation la plus
roffière pour parvenir à faire reconnoître, ou
eviner l’objet imité , ne peut fe difpenfèr. de
faire plus grand , plus long ou plus gros les parties
d’un tout qui ont cette proportion relativement
aux autres dans la nature : peurà-peu, l’on
Imite ces proportions plus exactement.
Enfin, la méditation infpire enfûite de fixer
quelques points fondamentaux , dans les rapports
& les proportions : lorlque l’Art devient plus réfléchi
, l’on fent la néceflité de fix e r, avec la plus
grande juftefîe , .ces points par des: obfervations
comparées, & on y parvient par le fbcours sur de
quelques fciences exaéfes.
C’efl ainfi que les idées des proportions fe pré-
fentent a l’homme , qui lui même efl un compofé
de parties indifpenfablement proportionnées. C’efl
par ces raifons que.les-proportions lui. plaifênt, &
p «û ainfi que peu^à-peu il les obferve , les imite
& découvre les régies auxquelles la Nature les a
fbumifes.
Mais ces proportions font fùfceptibles de certaines
précifions , de certaines fin elfes, qui, lo r f
que le fens de la vue, le fentiment & l’efprit fe
perfectionnent , doivent fè perfectionner aufli
& devenir plus fenfîbles1.
Les circonftances concourent à ces perfedion-
nemens , & p’eft par leur effet, joint à tout ce
que- j’ai fait appercevolr rapidement que les
Grecs, dans l’époque la plus brillante de leur
exiftence par rapport aux Arts , ont porté au
dernier degré & même en quelque, façon au-delà
de, ce degré , la finefïe des proportions méditées
dans les ouvrages-de Peinture dans ceux de
Sculpture & fur-tout dans l’imitation de la beau*
t é fublime de la figure humaine.
Je ne répéterai pas ce qui dans le Difcours
Préliminaire & dans plufieurs de mes articles, a
rapport à cet objet; mais je dois defirer que les
Ledeürs fe le rappellent. J e continuerai cçs ap-
perçus , en dîfant que les- proportions du corps
humain font devenues'chez lés Grecs une bafe
-lavante & profonde de la beauté. Mais comme
leurs facultés exercées-& portées à s’étendre &
à s’élever par de grands & püiffkns motifs ,
etoient parvenues à,une perfection extraordinaire.
Il en efl réfulté que la beauté plus fenfiblement
divifée en beauté fènfuejle , beauté fent'imentale
& beauté fpîrituelie , a exigé dans les imitations
des Arts, non - feulement les proportions les
plus fixes, les plus apparentes, mais les proportions
les plus finement relatives aux fens , au
fentiment & à l’efprit. Dans les diftinCtions que
je vais faire à cet égard, je ne donne cependant
mon opinion que comme, une conjecture que je
crois vrai-fembîàble.
Il me femble donc, que les Grecs pour parvenir
aux degrés de perfection qu’ils ont atteints,
ont du- faire une diflindion entre les dimenfions
des parties foiides intérieures de la charpente , &
les dimenfions des parties molles & apparentes.
Lés dimenfions des parties les plus foiides,
qui font les os & quelques cartilages , établiffent
principalement des longueurs relativesproportionnelles
8c déterminées. Ces dimenfions , par
le feeours de l’Anatomie, préfentent des refui—
tats à-peurprès fixes , fur lefquels on peut s ap»
puyer.
Les dimenfions des fubflances parties moins
foiides confiflent en différentes grofïèurs des
parties vifibles du ' corps , en diminutions infèn-
fibles , en rènflemens gradués de ces parties ;
modifications dont fe trouvent fùfceptibles les
mufcles , la graiffe & la peau , qui variables
reçoivent des dimenfions dépendantes du tempérament,
de l’âge & des circonftances : ces dimen-
fious & les formes qui eu réfiiitent font appa-.
rentes ; elles font mobiles, & elles contribuent
avec les proportions des parties intérieures & fo-
lides de la charpente aux impreffions que font les
corps fur nos facultés.
Parmi ces impreffions , celles qui font plus particulièrement'
fenfuelles, peuvent être iatisfaï-
fântes par des combinaifons dans les dimenfions
& les formes apparentes ,-qui feroient moins favorables
aux expreffions fpirituelles & fentimen-
tales.
En effet, une femme doüée, par exemple,
d’un embonpoint dans toutes les parties de fon
corps, qui nlaltéreroit point lés proportions, offrira
au fens de la vue &,-aux impreffions fenfuelles
qui peuvent .en rélulter, des attraits qui'.feront
honorés du nom de beauté. L a fermeté, la^ rondeur
, l’éclat de la peau , fes nuances légèrement
colorées , la douceur du tiiïu dg l’épidèrme,
appartiennent aux dimenfions & aux formes-dont
je viens de parier , & cés modifications ajoutées
à l’exaCtitude des proportions, doivent lui faire
donner à très-jufte titre par les fens , le nom de_
beauté.
Mais le fentiment dont les fat.’sfaCtions con-
fiftent.plus efTentièliement dans certaines expreffions
fines, des traits, des geftes , du maintien,
du regard, peut trouver que les attraits dont je-'
viens de parler, manquent'de quelque chofe de
favorable aux-impreffions qu’il defire. Ces attraits
peuvent nuire à la flexibilité des traits, ainfi
qu’aux impreffions nuancées, fatisfaifantes pour
les fentimens du coeur & qui indiquent les opérations
de l’efprït.
Il exiftera donc des dimenfions dans les formes
apparentes & dans les parties flexibles, qui
feront plus ou moins favorables aux d-ifférens •
genres de beauté, & ces dimenfions feront bien
plus difficiles à fixer que les proportions des parties,
plus foiides de la charpente & du corps humain.
Les Grecs ont dû être conduits à ces obfervations
fines;,y comme je l’ai dit, par l’union qu’ils
ont fuppofé d’après leur religion, des perfections
humaines, héroïques & divines, leurs moeurs &
leurs gouvernemèns ; auffi ont-ils atteint aux
degrés les plus éminens de la beauté^ foit qu’on
la cpnfidère relativement aux fens , foit qu’on la
çonfidère relativement aux fentimens les plus
nobles., les plus élevés, & enfin au mélange de
ce que les différentes facultés peuvent defirer
déplus parfait.. .De-la , cette beauté idéale qui
diflingue leurs chefs-d’oeuvre , & que nous admirons
encore dans ceux qui nous réftent.
On conclura de ces apperçus, que la beauté,
ainfi que. le beau, les plus complets , relativement
à l’a rt, confiftëront dans les proportions &
les dimenfions les plus fùfceptibles de fatisfaire-
les défies du fens de la vue, du coeur & de i’ef-
prit.
On fent que les nuances de ces différentes per-
feétions combinées, d’après les élémens que je
viens de donner, font auffi innombrables que
les circonftances dans lefquelles on peut employer
le nom de beauté pour des figures humaines
; ce terme , comme celui de beau, fe
prête donc à une infinité de modifications , d’applications
générales , nationales , circonflancielles
ou perfonnelles.
Par cette raifon , il efl rare qu’un grand nombre
d’appréciateurs foit d’accord, parce qu’il efl
impoffible que tops enyifagent ces objets avec
les .mêmes d-ifpofitions , les mêmes intentions ,
ôu_ fous les mêmes points de vue. On voit que
la beauté généralement proclamée telle dans un
pays , n’eit pas Celle d’un autre ; que la beauté
caraélérifée telle par un individu n’eft pas qualifiée
de même par un autre ; mais deux circonftances
ont cependant le droit de rapprocher
les hommes & de leur infpirer des ..opinions qui
ne fe contrarient pas formellement &' qui tendent
même à devenir unanimes à quelques égards.
C’eft premièrement le jugement de la vue , qui
confidérée comme organe .fenfiiel, demande dans
tous les hommes .à être flatté & ne peut l ’être
fans Texa&itude des proportions ; fècondement,
les connoifiànces humaines q u i, lorfqu’elles font
répandues, établiflënt ou des principes ou des opinions
convenues affez généralement.
L e développement & la communication des
'eonnoifïaïices qui font donner le nom d’éclairées
aux nations chez lefquelles elles s’opèrent, eft un
objet que j’ai déjà préfenté dans l’article B e a u ,
Mais je ne penfe pas être entré dans des détails
qui ne peuvent être obfervés que , lorfqu’à l’aide
de ces connoiflànces, les fenfâtions , les fentimens
& les idées fe font perfectionnées à un certain
point.
Non-feulement le maintien , la démarche ,
l’aCion, là grâce acquièrent, dans les fociétés
éclairées , le droit d’avoir part à l ’idée & aux
impreffions de la beauté, mais ce qu’on- appelle
plus particulièrement la phyfionoinie , le caractère
des traits, les geftes, les mouvemens , entrent
auffi dans l’idée dont je parle, & l’on y a joint
quelquefois un certain charme fenti, mais fi difficile
à expliquer , qu’on s’eft permis de le défîgner
par une exprefïïon qui ne fignifie rien en le
nommant un j e ne f ç a i quoi•
Il exifte encore dans les fociétés éclairées une
forte de- beauté relative aux circonffances des
faits, aux circonftances de l’âge, à celles de l ’état,
, du rang. Ce genre de beauté peut être nommé
beauté de. convenance.
Enfin , on doit faire mention d’une forte
de beauté relative aux opinions paffagères, aux
préjugés -, & à ce qu’on appelle modes , qu’on
peutfftfignçr par ie nom de convention; ce qui
I ij