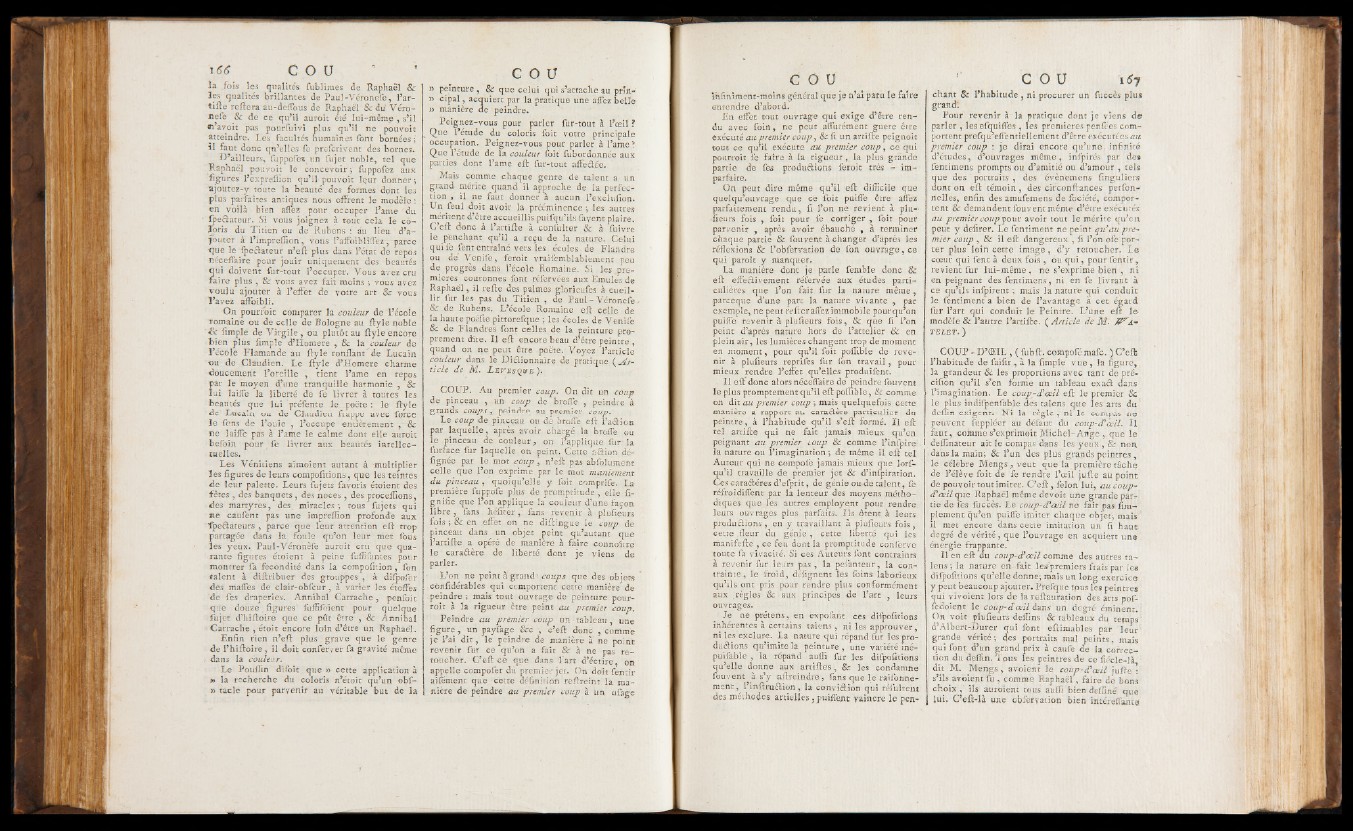
la fois les qualités fublimes de Raphaël 8c
les qualités brillantes de Paul-Véronefe, l’ar-
tifte reliera au-deffous de Raphaël 8c du Véro-
nefe & de ce qu’il auroit été lui-même , s’il
<n avoit pas pourfuivi plus qu’il ne pouvoir
atteindre. Les facultés humaines font bornées;
àl faut donc qn’elles fe prefcrivent des bornes.
D’ailleurs, fuppofe* un fujet noble, tel que
Raphaël pouvoir le concevoir ; fuppofez aux
figures l’expreflion qu’il- pouvoit leur donner ;
ajoutez-y toute la beauté des formes dont les
plus parfaites antiques nous offrent le modèle :
en voilà bien allez pour occuper l’ame du
fpeélateur. Si vous joignez à tout cela le compris
du Titien ou de. Rubens : au lieu d’ajouter
à l’imprellion, vous l’affoibliffez, parce
<jue le fpeélateur n’eft plus dans l’état de repos
néceffaire pour jouir uniquement des beautés
cui doivent fur-tout l’occuper. Vous avez cru
faire plus , 8c vous avez fait moins ; vous avez
voulu ajouter à l’effet de votre art & vous
l’avez affoibli.
On pourroit comparer la couleur de l’école
romaine ou de celle de Bologne au ftyle noble
fimple de Virgile, ou plutôt au ftyle encore
Bien plus fimple d’Homerë , 8c la couleur de
l’école Flamande au ftyle ronflant de Lucain
•ou de Claudien. Le ftyle d’Homere charme
doucement l’oreille , tient l’ame en repos
par le moyen d’une tranquille harmonie , 8c lui laiffe la liberté de fe livrer à toutes les
beautés que lui préfente le poète : le ftyle
de Lucain ou de Claudien frappe avec force
le fens de l’ouie , l’occupe entièrement &
ne laiffe pas à l’ame le calme dont elle auroit
belbin pour fe livrer aux beautés intellectuelles.
Les Vénitiens aimoient autant à multiplier
les figures de leurs compofitions, que les teintes
de leur palette. Leurs fujets favoris étoient des
fêtes, des banquets, des noces , des proceflîons,
des martyres, des. miracles; tous fujets qui
ne caufent pas une impréflïon profonde aux
fpeélateurs , parce que leur attention eft trop
partagée dans la foule qu’on leur met fous
les yeux. Paul-Véronèfe auroit cru que quarante
figures étoient à peine fuffifantes pour
montrer fa fécondité dans la compofition, fon
talent à diftribuer des grouppes ., à difpofer
des maffes de clair-obfcur , à varier les étoffes
de fes draperies. Annibal Carrache, penfbit
que douze figures' fuffilbient pour quelque
fujet d’hiftoire que ce pût être , 8c Annibal
Carrache , étoit encore loin d’être un Raphaël.
Enfin rien n’eft plus ; grave que le genre
de l’hiftoire, il doit conferyer fa gravité même
dans la couleur.
' Le Pouffin difoit que » cette application à
» la recherche du coloris n’étoit qu’un obf-
» tacle pour parvenir au véritable but de la
» peinture , & que celui qui s’attache au pr'n-
» cipal, acquiert par la pratique une affez belle
» manière de peindre.
Peignez-vous pour parler fur-tout à l’oeil ?
Que l’étude du coloris foit votre principale
occupation. Peignez-vous pour parler à l’ame ?
Que l’étude de la couleur foit fubordonnée aux
parties dont l’ame eft fur-tout affeélée.
Mais comme chaque genre de talent a un
grand mérite quand il approche de la perfection
, il ne faut donner a aucun l’exclufion.
Un feul doit avoir la prééminence ; les autres
méritent d’être accueillis puifqu’ils fayent plaire.
C’eft donc à l’artifte à confulter & à fuivre
le penchant qu’il a reçu de la nature. Celui
qui fe fent entraîné vers les écoles de Flandre
ou de Venife, feroit vraifemblablement peu
de progrès dans l’école Romaine. Si les .premières
couronnes font réfervées aux Emules de
Raphaël, il refte des palmes glorieufes à cueillir
fur les pas du Titien , de Paul-Véronefe,
8c de Rubens. L’école Romaine eft celle de
la haute poéfie pittorefque ; les écoles de Venife
8c de Flandres font celles de la peinture proprement
dite. Il eft encore beau d’être peintre ,
quand on ne peut être poète. Voyez l’article
couleur dans le Diélionnaire de pratique {A r -
ticle de M. L e v e s q v e ).
COUP. Au premier coup. On dit un coup de pinceau , un coup de broffe , peindre à
grands cou ps, peindre au premier coup. Le coup de pinceau ou de broffe eft i’aétion
par laquelle, après avoir chargé la broffe ou
le pinceau de couleur, on l’applique fur la
furface fur laquelle on peint. Cette aâion dé-
fignée par le mot coup, n’eft pas abfolument
celle que l’on exprime par le mot maniement
du pinceau , quoiqu’elle y foit comprife. La
première fuppofe plus de promptitude, elle fi-
gnifie que l’on applique la couleur d’une façon
libre, fans héfiter , fans revenir à plufieurs
fois ; & en effet on ne diftingue le coup do
pinceau dans un objet peint qu’autant que
l’artifte a opéré de maniéré à faire connoître
le caraélère de liberté dont je viens de
parler.
L’on ne peint à grand7 coups que des objets
cônfidérables qui comportent cette manière de
peindre ; mais tout ouvrage de peinture pour-
roit à la rigueur être peint au premier coup.
Peindre au premier coup un tableau, une
figure, un payfage 8cc y c’eft donc , comme
je l’ai dit, le peindre de manière à ne point
revenir fur ce qu’on a fait & à ne pas retoucher.
C’eft ce que dans Tart d’écrire, on
appelle compofer dû premier jet. On doit fentir
aifément que cette définition reftreînt la manière
de peindre au premier coup à un ufage
infiniment-moins général que je n’ai paru le faire
entendre d’abord.
En effet tout ouvrage qui exige d’être rendu
avec foin, ne peut affurément guere être
exécuté au premier coup, 8c fi un artifte peignoit
tout ce qu’il exécute au premier coup, ce qui
pourroit fe faire à la rigueur, la plus grande
partie de fes produ&ions feroit très - imparfaite.
On peut dire même qu’il eft difficile que
quelqu’ouvrage que ce foit puiffe être affez
parfaitement rendu, fi l’on ne revient à plu--
lieurs fois , foit pour fe corriger , foit pour
parvenir , après avoir ébauché , à terminer
chaque partie 8c fouvent à changer d’après les
réflexions 8c l’obfervation de fon ouvrage, ce
qui paroît y manquer.
La maniéré dont je parle femble donc 8c eft effeéli veinent réfervée aux études particulières
que l’on fait fur la nature même,
parceque d’une part la nature vivante , par
exemple, ne peut refter affez immobile pour qu’on
puiffe revenir à plufieurs fois, 8c que fi l’on
peint d’après nature hors de l’attelier 8c en
plein air, les lumières changent trop de moment
en moment, pour qu’il foit poflible de revenir
à plufieurs reprifes fur fon travail, pour
mieux rendre l’effet qu’èlles produifent.
Il eft donc alors néceffaire de peindre fouvent
le plus promptement qu’il eft poflible, & comme
on dit au premier coup ; mais quelquefois cette
manière a rapport au caraélère particulier du
peintre., à l’habitude qu’il s’eft formé. Il eft
tel .artifte qui ne fait jamais mieux qu’en
peignant au premier loup 8c comme l’infpire 1
la nature ou l’imagination ; de même il eft tel
Auteur qui ne compofe jamais mieux que lorf-
qu’il travaille de premier jet & d’inspiration.
Ces caraéléres d’efprit, de génie ou de talent, fe
réfroidiffent par la lenteur des moyens méthodiques
que les autres employent pour rendre
leurs ouvrages plus parfaits. Us ôtent à leurs
productions , en y travaillant à plufieurs fois,
cette .fleur du génie, cette liberté qui les
manifefté, ce feu dont la promptitude conferve
toute là vivacité. Si ces Auteurs font contraints
à revenir fur leurs pas , la pefanteur, la contrainte,
le froid, défignent les foins laborieux
qu’ils ont pris pour rendre plus conformément
aux règles 8c aux principes de l’art , leurs
ouvrages.
' Je ne prétens, en expofant ces difpofitions
inhérentes à certains talens , ni les approuver,
ni les exclure. La nature qui répand fur les produélions
qu’imite la peinture, une variété iné-
puifable , la répand aufli fur les difpofitions
qu’elle donne aux artiftes, & les condamne
fouvent a s’y aftreindre , fans que le -raifonne-
ment , l’inftruélion, la conviélion qui réfultent
des méthodes artielles. puiffent vaincre le penchant
8c l’habitude , ni procurer un fuccès plus
grand”.
Pour revenir à la pratique dont je viens de
parler , les efquiffés , les premières penfees com-
portent prefqu’eflèntiellement d’être exécutées au
premier coup : je dirai encore qu’une, infinité
! d’études , d’ouvrages même, infpirés par des
fentimens prompts ou d’amitié ou d’amour , tels
que des portraits , des évènemens finguliers
dont on eft témoin , des circonftances perfon-
nelles, enfin des amufemens de fociété, comportent
8c demandent fouvent même d’être exécutés-
au premier coup pour avoir tout le mérite qu’cn
peut y deftrer. Le fentiment ne peint qu’au premier
coup , 8c il eft dangereux , fi l’on ofe porter
plus loin cette image, d’y retoucher. Le
coeur qui fent à deux fois , ou qui, po,ur fentir ,
revient fur lui-même , ne s’exprime bien , ni
en peignant des fentimens, ni en fe livrant à
ce qu’ils inlpirent ; mais- la nature qui conduit
le fentiment a bien de l’avantage à cet égard
fur l’art qui conduit le Peintre. L’une eft lo
modèle 8c l’autre l’artifte. ( Article de M. y^à-
TELET»)
COUP - D’(EIL , ( fubft. compofé mafc. ) C’eft
l’habitude de fajfir , à la fimple vue , la figure,
la grandeur 8l les proportions avec tant de pré-
cifion qu’il s’en forme un tableau exaél dans
l’imagination. Le coup-dtoe il eft le premier &
le plus indifpenfable dés tal-ens que les arts du
demn exigent. Ni la règle, ni le compas ne
peuvent fuppléer au défaut du coup-d? oe il. Il
faut, cobune s’exprimoit Michel-Ange , que le
deflînateür ait le compas dans les yeux , 8c non.
dans la main; & l’un des plus grands peintres ,
le célèbre Mengs ^ veut que la première tâche
de l’élève foit de fe rendre l’oeil jufte au point
de pouvoir tout imite.?. C’eft , félon lui, au coupât
oe il tpïe Raphaël même devoit une grande parade
de les fuccès. Le coup-dtoe il ne fait pas Amplement
qu’on puiffe imiter chaque objet; mais
il met encore dans cette imitation un fi haut
degré de vérité, que l’ouvrage en acquiert uns
énergie frappante.
Il en eft du coup-dt oe il comme des autres ta-
lens ; la nature en-fait les?premiers frais par les
difpofitions qu’elle donne; mais un long exercice
y peut beaucoup ajouter. Prefque tpus les peintres
qui vivoient lors de la reftattration des arts pof-
fedoient le coup-dîoeil dans un degré éminent.
On voit plufieurs deflins & tableaux du temps
d’Albert-Durer qui font eftimables par leur
grande vérité ; des portraits .mal peints, mais
qui font d’un grand prix à caufe de la correction
du defîin. Tpus les peintres de ce fiécle-là
, dit M. Mengs, avoient le c o u p oe i l jufte :
s’ils avoient fu , comme Raphaël, faire de bons
choix ils auroient tous aufli bien defliné que
lui. C’eftdà une obferyation bien intéreffants