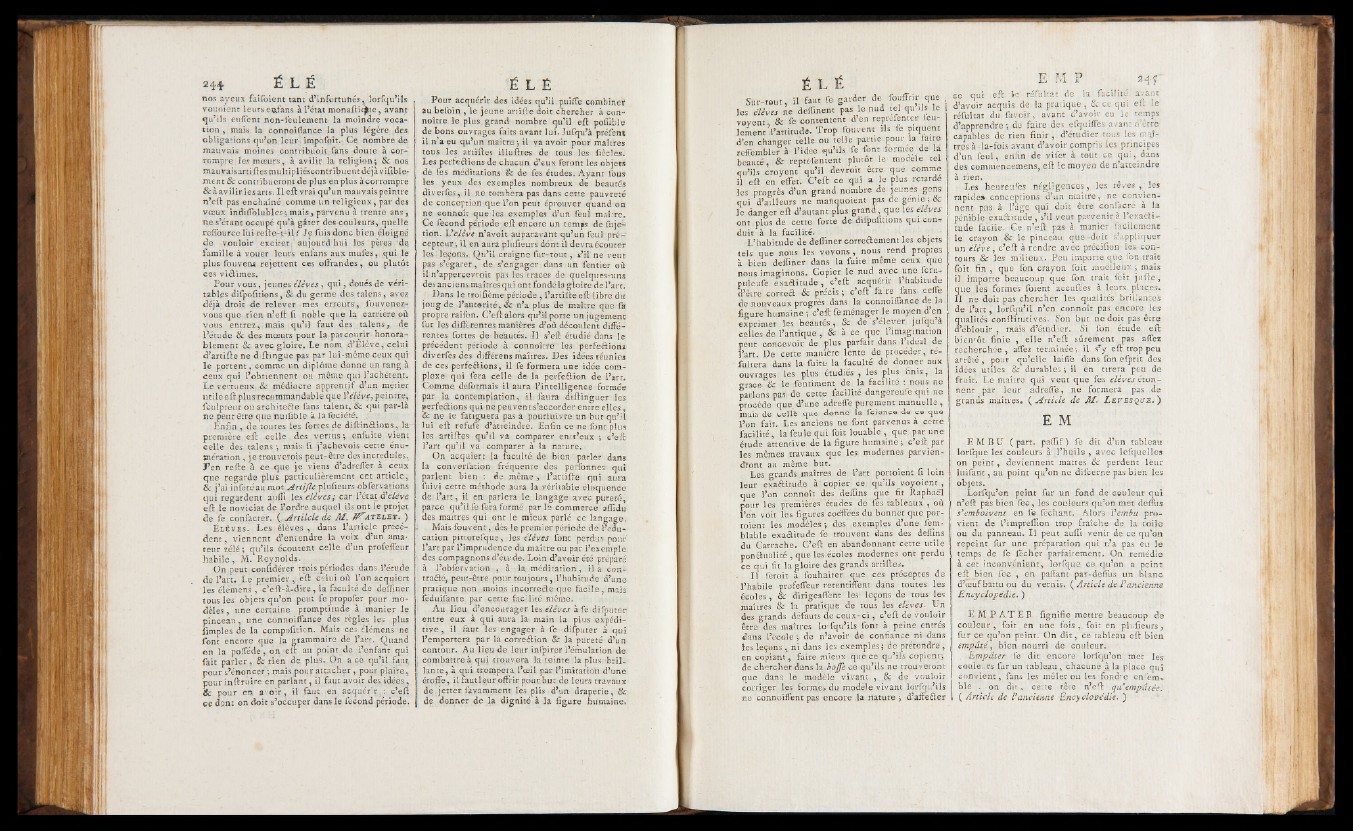
244 É L É
nos ayeux faiioient tant d’ infortunés , lorfqu’ ils
vouoient leurs eufans à l’état monafticjue, avanp
qu’ ils enflent non-feulement la moindre vocation
, mais la connoiflançe la plus légère des
obligations cju’on leur i impofpit. . -Ce nombre de
mauvais moines contribuoit.fans doute à corrompre
les moeurs, à avilir la religion; & nos
mau vaisartiftesmültipliéscontribuent déjà visiblement
& contribueront de plus en plus à corrompre
& à avilir les arts. I l eft vrai qu’ un mauvais peintre
n’ eft pas enchaîné comme un relig ieux , par des
voeux indifloluble® 3 maisj parvenu à trente ans *
ne s’étant occupé qu’à gâter des couleurs, quelle
reflource lui refte-tMl ï Je fuis donc bien éloigné
de vouloir exciter] aujourd hui les pères de
famille à vouer leurs enfans aux mules, qui le
plus louvent rejettent ces offrandes, ou plutôt
ces vi&imes.
Pour vous, jeunes élève s, q u i, doués de véritables
difpofîtions, 8i du germe des talens, ayez
déjà droit de relever mes erreurs-, fouvenez-
vous que rien n’ eft fi noble que la carrière où
vous entrez, mais qu’ il faut des talens, de
l ’étude & des moeurs pour la parcourir honorablement
& avec gloire. Le nom d’Ê lè v e , celui
d’ artifte ne d ftingue pas par lui-même ceux qui
le portent, comme un diplôme donne un rang à
ceux qui l’ obtiennent ou même qui l’achètent.
Le vertueux) & médiocre apprentif d’un métier
utile eft plus recommandable que Relève-, peintre,
fculpteur ou architefte fans talent, & qui par-là
ne peut être que nuifible à la fociété.
Enfins, de toutes les fortes de diftin&ions, la
première eft celle des vertus ; enfuite vient
celle des talens -, mais- fi j’ achevois cette énumération
, je trouverois peut-être des incrédules.
J ’ en refte à ce que je viens d’adrefler à. ceüx
que regarde plus particulièrement cet article,
& j ’ai inféré au mot. A rtijle plufieurs obfervations
qui regardent aufîi les élèves ,■ car l’etat dééléve
eft le noviciat de l’ ordre auquel ils ont le projet
de fe confacrer. {-A rtilc le de M . J F a t e l e t . )
É l è v e s . L e s élèves , dans l’ article précédent,
viennent d’ entendre la voix d’ un amateur
zélé; qu’ ils écoutent c elle .d ’un profefleur
habile , M. Reynolds.-
On peut confidérer trois périodes dans l’étude
de l’ art. Le premier , eft celui où l’on acquiert
les ciéméns , c’ eft-à-dire, la faculté de deffiner
tous les objets qu’on peut fe propofer pour modèles
, une certaine promptitude à manier le
pinceau, une connoiflance des règles les plus
fimples de la compofition. Mais ces élémens ne
font encore que la grammaire de l’art. Quand
on la poflede, on-elt au point de .l’ enfant qui
fait par le r, & rien de plus. On a c è qu’il faut,
pour s’énoncer ; mais pour attacher, pour plaire,
pourinftruire en parlant, il faut avoir des idées,
& pour en a vo ir, il faut, en acquérir •. c’ eft
ce donc on doit s’occuper dans le fécond période.
É L Ë
Pour acquérir des idées qu’il, puifle combine*
au befoin , le jeune artifte doit chercher à con-
noître le plus grand nombre qu’ il eft poflible
de bons ouvrages faits avant lui. Jufqu’à préfient
il n’a eu qu’ un maître; il va avoir pour maîtres
tous les artifte? illuftres de tous les ficelés.
Les perfeftions de chacun d’ eux feront les objets
de fes méditations & de fes études. Ayant fous
les yeux des exemples nombreux de beautés
diverfes, il. ne tombera pas dans cette pauvreté
de conception que l’on peut éprouver quand on
ne eonnoît que les exemples d’ un feul maître.
Ce fécond pé'riode;?eft encore un temps de fiije^
tion. L’elève n’avoit auparavant qu’ un feul précepteur;
il "en aura plufieurs dont il devra écouter
les leçons. Qu’ il craigne fur-tout, s’ il ne veut
pas s’égarer, de-s’engager dans un fentier où
il n’ apperçevroit pas les traces de quelques-uns
des anciens maîtresqui ont fondéla gloire de l’ art.
Dans le troifièmepériode , l’artifte eft libre du
joug de l’ autorité, oc n’a plus de 'makre que. fa’
propre raifon. C’ eft alors qu’ il porte un jugement
fur les differentes manières d’où découlent différentes
fortes de beautés. I l s’ eft étudié dans le
précédent période à. connoître les perfeftions
diverfes des différens maîtres. Des idées réunies
de ces-perfefiions, il fe formera une idée complexe
qui fera celle de la perfeélion de l’ art.
Comme déformais il aura l’ intelligeneë formée
par la contemplation, il faura diftinguer les
perfections qui ne peuvent s’accorder entre elles ,
& ne fe fatiguera pas à pourfuivre un but qu’ il
lui eft refufé d’ atteindre. Enfin ce ne font plus
les artiftes qu’ il va comparer encr’ eux ; c’ eft
l’ art qu’ il va comparer à la nature.
On acquiert la faculté de bien'parler dans
la converfation fréquente des perfonnes qui
parlent bien : de même > l’arcifte qui aura
fuivi cette méthode aura la .véritable éloquence
de l’a r t , il en parlera le. langage avec pureté,
parce qu’ il.fe fera formé par lè commerce afïïda
des maîtres qui ont le mieux parlé ce langage.
Mais fbuvént, dès le premier période de l’éducation
pittorefque, les élèves font perdus pour
l’art par l’imprudence du maître ou par l’ exemple
des compagnons d’étude. Loin d’avoir été préparé
à l ’obfervatipn j à la, méditation, il a con-^
tradé, peut-être pour toujours, l’habitude d’une
pratique non, moins incorrede que fa c ile , mais
îeduifante par cette facilité même.
Au lieu d’encourager les élèves à fe difputer
entre eux à qui aura la main la plus expédit
iv e , il faut les engager à fe difputer à qui
l’ emportera par la corredion 8c la pureté d’un
contour. Au lieu de leur infpir.er l’émulation de
combattre à qui trouvera la teinte la plus brillante,
à qui trompera l’oeil par l’imitatio'n d’une
étoffe, il faut leur offrir pour but de leurs travaux
de jetter favargunent les plis d’un draperie, 8c
de donner de la dignité à la figure humaine.
É L É
Sur-tout, il faut fe garder de fouffrir que
les élèves ne deflinent pas le nud tel qu ils le
voyent, & fe contentent d’ en reprefenter feulement
l’attitude. Trop fouvent ils fe piquent
d’en changer telle ou telle partie-pour la faire
reflembler à l ’ idée qu’ ils fe font formée'de la
beauté, & repréfentent plutôt le modèle tel
qu’ ils croyent qu’ il devroit être que comme
il eft en effet. C’ eft ce qui a le plus retardé
les progrès d’un grand nombre de jeûnes gens
qui d’ ailleurs ne manquoient pas de génie ; &
le danger eft d’autant plus grand, que les éleves
orit plus de cette forte dè difpofitions qui con-?
duit à la facilité. < - • . ' ;
L’habitude de deffiner corre&ement les objets
tels que nous les- voyons , nous rend propres
à bien deffiner dans la fuite même ceux que
nous imaginons. Copier le nud avec une feru-
puleufe exactitude, c’ eft acquérir l’habitude
d’ être correél & précis ; c’ eft faire fans cefle
de nouveaux progrès, dans la connoiffanc.ë de la
figure humaine ; c’ eft fe ménager le moyen d en
exprimer les beautés, & de s’élever jufqu’à
celles de l’antique , & à ce que l’imagination
peut concevoir de plus parfait dans 1 idéal de
l’art. De cette manière lente de procéder, ré-
fultera dans la fuite la faculté de donner aux
ouvrages les plus étudiés , les plus finis, la
grâce & le fentiraent de la facilité,: nous ne
parlons pas, de cette facilité dangereufe qui ne
procède que d’ unë adrefle purement manuelle ,
mais de celïfe que donne la fcience de ce que
l’ on fait. Les anciens ne font parvenus à cette
fa c ilité, la feule qui foit louable , que par une
étude attentive de la figure humaine ; c’eft par
les mêmes travaux que les modernes parviendront
au même but. .
Les grands maîtres de l’ art portoient fi loin
leur exaftitude à copier ce qu’ils vo yoiënt,
que l’ on eonnoît des deffins que fit Raphaël
pour les premières études de fes tableaux , où
l ’on voit lès figures coëffées du bonnet que portoient
les modèles ; des .exemples d’ une fem-
blable exaditude fe trouvent dans des deffins
du Carrache. C’ eft en abandonnant cette utile
pon&ualité , que les écoles modernes ont perdu
ce qui fit la gloire des grands artiftes.
I l feroit à fouhaiter que ces préceptes de
l’ habile profefleur retentiffent dans toutes les
écoles , 8c dirigeaient les leçons de tous les
maîtres & la pratique de tous les elèves. Un
des grands défauts de c e u x -c i, c’ eft de vouloir
être des maîtres lorfqu’ ils font à peine entrés
dans l’école ; de n’avoir de confiance ni dans
les leçons % ni dans les exemples; de prétendre,
en copiant, faire mieux que ce qu’ils copient;
de chercher dans-la bojffe ce qu’ ils ne trouveront
que dans le modèle vivant , & de vouloir
corriger les formes du modèle vivant lorfqu’ ils
ne connoiflent pas encore .la nature ; d’affe&er
E M P H-f
«te qui eft -le réfukat de la facilité avant
d’avoir acquis de la pratique , 8c ce qui eft le
réfultat du favoir, avant d’ avoir eu le temps
d’apprendre ; de faire des efquifles avant d’être
capables, de rien finir , d’étudier tous les maîtres
à^la-fois avant d’avoir .compris les principes
d’un feul, enfin de vifer à tout ce qui, dans
des commencemens, eft le moyen de n’atteindre
à rien. '
Les heureufes négligences, lès rêves , les
rapide» conceptions d’ un maître, ne conviennent
pas à l’ âge qui doit être confacré a la
pénible èxaftitude, s’ il veut parvenir à l’ exaéii-
tude facile. Ge n’ eft pas à manier. facilement
le crayon & le pinceau que -doit s’ appliquer
un é lè v e , c’eft à rendre .avec précifion les contours
& les milieux. Peu importe que. Ton trait
foit fin , que l’on crayon foit moelleux ; mais
il importe beaucoup que fon trait foit ju f t e ,
que les formes foient accufées à leurs, places.
I l ne doit pas pher.cher Je s qualités brûlantes
de l’a r t , lorfqu’ il n’ en eonnoît pas encore les
qualités conftitutives. Son but ne doit pas être
d’éblouir , mais d’étudier. Si fon étude eft
bientôt finie , e lle n’ eft sûrement pas affez
recherchée, affez terminée; il s’ y eft trop peu
arrêté, pour qu’ elle laifle dans fon efprit des
idées utilès 8c durables ; il en tirera peu de
fruit. Le maître qui veut que fes élèves étonnent
par leur adrefle, ne formera pas de
grands maîtres. ( Article de M L eves que. )
E M
E M B U ! ( part, paiïif) fe dit d’ un tableau
lorfque les' couleurs à l’huile , avec lefquelles
on peint, deviennent mattes 8c perdent lèur
luifant, au point qu’on ne difeerne pas bien les
objets.
Lorfqu’on peint fur un fond de couleur qui
i n’ eft pas bien fe c , les couleurs qu’on met deffus
s ’emboivent en fe féchant. Alors l’embu provient
de l’ impréflion trop fraîche de la toile
ou du panneau. I l peut aufîi venir de ce qu’on
repeint fur une préparation qui n’ a pas eu le
temps de fe fécher parfaitement. On remédie
à cet inconvénient,, lorfque ce-, qu’ on a peint
eft bien l’ec , en paffant par-deffus, un blanc
d’oeuf battu ou du vernis. {Artic le de Vancienne
Encyclopédie. )
E M P A T E R fignifie mettre beaucoup de
couleur , fait en une fois , foit en plufieurs y
fur ce qu’on peint. On d it, ce tableau eft bien
empâté, bien nourri de couleur.
Empâter fe dit encore lorfqu’on met les
couleurs fur un tableau, chacune à la place qui
convient, fans les mêler ou les fondre enfem-
ble . on d it, cette t\êre n’ eft qu’empâtée.
( Article de l ’ancienne Encyclopédie. )