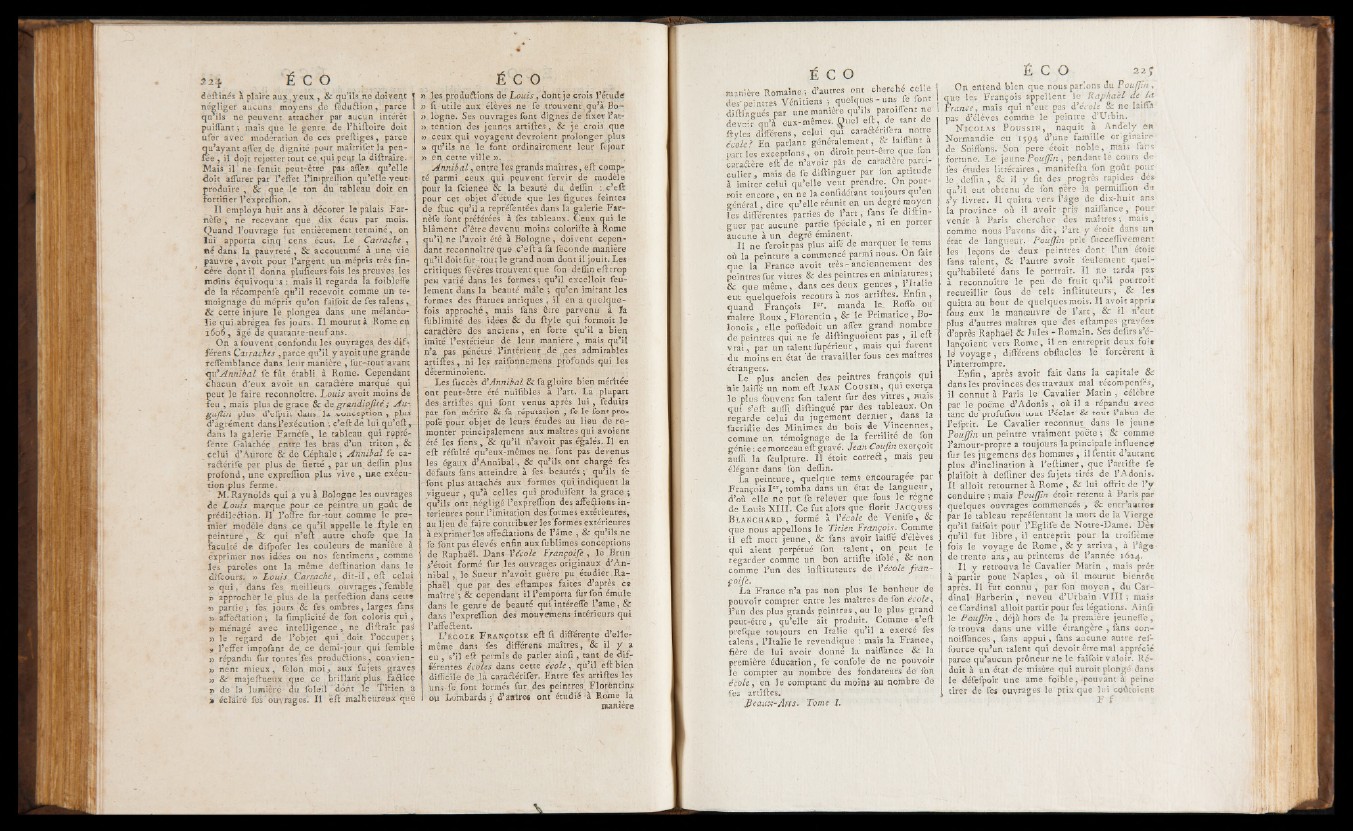
s2% É C O
deftinés à plaire aux yeux , 8c qu’ils ne doivent |
négliger aucuns moyens de féduétion, parce 1
qu’ ils ne peuvent attacher par aucun intérêt
puiflant -, mais que le genre, de l’ hiftoire do.it
üfer avec modération de cés preftiges, parce
qu’ ayant aflez de dignité pour maîtriferla pen-
fée , il doit rejetter tout ce qui peqp la diftraire. •
Maïs il nè fentit peut-être pas afiez qu’ elle
doit affiner par l’ effet l’ inipreffion qu’elle veut-
produire & que le ton du tableau doit en
Fortifier l’ exprefiion.
I l employa huit ans à décorer le palais Far-
îiè fe , ne recevant que dix écus par mois.
Quand l’ouvrage fut entièrement ^terminé, on
lui apporta cinq cens .ecus. Le Carrache ,
né dans la pauvreté , & accoutumé à une vie
pauvre , a voit pour l’ argent un-mépris très fin-
cèr'e dont il donna pluneurs fois lep preuves, les
mdiiis équjyoqu'.s : mais il regarda la foiblefle
dé la récompenfe qu’il recevoir comme _un témoignage
du mépris qu’on faifoit de fes talens ,
& cette injure le plongea dans une mélancolie
qui.abrégea fes jours. I l mourutà Romeeiji
1 6 0 6 , âgé de quarante-neuf ans.
On a fou vent, confondu les ouvrages, des dif\
férens Çarrachës , parce qu’ il y avoit line grande
reflemblance dans leur manière , fur-toutJavant
qu'A n n ib a l fe fût établi à Rome. Cependant
chacun d'eux avoit un caraâère marqué qui
peut le faire reconnoître. Louis avoit moins de
feu , mais plus de grâce & de grandipjité ; Au-*,
gujlin plus d’efprit dans la conception , plus J
d’ agrément dansi’exécution -, e’eft de lui qu’ e ft, I
dans la galerie Farnèfe, Le tableau qui jrppréf
fente Gai athée entré les bras d’ un triton , &
celui d’Aurore & de Céphale ; Annibal fe ca-
raétérife par plus de fierté , par un; deflin plus
profond, une expreffion plus vive , iuie exécution
plus ferme.
M.Raynolds qui g vu à Bologne les ouvrages
de L ouis marque pour ce peintre, uh goût de
prédileélion. I l l’offre fur--tout comme le premier
modèle dans ce qu’il appelle le .fty le en
pèinture, & qui n’ eft autre chofe 1 que la
faculté de difpofer les couleurs de maniéré a
exprimer n®s idées ou nos fentimeiis , comme
lès paroles ont la même deftination dans, le
difcours. » Lou\s ..Qarmche, d itr il, eft celui
» q u i, dans fes meilleurs ouvrages ,'femble
jj approcher le plus de la perfeôjbn dans cette
s> p ar tie ; fes jours, & fes ombres, larges faps
» affèclatiôn ; la firnpliçité dé fon coloris qui ,
» ménagé avec intelligence, ne diftràit pas
» le regard de l’objet qui ' doit l’ occuper ;
* l’ effet impofant de. ce demi-jour qui femble
» répandu fur toutes fes produ&ions, convien-
U lient mieux, félon, moi, aux fuje|s graves
» & majeftueux que ce , brillant plus, faélice
» de la lumière du folèil dont .le Titien, â
* éclairé fes ' ouvrage«'. I l eft malheureux que
É c o
y>. .les.prpdu&ions de L o uis., dont je crois l’êtuder
» fi utile aux élèves ne fe trouvent \qu’ à Bo-
». logne. Ses ouvrages font dignes de fixer Fat-
» tention des jeunes artiffes , & je crois que
» ceux qui voyagent devraient prolonger plus
» qii’ ils ne le font ordinairement leur féjour
.» en cet;te yille ». /.
A n n ib a l, entre le s grands maîtres, eft compté
parmi ceux qui peuvent fervir de modèle
pour la fcienëe & la beauté du deflin :.c ’eft
pour cet objet d’étude que les figures feintes
de ftuc qu’ il a repréfçntées dans la galerie Far-
nëlé font préférées à fes tableaux. Ceux qui le
blâment d’être devenu moins colorifte à Rome
qu’ il np l’avoit été à Bologne, doivent cependant
reconnoître que .c’ eft à fa fécondé manière
qu’ il doit fur-tout le grand nom dont il jouit. Les
critiques févpres trouvent que fôn deflin eft trop
peu varié dans les formes.; qu’ il excelloit feulement
dans la beauté mâle ; qu’ en imitant les
formes des ftatueis antiques , il en a quelquefois
approché, mais fans êcrè parvenu à fa
fublimité dès idéçs & du ftyle qui formoit le
caraélère d,ès anciens, en forte qu’ il a bien
imite l’ extérieur- de leur manière , mais, qu’il
ji’ a pas pénétré T ’ intérieur .dé (Jçes /admirables
artiftes, ni les raifônrie{naèns profonds qui les
determinoient.
Les fuccès d'Annibal 8c fa gloire bien méritée
ont peut-être été nuifibles a l’art, La plupart
des artiftes qui font venus après lui , féduits
par fon" mérite & .fa réputation , fe le fontpro-
poië pour, objet de leurs études au lieu de re-
monter principalement aux maîtres qui avoient
été les fiens, & qu’ il n’ a voit pas égalés. Il en
eft réfultë qu’ eux-mêmes ne font pas devenus
les égaux d’AnnibaV, 8c qu’ ils, ont chargé fes
défauts fans atteindre à fes beautés ; qu’ ils fe
kfont plus attachés aux formes, qui indiquent ,1 a
vigueur , qu’à| celles qui produifent la grâce ;
qu’ils ont négligé l’ expremon des affei^ions-intérieures
pour l’ imkation des formes extérieures,
au lieu de .faire contribuer lesTormes extérieures
a exprimer les affedations de l’ âme , & qu’ ils ne
fe font pas élevés enfin aux fublimes'conceptions
de Raphaël. DansMécole F/ançoife , le .Brun
s’étoit formé fur les ouvrages originaux d’Annibal
, le Sueur n’avoit .guère pu étudier .Raphaël
que par des/^ftampes faites d’ après ce
maîtrè'; & cependant il l’ emporta fur fon émule
dans le genre de Beauté qui intéreffe l’atne, &
dans l’ expreffion des mouvainens intérieurs qui
l’affedent.
L’ école F rançoise eft fi differente d’eller
meme dans fes différens maîtres, & il y a
eu , s’ il eft permis de parler a infi, tant de d ifférentes
écoles dans cette éco le, qu’ il eft bien
difficile de .la çaradérifér. Entre fçs artiftes les
uns-fe font formés fur des peintres. Florentins
ou Lombards d’ antres ont é tud ié^ Rome là
manière
É c o
manière Romaine,; d’autres ont cherché celle
des’ peintres Vénitiens ; quelques - uns fe iont
diftingués pat une manière qu ils paroiffent ne
devoir qu’ à eux-mêmes. Quel e ft , de tant de
ftyles différens, celui qui caraaérifera notre
école? En parlant généralement, & laiflant a
part les exceptions, on diroit peut-être que fon
caradère eft de n’ avoir pas de cafadère particulie
r, mais .de le diftinguer par Ion aptitude
â imiter celui qu’elle veut prendre. On pourrait
encore, en ne la confidérant toujours qu en
général, dire qu’ elle réunit en un degre moyen
les differentes parties de l’a r t , fans fe diftinguer
par aucune partie fpéciale, ni en porter
aucune à un degré éminent.
I l ne ferait pas plus aifé de marquer levtems
où la peinture a commence parmi nous. On lait
que la France avoit très ■ -anciennement des
peintres fur vitres 8c des peintres en miniatures;
& que même,,dans ces .deux genres, l’ Italie
eut quelquefois recours a nos artiftes. Enfin
quand François I er. manda le, Roflb ou
maître' Roux , Florentin , 8c le Primatice , Bo-
lon o is , elle pofledoit un affez grand nombre _
de peintres qui ne fe diftînguoient pas^, il e f t 1
v r a i, par un talent fupérieur , mais qui furent
du moins en état de travailler fous ces maîtres
étrangers. ^ 4
Le plus ancien des peintres françois qui
a it laifle un nom eft J ean C ousin , qui exerça
le plus fouvent fon talent fur des v itre s, mais
qui s’eft aufli diftingué par des tableaux. On
regarde celui du jugement dernier, dans la
lacriffie des Minimes du bois de Vincennes,
comme un témoignage de la fertilité de fon
~ génie : cemorceau eft gravé. Jean Coujin exerçoit
aufli la fçulpture. I l étoit correét, mais peu
élégant dans fon deflin.
La peinture, quelque tems encouragée par
François I er, tomba dans un état de langueur,
d’où elle ne put fe relever que fous le règne
de Louis X I I I . Ce fut alors que florit J acques
B la n ch a r d , formé à l'école de V en ife , 8c
que nous appelions le Titien François. Comme
il eft mort jeune, & fans avoir laiffé d’élèves
qui aient perpétué fon talent, peut le
regarde* comme un bon artifte ifo le , & non
comme l’ un des inftituteurs de Ÿécole fr a n -
çoife.
L a France n’a pas non plus le bonheur de
pouvoir compter entre les maîtres de fon école,
l’ un des plus grands peintres , ou le plus grand
peut-être, qu’ elle ait produit. Comme «’ eft
prefque toujours en Italie qu’ il a exercé fes
talens., l’ Italie le revendique : mais la France,
fière de lui avoir donne la naiflance 8c la
première éducation, fe confole de ne pouvoir
Je compter au nombre des fondateurs de fon
école, en le comptant du moins au nombre de
•fes artiftes.
JJea u x -A n s . Tome I.
É C O
On entend bien que nous parions du P o uffin,
que lès François appellent le R a p h a ë l de la
France, mais qui n’ eut pas à?école 8c ne lailfa
pas d’élèves comme le peintre d’Urbin.
N icolas P o u s s in , naquit à And'elÿ en
Normandie eu 1 5 9 4 d’une famille originaire
de Soiffons. Son pere étoit noble, mais fans
fortune. Le jeune Poujjin , pendant le cours de
fes études littéraires , manifefta fon goût pour
le .d e flin , & il y fit des progrès rapides dès
qu’ il eut obtenu de fon père la permiflion de
s’y livrer. I l quitta vers l’ âge de dix-huit ans
la province où il avoit pris naiflance, pour
venir à Paris chercher des maîtres ; mais,
comme nous l’avons dit, Fart y étoit dans un
état de langueur. Poujjin prit fucceflivement
les leçons de deux peintres dont l’ un étoit
fans talent, 8c l’ autre avoit feulement quel-
qu’habileté dans le portrait. I l ne tarda pas
à reconnoître le peu de fruit qu’ il pourrait
recueillir fous de tels inftituteurs-, & les
quitta au bout de quelques mois. I l avoit appris
fous eux la manoeuvre de l’a r t , 8c il n’eut
plus d’autres maître'* que des eftampes gravées
d’après Raphaël & Jules - Romain. Ses defirs s’é-
ïançoient vers Rome, il en entreprit deux foie
le voyage , différens obffacles le forcèrent à
l’ interrompre.
E n fin , après avoir fait dans la capitale 8c
dans les provinces des travaux mal recompenfes^
il connut à Paris le ' Cavalier Marin , célèbre
par le poëme d’Adonis , où il a répandu avec
tant de profufion tout l ’éclat' 8c tout l’ abus de
l’efprit. Le Cavalier reconnut_ dans le jeune
Poujjin un peintre vraiment poëte ; 8c comme
l’amour-propre a toujours la principale influence
fur les jugemens des hommes , il fentit d’autant
plus d’ inclination à l’ eftimer, que l’artifte fe
plaifoit à defliner des fujets tirés de l’Adonis.
I l alloit retournera Rome, 8c lui offrit de l ’y
conduire ; mais Poujjin étoit retenu à Paris par
quelques ouvrages commencés , & entr’aatra*
par le tableau repréfentant la mort de la V ierge
qu’il faifoit pour l’Eglîfe de Notre-Dame. Dè*
qu’ il fut lib r e , il entreprit pour la troifième
fois le voyage de Rome , 8c y a r r iv a , à l’âge -
de trente ans , au printems de l’ année 1 6 x4 .
I l y retrouva le Cavalier Marin , mais prêt
à partir pour Naples, où il mourut bientôt
après. I l fut connu , par fon moyen , du Cardinal'
Barberin, neveu d’Urbain V I I I ; mais
ce Cardinal alloit partir pour fes légations. Ainfi
le Poufjin , déjà hors de la première jeuneffe,
fe trouva dans une v ille étrangère , fans con-
noiflances, fans appui, fans aucune autre rel-
-fource qu’ un talent qui devoit être mal apprécié
parce qu’ aucun prôneur ne le faifoit valoir. Réduit
à un état de misère qui aurait plongé dans
le défefpoir une âme fo ib le , -pouvant à; peine
tirer de fes ouvrages le prix que lui coûtoient