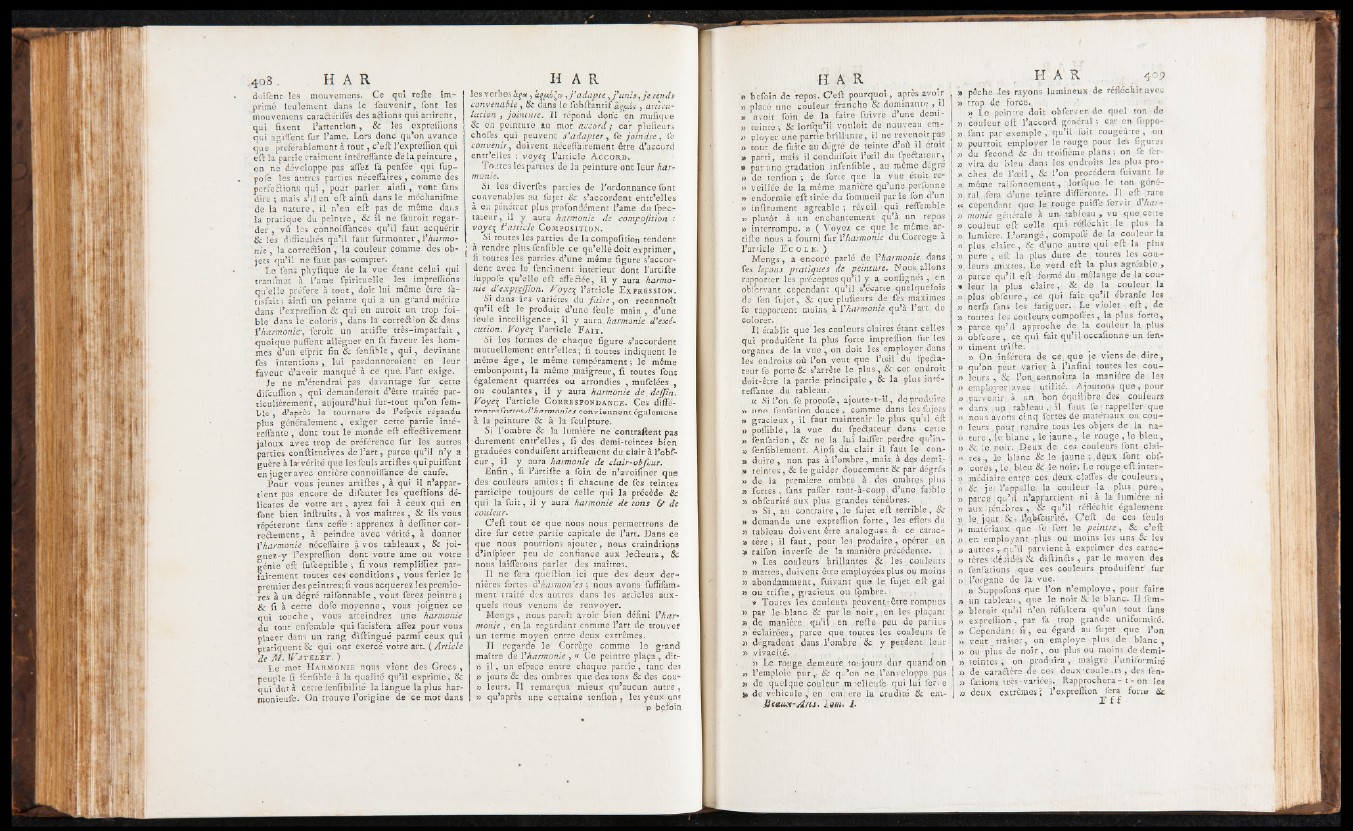
duifent les iiiouvemens. Ce qui refie imprimé
leulement dans le louvenir., font les
mouvemens caraélérifés des allions qui attirent,
qui fixent l’attention, & lès expédiions
qui agirent fur l’ame. Lors donc qu’on avance
que préférablement à tout, c’efl T expreffion qui
eft la partie vraiment intéreffante de la peinture ,
on ne développe pas affez fa penfée qui fup-
pofe les autres parties néceffaires, comme des
perfections q u i , pour parler ainfi , vont fans
dire ; mais s’ il en eft ainfi dans le méchanifme
de la nature, il n’en eft pas de même dans
la pratique du peintre, 8c il ne fauroit regarder
vû les connoiffances qu’ il faut acquérir
& les difficultés qu’il faut furmonter, Ÿ harmon
i e , la correétion , la couleur comme des objets
qu’ il ne faut pas compter.
Le Cens phyfique de la vue étant celui qui
tranlmet à Taine fpirituelle les impreflions
qu’elle préféré à tout, doit lui même être fa-
tisfait -, ainfi un peintre qui a un grand mérite
dans Cexprefïion & qui en auroit un trop foi-
ble dans le coloris, dans lar correétion & dans
Vharmonie-, feroit. un artifte très-imparfait ,
quoique puffent alléguer en fai faveur les hommes
d’ un efprit fin & fenfible, q u i, devinant
fes intentions, lui pardonneroient en leur
faveur d’ avoir manqué à ce que. l’ art exige.
Je ne m’étendrai pas davantage fur c.ette
difcuflion , qui demanderait d’être traitée particulièrement,
aujourd’hui fur-tout qu’on fem-
b l e , d’après la tournure de l’ efprit répandu
plus généralement , exiger cette partie intéreffante
, dont tout le mondé eft effeélivement
jaloux avec trop de préférence fur les autres
parties conftitutives de l’a r t , parce qu’ il n’y a
guère à læ vérité que lesfeuls artiftes-quî puiffent
en juger avec entière connoiffance de caufe..
Pour vous jeunes artiftes , à qui il n’appartient
pas encore de difcuter les queftions délicates
de votre a r t , ayez foi à ceux qui en
font bien inftruits, à vos maîtres , & ils vous
répéteront fans ceffe : apprenez à defliner cor-
reélement, à peindre avec vérité, à donner
Ÿharmonie néceffaire à vos tableaux , & joi-
gnez-y l’ expreffion . dont votre ame ou votre
génie eft fufceptible -, fi vous rempliffiez parfaitement
toutes ces conditions , vous feriez le
premier des peintres-, fi vous acquérez les premières
à un dégré raifonnable , vous ferez peintre ;
& fi à cette dofe moyenne, vous joignez ce
qui touche, vous atteindrez une harmonie
du tout enfemble qui fatisfera affez pour vous
placer dans un rang diftingué parmi ceux qui
pratiquent & qui ont exercé votre art. ( Article
d e M . W a t e l e t . )
Le mot Harmonie nous vient des Grecs ,
peuple fi fenfible à la qualité qu’ il exprime, &
qui dut à cette fenfibilité la langue la plus har-
wonieufe. On trouve l ’origine de ce mot dans
les verbes ceça, apposa , j ’adapte j'u n is , je rends
convenable , & dans le fubftantif àf/wo? , articulation
, jointure. Il répond donc en mufique
& en peinture choies qui peuvaeun tm ot a ccord,• car plufieurs s ’adapter, fe jo in d re , fe
ceonntrv’eenlliers, doivent néceffairement être d?accord : voye\ l’article Accord.
Toutes les parties de la peinture ont leur har*
manie.
Si les diverfes parties de Tordonnance font
convenables au fujet- & s’accordent entr’ elles
à en pénétrer plus profondément l’ame du fpec-
tateur, il y aura harmonie de compojition :
vo y ei l ’article Composition.
Si toutes les parties de la compoficion tendent
î à rendre plus fenfible ce qu’ elle doit exprimer,
fi toutes les parties d’ une même figure s’accordent
avec le fendment intérieur dont l ’artifte
fuppofe qu’ elle eft affeélée, il y aura harmonie
d ’expzejjion. Voye% l’ article Expression.
Si dans les variétés du f a i r e , on reconnoît
qu’ il eft le produit d’ une feule main , d’ une
feule intelligence il y aura, harmonie d'exécution.
Voye% l’ article Fait.
Si les formes de chaque figure s’ accordent
mutuellement entr’ elles; fi toutes indiquent le
même â g e , le même tempérament •> le même
embonpoint, la même maigreur, fi toutes font
également quarrées ou arrondies , mufclées ,
ou coulantes , il y aura harmonie de. dejjiti.
Voye\ l’article Correspondance. Ces différentes
fortes d ’harmonies con viennent également
à la peinture & à la fculpture.
Si l ’ombre & la lumière ne contraftent pas
durement entr’ e lle s , fi- des demi-teintes bien
graduées conduifent artiftement du clair à l’obf-
cur , il y aura harmonie de clair-obfcur.
Enfin , fi l’artifte a foin de n’avoifiner que
des couleurs amies ; fi chacune de fés teintes
participe toujours de celle qui la précède &
qui la fu it , il y aura harmonie de tons 6* de
couleur.
C’ eft tout ce que nous nous permettrons de
dire fur cette partie capitale de l’art. Dans ce
que nous pourrions ajouter, nous craindrions
d’inlpirer peu de confiance aux leéteurs, &
nous laifferons parler des maîtres..
I l ne' fera queftion ici que des deux dernières
fortes - è?luirmories -, nous avons fuffifam-
ment traité des autres dans les articles auxquels
nous venons de renvoyer.
Mengs , nous paroît avoir bien défini l'harmonie
, en la regardant comme l’art de trouve?
un terme moyen entre deux extrêmes.
I l regarde le Corrège comme le grand
maître de l 'harmonie , « Ce peintre plaça , dit-
» i l , un efpace entre chaque partie , tant des
» jours & des ombres que des tons 8c des cou-
» leurs. I l remarqua mieux qu’aucun autre ,
» qu’ anrès une certaine tenfion > les yeux ont
» bçfoin
» befoin de repos. C’ eft pourquoi, apres avoir
» placé une couleur franche & dominante } il
» a voit foin de la faire fuivrè d’ une demi-
» teinte-, & lorfqu’ il vouloit de nouveau em-
» ployer une partie brillante, il ne revenoit pas
» tout de fuite au dégré de teinte d’ où il étoit
» parti, mais il conduifoit l’oeil du fpeftateur,
» par une gradation infenfible, au même dégrp
» de tenfion -, de force que la vue étoit- ré-
» veillée de la même manière qu’ une perfonne
» endormie eft tirée du fommeil par le fon d’un
» inftrument agréable /, réveil qui reffemble
» plutôt à un enchantement qu’a, un repos
» interrompu. » (V o y e z ce que le meme, artifte
nous a fourni fur Vharmonie du Coçrege a
l’article E c o l e . )
Mengs, a encore parlé de Vharmonie.. d^ns
fes leçons pratiques de peinture. Nous; allons
rapporter les préceptes qu’ il y a configtaés , en
oblervant cependant qu’il s’écarte quelquefois
ds fon fujet, & que plufieurs de fesfmaximes
fe rapportent moins, à l’harmonie qu’a l’art, de
colorer., .. i . i , :
Il établit que' les couleurs claires étant celles
qui produifent la plus forte impreffion fur les
organes de la v u e , on doit les employer- dans
les endroits où Ton veut que l’oeil du fpe£ta-
teur fe porte & s’ arrête le plus,, $c cet endroit
doit-être la partie principale, & la plus inré-
reffante .du tableau. _ •.
.« Si l’on feprooofe, ajoute-t-il, de produire
» une .fenfation douce, comme dans les fujers
» gracieux, il faut maintenir le plus qu’i l : eft
» poffible, la vue du fpe&ateur dans cette
» fenfation, & ne la lju.i laiffer perdre qu’ in-
» fenfiblement. Ainfi du clair il faut le con,-
» duire , non pas à l’ombre, mais, à dqs demi-
» teintes, & le guider doucement & par degrés
» de la première ombre à des ombres,plus
» fortes, fans paffer to,ut-à^coup. d’ une faible
» obfcurité aux plus grandes ténèbres; .
» S i ,, au contraire, le fujet, eft terrible, 8c
» demande une expreffion fo rte , les effets du
» tableau doivent être analogues à' ce carac-
» tère ; il faut, pour les produire , opérer, en
$ raifon inverfe de la manière précédente. ,
» Les couleurs brillantses 8c les coul,e;urs
» mattes, doivent être employées plus ou moins
» abondamment, fuivant que le, fujet .eft. gai
» ou tti'fte gracieux [ ou fombre. ; : ; n
* Toutes les couleurs peuvent,-être rompues
>» par le-blanc & p a r le n q ir ,;en les plaçant
» de manière q.u’il en . refte peu de parties
» éclairées, parce que toutes ; les couleqrs fe
» dégradent dans l’ombre - 8c y perdent leur
» yiva,eité. .
» Le rouge demeure toujours dur quand on
» l’emploie pur,- & qu’ on ne d’ enveloppe pas
» de quelque couleur m lelleufe qui lui fqrve
» de véhicule , en :empere la crudité 8c em~ Beaux-Arts* lom. J.
» pêche les rayons lumineux de réfléchir avec
» trop de force.,
» Le peintre doit ob fer ver.-de quel ton de
», couleur eft l’accord général ; car en ftippo-
» Tant par exemple , qu’ il- fo it ' rougeâtre , on
» pourroit employer le rouge pour les figures
» du fécond & du troifième plans ; on fe fer-
» vira du bleu dans les endroits les plus pro-
» ches de l ’oe il, & l’on procédera fuivant le
n même raifonnement., lorlq.ue le ton gone-
». ral ffera d’ iine teinte -différente. I l eft .rare
cç cependant que. Je,rouge puiffe fer vit à’har-
» monie générale à uiv tableau, vu que;cette
», couleur eft- celle qui réfléchit • le plus la
». lumière. L ’orangé, -compofé de la couleur la
plus, claire , & d’une autre, qui eft la plus
», pure eft la plus dure de toutes les cou—
» leurs mixtes. Le verd eft la plus agréable y
» parce qu’ il eft . formé du mélange: de ;la cou-
» leur la plus claire-,^ &, de la couleur la
».plus oblcure, ce qui fait-qu’il ébranlé le*
.» nerfs fans les fatiguer.. Le violet ç f t , de
» toutes le j couleurs, compofées, la plus forte,
» parce qu’ il approche de la couleur la plus
» obfcure , ce qui fait qu’ il- occafionne un fon™
» timent trifte.
» On ^inférera de ce, que je viens d e : d ire ,
» qu’on peut varier à l’ infini toutes les cou-
-» leurs , & fpnxonnoîtra la manière de les
.» utilité.- Ajoutons que pour
» , parvenir- , à un bor> équilibre des couleurs
» dans :up tableau-,{ il faut Ce ; rappel 1er que
» nous avons cinq fortes de matériaux ou court
leurs , pour .rendre tous les objets de la na-
» cure , 1 e blanc ,- le jaune , le rouge ,1 e bleu ,
» 8c- le. noir. ,L?eux de ces couleurs font clai-
» res-r, lé hlanç & le jaune ^deux font obf-
» cures , le , bleu & le noir. Le rouge.eft inter-
» mediaire entre ces. deux claffes,cfo couleurs ,
». & je f,l’appelle;, la couleur -la plus . püre
» parc,e ,qu’il n’ap.f ardent ni • à la lumière ni
» aux .ténèbres , 8c qu’ il réfléchit également
« lé ü i i f c o S i |llWéoe|îf'.” Ç,eft de ces feuls
» matériaux, que fe ; fert le peintre. , 8c c’ eft
,» .ers employant plus ou moins les uns 8c les
» autres qu’ il parvient à exprimer des carac-
,» tères ? décidés & diftinéls , par le moyen des
» fenfations que ces couleurs produifent" fur
» { l ’organe de la vue.
» Supposons que l’on n’ employe, pour faire
n un tableau , que le noir & le blanc. I l fein-
» bîeroit qu’ il n’ en réfultera qu’un tout fans
» expreffion , par fa trop grande uniformité.
» Cependant f l , eu égard au fujet que l’ on
», veut ^ traiter, on employé plus de blanc ,
» ou plus de n oir, ou plus ou moins de demi-
» teintes , on produira , malgré l’ uniformité
» de caraélère -de ces deux ‘.couleurs, des fen-
» Cations, très-variées. Rapprochera - t - on les
» deux extrêmes? Texpreflion fera forte 8c