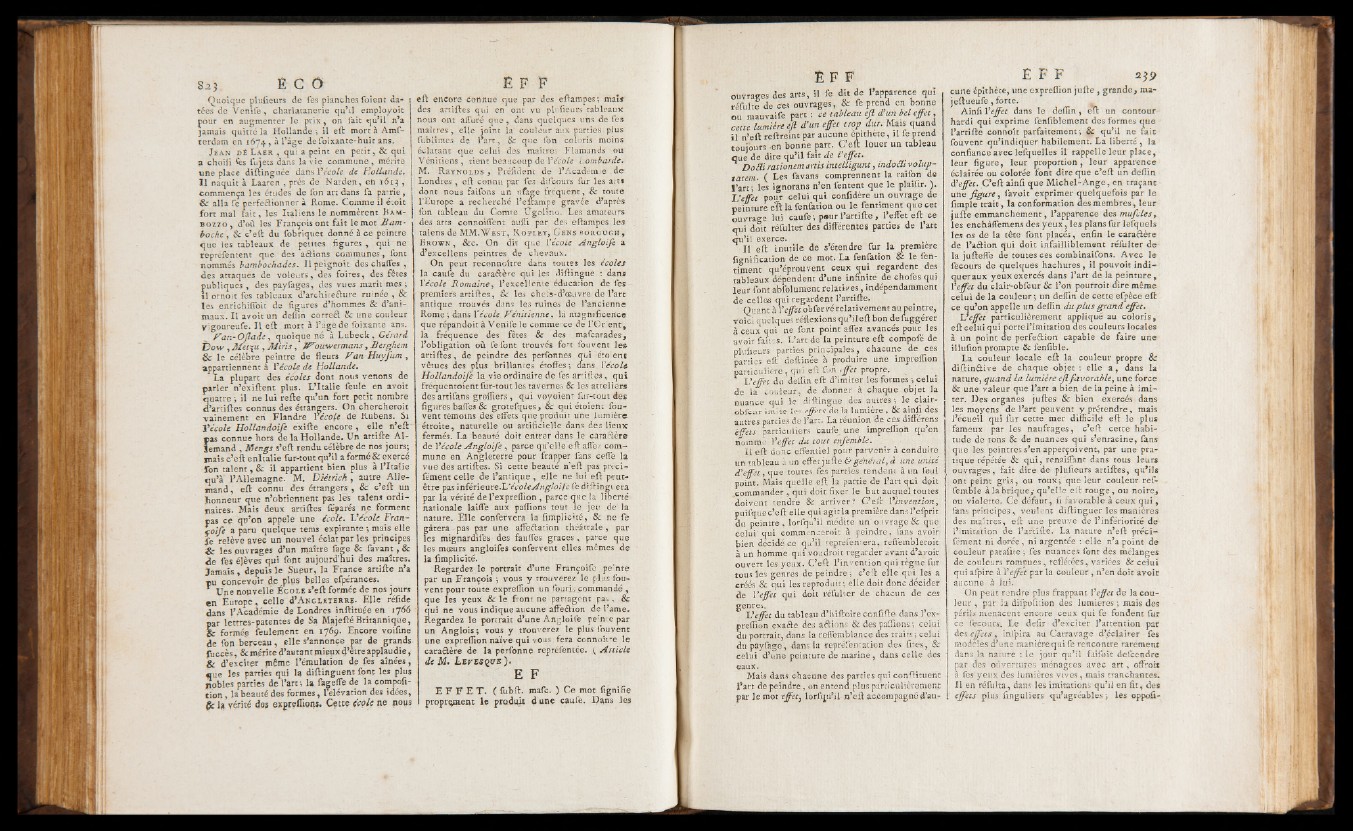
82$ É C O
Quoique plufieurs de fes planches foïent datées
de Veniie , charlatanerie qu’ il employoît
pour en augmenter le p rix , on fait qu’ il n’ a
jamais quitté la Hollande ; il eft mort à Amf-
terdam en 16 7 4 , à l’ âge de foixante-huit ans.
J ean dé L aer , qui a peint en petit, & qui
a choili fes fujets dans la vie commune, mérite
une place diftinguée dans Yécole de Hollande.
I l naquit à Laaren , près de Narden, eh 1 6 1 3 ,
commença les études de fon art dans fa patrie,
& alla le perfeétionner à Rome. Comme il étoit
fort mal ta it, les Italiens le nommèrent B am-
B0 Z7 0 , d’ où les François ont fait le mot B am boche
, & c’ eft du fobriquet donné à ce peintre
que les tableaux de petites figures , qui ne
tepréfentent que des aétions communes, font
nommés bambochades. I l peignoit des chafles ,
des attaqués de voleurs, des foires, des fêtes
publiques, des payfages, des vues maritimes;
il ornoit fes tableaux d’ architeélure ruinée , &
les enrichiftoit de figures d’hommes & d’animaux.
I l avoitun deflin correct &: une couleur
yigoureufe. I l eft mort à l’ âge de foixante ans.
V a n-Oftade, quoique né à Lubeck, Gérard
B o w , Met^a , M ïr is , JVouwermans, Berghem
Sc le célèbre peintre de fleurs Va nH ay fum ,
appartiennent à 1’'école de Hollande.
La plupart des écoles dont nous venons de
parler n’exiftent plus. L’ Italie feule en avoit
quatre ; il ne lui refte qu’un fort petit nombre
d’artiftes connus des étrangers. On chercheroit
vainement en Flandre Yécole de Rubens. Si
Vécole Hollandoifc éxifte encore, elle n’eft
pas connue hors de la Hollande. Un artifte Allemand
, Mengs s’ eft rendu célèbre de nos jours;
snais c’eft enltalie fur-tout qu’ il a formé & exercé
Ton talent, & il appartient bien plus à l’Italie
qu’à l’Allemagne. M. Viétrich , autre Allemand,
eft connu des étrangers , & c’eft un
honneur que n’obtiennent pas lés talens ordinaires.
Mais deux artiftes féparés ne forment
pas ce qp’on appelé une école. L’école Fran-
çoife a paru quelque tems expirante ; mais elle
fe relève aveç un nouvel éclat par les principes
& les ouvrages d’un maître fage & favant,&
de fes éjèves qui font aujourd’hui des maîtres.
Jamais, depuis le Sueur, la France artifte n’a
pu concevoir de plp$ belles çfpérances.
T Une nouvelle É cole s’eft formée de nos jours
en Europe, celle ^ A n g le t err e . Elle réfide
dans l’Académie de Londres inftituée en 1766
par lettres-patentes de Sa Majefté Britannique,
& formée feulement en 1769. Encore voifine
de fon berceau, plie s’annonce par de grands
fuccès, & mérite d’autantmieux4*etreapplaudie,
& d’exciter même l’émulation dp fes aînées,
eue les parties qui la diftinguent font les plus
nobles parties de l’art ; la fageffe de la çompofi-
tion, la beauté des formes, l’élévation des idées,
Çc la véritp dos exgreflions. Cette école ne nous
E F F
eft encore connue que par des eftampes; mai»
des artiftes qui en ont vu plnfieurs tableaux
nous ont alluré que , dans quelques uns de lés
maîtres , elle joint la' couleur aux parties plus
fublimes de l’ a r t, & que fon coloris moins
éclatant que celui des maîtres Flamands ou
Vénitiens , tient beaucoup de l'école Lombarde.
M. Reynolds , Préfident de l’ Academie .de
Londres , eft connu par fes difeours fur les arts
dont nous faifons un nfag.e fréquent, & toute
l ’Europe a recherché l’ eftampe gravée d’après
fon tableau du Comte. Ûgolino. Les amateurs
des arts connoifient aulïi par des eftampes les
talens de MM.We s t , K opley, G ens borough,
B rown , & c . On dit que Yécole Angloife a
d’ excellens peintres de chevaux.
On peut reconnoître dans toutes les écoles
la caule du caraélère qui les diftingue : dan» Yécole Romaine, l’excellente éducation de fes
premiers artiftes, 8c les chefs-d’oeuvre de l’arc
antique trouvés dans lçs ruines de l ’ancienne
Rome ; dans Yécole Vénitienne, là magnificence
que répandoit à Venife le commerce de l ’Or ent,
la fréquence des fêtes & des mafearades,
l’obligation où le font trouvés fort fouvent le»
artiftes, de peindre des perfonnes qui étoenc
vêtues des plus brillantes étoffes; dans Yécole
Hollandoife lajvie ordinaire de fes aniftes, qui
fréquentoient fur-tout les tavernes 8c les atteliers
des artifans grolïîers , qui voyoienr fur-tout des
figures baffes & grotefques, & quiétoient fou-
vent témoins des effets que produit une lumière
étroite, naturelle ou artificielle dans des lieuxr
fermés. La beauté doit entrer dans le caraélère
de Yécole Angloife, parce qu’elle eft aflez commune
en Angleterre pour frapner fans celle la
vue des artiftes. Si cette beaute n’eft pas préci-
fément celle de l’antique , elle ne lui eft peut-
être pas inférieure.L.’écoleAngloife fe diftingi era
par la vérité de l’ expreflion , parce que la liberté
nationale laiffe aux pallions tout le jeu de la
nature. Elle confervera la fimplicité, & ne fe
gâtera pas par une affeélation théâtrale, par
les mignardifes des fauffes grâces , parce que
les moeurs angloifes confervent elles memes de
la fimplicité.
Regardez le portrait d’ une Françoife , pe!nte
par un François ; vous y trouverez le plus fou-
vent pour toute exprefîion un lourL commandé ,
que les yeux & le front ne partagent pas , &
' qui ne vous indique aucune affeélion de l’ame.
Regardez le portrait d’ une Angloife pe:nre par
un Anglois; vous y trouverez le plus fouvent
une exprefîion naïve qui vous fera connoît^e le
caraélère de la perfonne repréfentée. \ Article
de M. L evesçub ).
E F
E F F E T . ( fubft. mafe. ) Ce mot lignifie
proprement le produit d une caufe, Dans les
Ê F F
ouvrages des arts, il fe dit de l’ apparence qui
réfulte de ces ouvrages, & fe prend en bonne
ou mauvaife part : ce tableau eft d un bel effet,
cette lumière eft d'un effet trop dur. Ma.s quand
il n’ eft reftreint par aucune épithete, il fe prend
toujours en bonne part. C’ eft louer un tableau
que de dire qu’ Docli rationemil afarittis d ien tle lelfifgetu.nt, indoéltvolup-
tatem. ( Les favans comprennent la raifon de
l ’art ; les ignorans n’ en Tentent que le plaifir. ). L'effet pour celui qui confidère un ouvrage de
peinture e fi la fenfation ou le fentiment que cet
ouvrage lui caufe ; peur l’artifte , l’ effet eft ce
qui doit réfulter des differentes partie» de l’art
qu’il exerce.
I l eft inutile de s’étendre fur la première
fignification de ce mot. La fenfation 8c le fentiment
qu’éprouvent ceux qui regardent des
tableaux dépendent d’ une infinité de chofes qui
leur font abfolument relatives, indépendamment
de celles qui regardent l’artifte.
Quant à Y effet obfer vé relativement au peintre,
voici quelques réflexions qu’ il eft bon defuggérer
à ceux qui ne font point affez avancés pour les
avoir faites. L’ art de la peinture eft compofé de
plnfieurs parties principales , chacune de ces
parties eft deftinée à produire une imprelfion
particulière, qui eft fon effet propre. ^ Veffet du delfm eft d’ imiter les formes ; celui
de la couleur, de donner à chaque objet la
nuance qui le diftingue des autres ; le clair-
obfcur imite les effets de la lumière , & ainfi des
autres parties de l’art. La réunion de ces différens effets particuliers caufe une imprefïioh qu’on
nomme Y effet du tout enfemble.
I l e ft donc effentiel pour parvenir à conduire
un tableau à un effet jufte & général, à une unité
d'effet, que toutes fes parties tendent à un feul
point. Mais quelle eft la partie de l’ art qui doit
„commander , qui doit fixer le but auquel toutes
doivent tendre & arriver? C’ eft Y invention,
puifque c’ eft elle qui agit la première dans l’efprit
du peintre, lorfqu’ il médite un ouvrage & que
celui qui commenceroit à peindre, fans avoir
bien décidé ce qu’ il repréfemera, reffembleroit
à un homme qui voudroit regarder avant d’ ayoir
ouvert les yeux. C’ eft l ’ invention qui règne fur
tous les genres de peindre; c’ eft elle qui les a
créés 8c qui les reproduit; elle doit donc décider
de Yeffet qui doit réfulter de chacun de ces
genres.
L’effet du tableau d’ hiftoire ccnûfte dans l’ ex-
prefïion exaéte des aélions & des pafîïons; celui
du portrait, dans la reffemblance des traits; celui
dupayfage, dans la repréfentalion des fîtes, &
celui d’ une peinture de marine, dans celle des
eaux.
Mais dans chacune des parties qui constituent
Fart de peindre, on entend plus particulièrement
par le mot effett lorfqu’ il n’eft accompagné d’au-
E F F
cune épithète, une expreffion jufte , g ra n d em a -
jeftueufe, forte.
Ainfi Yeffet dans le deflin, elt un contour
hardi qui exprime fenfiblement des formes que
l ’artifte connoît parfaitement; & qu’ il ne raie
fouvent qu’ indiquer habilement. La liberté , la
confiance avec lefquelles il rappelle leur place,
leur figure, leur proportion, leur apparence
éclairée ou colorée font dire que c’eft un deflin
d9effet. C’eft ainfi que Michel-Ange, en traçant
une figure, favoit exprimer quelquefois par le
fimple trait, la conformation des membres, leur
jufte emmanchement, l’apparence des mufcles,
les enchâffemens des yeux , les plans fur lefquels
les os de la tête font placés, enfin le caraélère
de l’ aélion qui doit infailliblement réfulter de
la jufteffe de toutes ces combinaifons. Avec le
fecours de quelques hachures, il pouvoit indi-
iux yeux exercés dans l’art de la peinture f
du clair-obfcur & l’on pourroit dire même
de la couleur ; un deflin de cette efpèce eft
Yeffet
celui
ce qu’on appelle un deflin du plus grand effet.
L'effet particulièrement appliqué au coloris,
eft celui qui porte l’imitation des couleurs locales
à un point de perfeélion capable de faire une
illufion prompte & fenfible.
La couleur locale eft la couleur propre &
diftinélive de chaque objet : elle a , dans la
nature, quand la lumière ejl favorable, une force
& une valeur que l ’art a bien de la peine à imiter.
Des organes juftes & bien exercés dans
les moyens de l ’art peuvent y prétendre, mais
l’écueil qui fur cette mer difficile eft le plus
fameux par les naufrages, c’eft cette habitude
de tons &: de nuances qui s’enracine, fans
que les peintres s’ en apperçoivent, par une pratique
répétée & qui, renaiffant dans tous leurs
ouvrages, fait dire de plnfieurs artiftes, qu’ ils
ont peint g r is , ou roux; que leur couleur ref-
femble à la brique/ qu’ elle eft rouge, ou noire^
ou violette. Ce défaut, fi favorable à ceux qui ,
fans principes , veulent diftinguer les maniérés
des maîtres, eft une preuve de l’ infériorité de
l’ imitation de l’ artifte. La nature n’ eft préci-
fément ni dorée, ni argentée : e lle n’ a point de
couleur parafite ; fes nuances font des mélanges
de couleurs rompues, reflétées, variées & celui
qui afpire à Yeffet par la couleur, n’ en doit avoir
aucune à lui.
On peut rendre plus frappant Yeffet de la couleur
, par la difpofition des lumières ; mais des
périls menacent encore ceux qui fe fondent fur
ce fècours. Le defir d’ exciter l’attention par
des effets, inlpira au Carravage d’éclairer fes
modèles d’ une manière qui fe rencontre rarement
dans la nature : le jour qu’ il faifoit defeendre
par des ouvertures ménagées avec a r t , offroit
a fes yeux des lumières viv e s, mais tranchantes.
Il en réfulta, dans les imitations qu’ il en fit, des
effets plus finguliers qu’ agréables; les oppoüquera