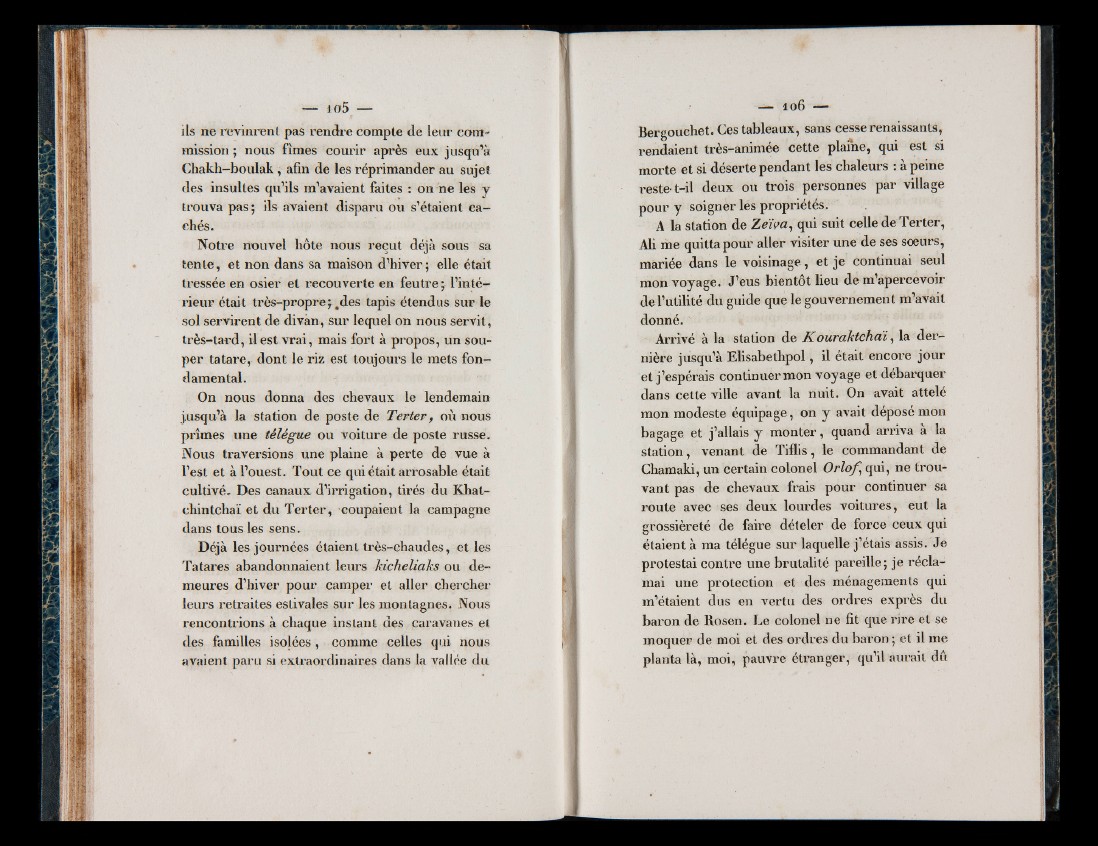
ils ne revinrent pas rendre compte de leur commission
; nous fîmes courir après eux jusqu’à
Chakh-boulak, afin de les réprimander au sujet
des insultes qu’ils m’avaient faites : on ne les y
trouva pas ; ils avaient disparu ou s’étaient cachés.
Notre nouvel hôte nous reçut déjà sous sa
tente, et non dans sa maison d’hiver; elle était
tressée en osier et recouverte en feutre ; l’intérieur
était très-propre ; #des tapis étendus sur le
sol servirent de divàn, sur lequel on nous servit,
très-tard, il est vrai, mais fort à propos, un souper
tatare, dont le riz est toujours le mets fondamental.
On nous donna des chevaux le lendemain
jusqu’à la station de poste de Tevter, où nous
prîmes une tèlègue ou voiture de poste russe.
Nous traversions une plaine à perte de vue à
l’est et à l’ouest. Tout ce qui était arrosable était
cultivé. Des canaux d’irrigation, tirés du Khat-
chintchaï et du Terter, coupaient la campagne
dans tous les sens.
Déjà les journées étaient très-chaudes, et les
Tatares abandonnaient leurs kicheliaks ou demeures
d’hiver pour camper et aller chercher
leurs retraites estivales sur les montagnes. Nous
rencontrions à chaque instant des caravanes et
des familles isolées , comme celles qui nous
avaient paru si extraordinaires dans la vallée du
Bergouehet. Ces tableaux, sans cesse renaissants,
rendaient très-animée cette plaine, qui est si
morte et si déserte pendant les chaleurs : a peine
reste-t-il deux ou trois personnes par village
pour y soigner les propriétés.
A la station de Zeïva, qui suit celle de Terter,
Ali me quitta pour aller visiter une de ses soeurs,
mariée dans le voisinage, et je continuai seul
mon voyage. J’eus bientôt lieu de m’apercevoir
de l’utilité du guide que le gouvernement m’avait
donné.
Arrivé à la station de Rouraktchai, la dernière
jusqu’à Elisabethpol, il était encore jour
et j ’espérais continuer mon voyage et débarquer
dans cette ville avant la nuit. On avait attelé
mon modeste équipage, on y avait déposé mon
bagage et j’allais y monter, quand arriva à la
station, venant dé Tiflis, le commandant de
Chamaki, un certain colonel Or lo f qui, ne trouvant
pas de chevaux frais pour continuer sa
route avec ses deux lourdes voitures, eut la
grossièreté de faire dételer de force ceux qui
étaient à ma télégue sur laquelle j ’étais assis. Je
protestai contre une brutalité pareille; je réclamai
une protection et des ménagements qui
m’étaient dus en vertu des ordres exprès du
baron de Rosen. Le colonel ne fit que rire et se
moquer de moi et des ordres du baron ; et il me
planta là, moi, pauvre étranger, qu’il aurait dû