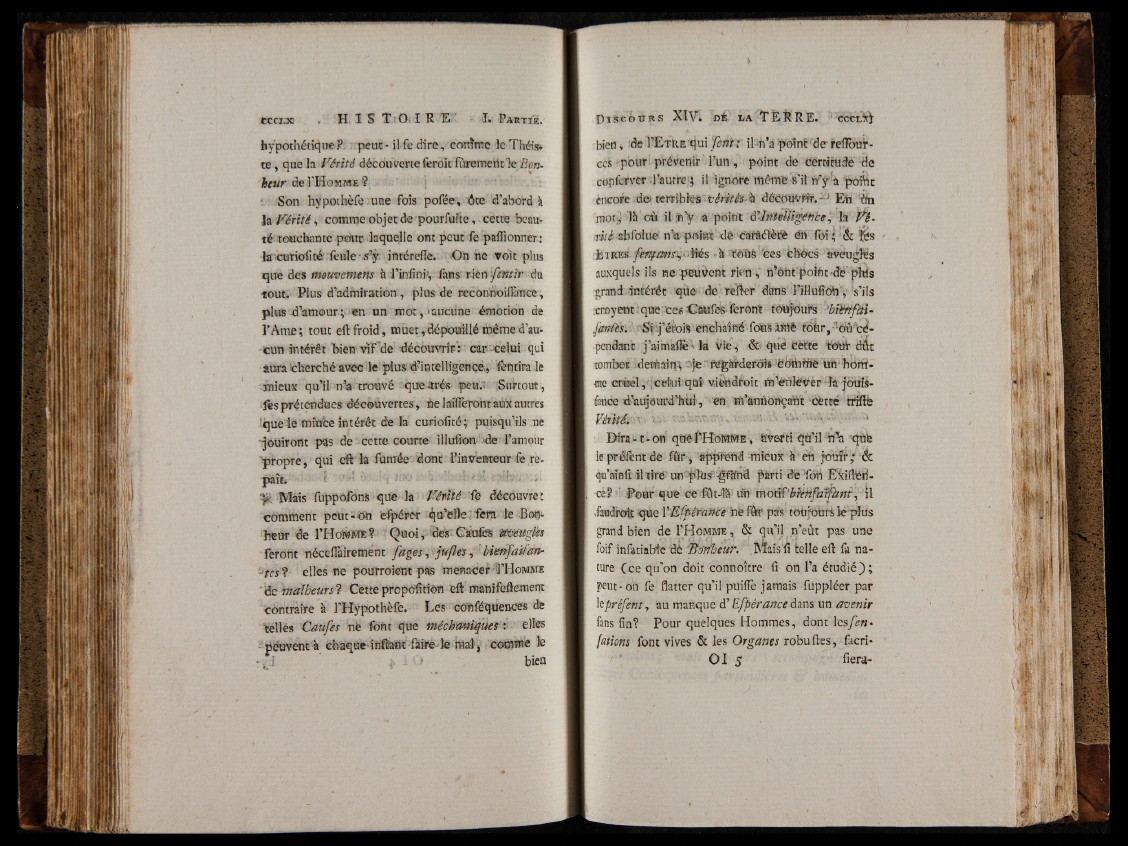
hypothétique ? peut - il fe dire, corflmc le Tbéis+
te, que la Vérité découverteferoit fùrement le Bonheur
de ritîoMiWE ?
■ Son hvpothèfe une fois pofée, ôte d’abord )i
la Vérité, comme objerde pourfuîte, cette beauté
touchante pcKir laquelle ont peut fe pailionner :
lu curiofité feule - s’y intéreiïe. Oh ne voit plus
que des mouvement à l ’infini', fans ntnfsmir du
tout. Plus d’admiration, plus de reconnoifiimce,
plus d’âmour ;> en un mot, »aucune émotion de
l’Ame; tout eft froid, muet, dépouillé même d’aucun
intérêt bien viTde découvrir': car celui qui
aura cherché avec le plus d’intelligence,, fendra le
mieux qu’il nVtrouvé que -très ¡peu.: Surtout ,
fes prétendues découvertes, ne laifibront aux aurres
iquelefnînêe intérêt de la curiofité; puisqu’ils ne
jouiront pas de cette courte» iliufîon »de l’amour
propre, qui eft la fumée dont l’invcRteur fe repaît*
« ' fe. .
■ÿ; Mais fuppôfôns que la Vérité fe découvre :
comment peut-on efpéper Qu’elle,fera le Bonheur
de l’HoiW:? Quoides Oaufès w&éugks
feront néceflairefnent fages, jujles, bienfaifan-
Jtesci elles ne pourraient pas menacer H’Homme
de malheurs ? Cette properfition eft fflâhifeftement
contraire à l'Hypothèfe. Les conféquences de
telles Caufes né font que méchmiques : elles
péuvent à cbaque inftant fàire te rnaî, coow*ie le
bien, de l’ETkE'qui fenti' il n’a point de refTour-
ecs pour prévenir l’un, point de cêrtitude de
cofiferver -l’autre ; il ignore même s’il ti’f'ù poiht
encore de» tembk's térité's îi découvrir.- J En On
mot# ’fit oit il n’y a point â’Ittteiïigéttbe? te Pi.
nié nbfolue n’a point de carftéiè® â f (bî ; *ét fts
ÜTKEs./è?qri2wiv.'hés r à toliS Ces fchôcs aveugfés
auxquels ils ne peuvent rien ,’ n’oht point-dè phis
grand intérêt que de refter dans l’illufion ; s’ils
iroyei« : que ces CàUfës-feront toujours 'biMfài-
fmfési■ SLj’étoiS enchaîné fofcS ittéédûr, -’‘OÙ cependant
j’aimaffe ■ la vie ; & que Cette tOtiV dut
tomber demain; 'je regarderais dothihè mr horrf-
rac crràel, ; celui qui' viendrait m’enlever la jouiî-
fanoe'd’aujourd’hui, en m’annohçaht cétre triftfe
Vérité. v , . ' , ' - v , , ......... *
Dira -t-on que I’HoMMe , averti qù’i lWn qufe
le prêfent de ffir , apprend mieux à en joufr,* de
qu’ainfi-il tire' un' plns t*fifhâ parti dé fon Ekiftéh-
ce? : -Pour que ce fût-îà uh moûibftnfb'ffhrtt, il
faudrait que l’Efpëranee he fèr pas toujours krplus
grand bien de I’Homme, & qu’il rn’eut pas une
foif infatiabie dè ‘Béitbeur. ,Mais’fi telle eft fa nature
(c e qu’on doit connoître fi on l’a étudié);
peut-on fe flatter qu’il puiflè jamais fuppléer par
le prêfent, au manque d’ Efpèrance dans un avenir
fans fin? Pour quelques Hommes, dont les/à«.
Iations font vives & les Organes robuftes, facri-
0 1 5 fiera