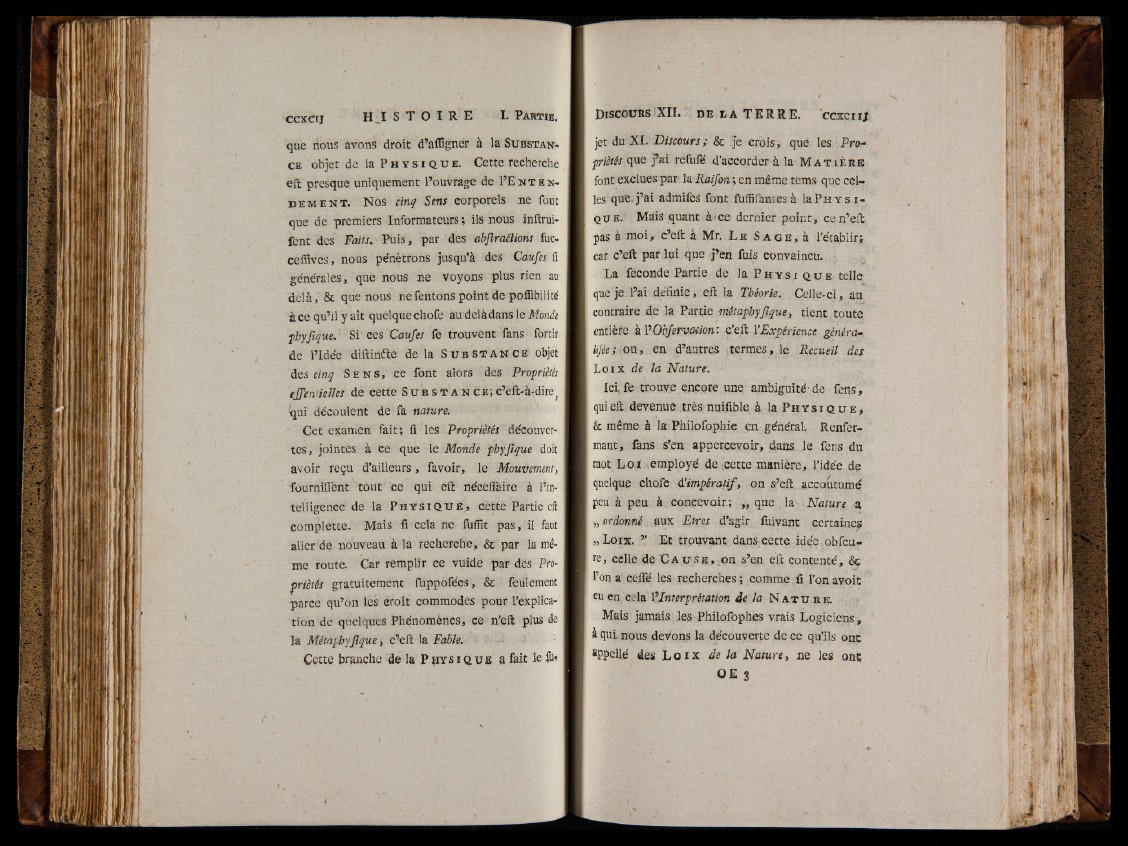
que nous avons droit d’aifigner à la Su b s t a n c
e objet de la P h y s i q u e . Cette recherche
eft presque uniquement l’ouvrage de PE n t e n -
d e m e n t . Nos cinq Sens corporels ne font
que de premiers Informateurs ; ils nous inftrui-
fent des Faits. ' Puis, par des abjlraâions fuc-
ceffîves, nous pénétrons jusqu’à des Caufes fi
générales, que nous ne voyons plus rien au
delà, & que nous nefentons point de poflibilité
à ce qu’ il y ait quelque chofe au delà dans le Monde
phyftque. Si'ces Caufes fe trouvent fans fortir
de l’ Idée diftinéte de la S u b s t a n c e objet
des cinq S e n s , ce font alors des Propriétés
efpeniielles de cette S u b s T A n c e ; c’eft-à+dire^
(qui découlent de fa nature.
Cet examen fait ; fi les Propriétés découvertes,
jointes à ce que le Monde phyjique doit
avoir reçu d’ailleurs, favoir, le Mouvement,
fournifierft tout ce qui eft néceflaire à l’intelligence
de la P h y s i q u e , cette Partie eft
complexe. Mais fi cela ne fuffit pas, il faut
aller de nouveau à la recherche, & par la même
route. Car remplir ce vuide par dés Propriétés
gratuitement fuppofées, & feulement
parce qu’ on les croit commodes pour l’explication
de quelques Phénomènes, ce n’eft plus de
la Métaphyjique, c’eft la Fable.
Cette branche de la P h y s i q u e a fait le fui
jet du XI. Discours ; & .je crois, que les Propriétés
que j’ai refufé d’accorder à la Matière
! font exclues par la Raifon ; en même tems que cel-
! le s que. j’ai admifes font fuffifantesà l aPHYs i -
| que. Mais quant à 'ce dernier point, ce n’ eft
pas à moi, c’eft à Mr. Le Sag e , à l’établir;
car c’eft par lui que j ’ en fuis convaincu.
La fécondé Partie de la P h y s i q u e telle
que je l’ai définie, eft la Théorie. Celle-ci, au
contraire de la Partie métaphyjique, tient toute
entière à P Obfervaüon'. c’eft l’Expérience généra-
lijée; ou, en d’autres termes, le Recueil des
Lo ix de la Nature.
Ici,fe trouve encore une ambiguité-de fens,
qui eft devenue .très nuifible à la P h y s i q u e ,
& même à la Philofophie en général; Renfermant,
fans s’en appercevoir, dans je fens du
| mot L o i .employé de .cette manière, l’idée de
I quelque chofe à!impératif, on s’eft accoutumé
] peu à peu à concevoir; „ que la Nature a
| „ ordonné aux Etres d’agir fuivant certaine®
f „L o ix . ” Et trouvant dans cette idée obfcu-
1
| re, celle de Ca u s e , on s’ en eft contenté, &
l’on a ceifé les recherches ; comme fi l’on avoit
eu en cela P Interprétation de la N ature.
Mais jamais les Philofophes vrais Logiciens,
à qui nous deVons la découverte de ce qu’ils ont
sppellé des L o i x de la Nature, ne les ont;
OE s