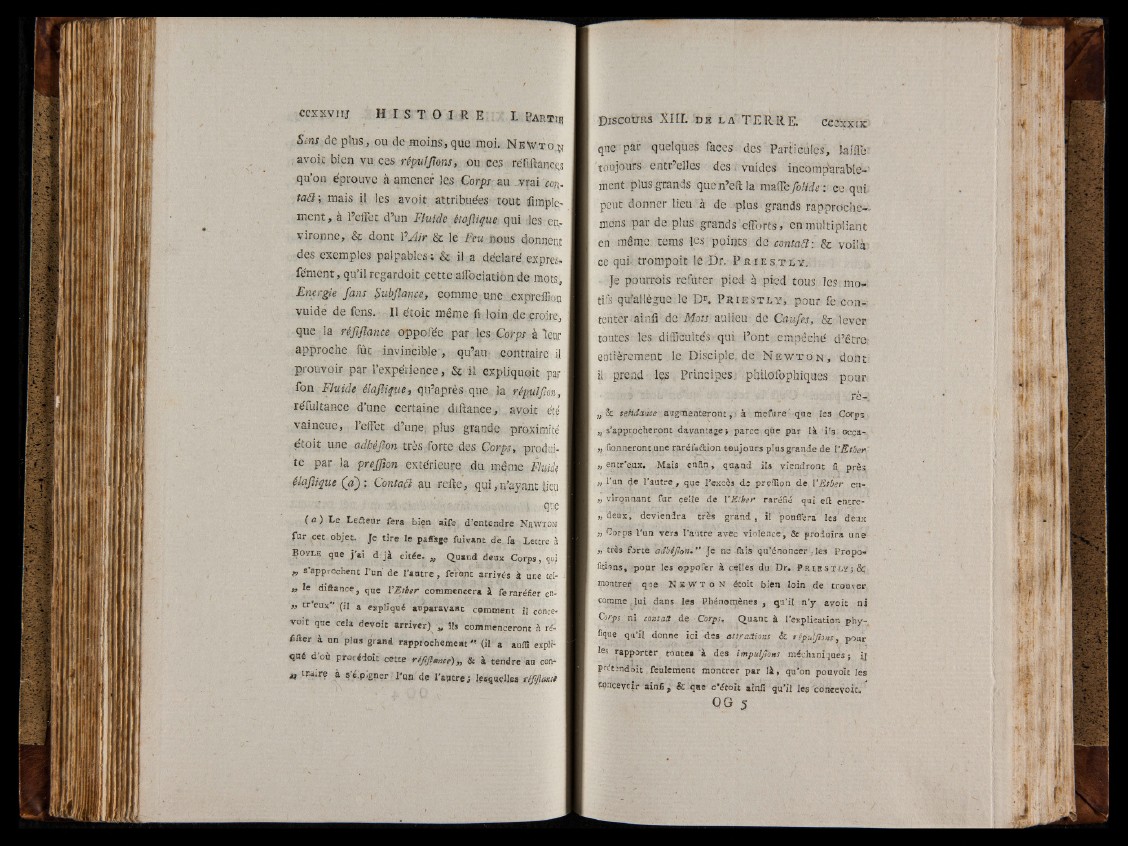
Sens de plus, ou de moins, que moi. N e w t o j
; a voit bien vu ces répulfions, ou ces réûftançcs
qu’on éprouve à amener les Corps au .vrai con.
taâ', mais il les avoit attribuées tout fimple-
ment, a l’effet d’un Fluide étafiique qui les environne,
& dont l'Air & le Peu nous donnent
des exemples palpables; & il a déclaré expres-
fément,qu’ilregardoit cette affociation de mots,
Energie fans Subfiancc, comme une .expreflion
vuide de fens. Il étoit même Îi loin de croire,
que la réfifiance oppofée par les Corps à leur
approche fût invincible, qu’au contraire il
prouvoir par l’expérience, & il expliquait par I
fon Fluide élafiique, qu’après que J a répulfion,
réfultance d’une certaine diftance, avoit été
vaincue, l’effet d’une, plus grande proximité
étoit une adhèfion très forte des Corps, produite
par la preffion extérieure du même Flmà\
çiafiique (a) : ContaÇl au refte , qui, n’ayant fieu
,/if.Æ .là,:' à:;'ï>> -rK-à, f, ¡ j |
( a ) Le Leéteur fera bien aife d’entendre NeWtou
fur cet objet. Je tire le paflsge fuivant de fa Lettre à
B o y l e que j ’ai d jà citée. * Quand deux Corps, qui „ s’approchent l ’un de l’antre , ferbnt arrivés à une tel-
» *e diftance, qUe Y Ether commencera à fe raréfier en-
,, tr ’eux” (il a expliqué auparavant comment il conce-
voit que cela devoit arriver) „ 51* commenceront à ré-
firter à un plus grand rapprochement "■ (il a auffi expliqué
d’où prorédoit cette réjifi,nce)„ & à tendre au con-
« à s’é.pigner l ’un de l’autre; lesquelles réfjiar.ti
j que par quelques faces des Particules, laiffe
toujours entr’ elles des i vuides incomparablement
plus grands quen’eftla maffe/o//^ : ce qui
peut donner lieu à de plus grands rapproche—
mens par de plus grands efforts, en multipliant
en même tems les points de co n ta â& voilà’
ce qui- trompait lé Dr. P r i e s t l y .
Je pourrois réfuter pied à pied tous les mo-
tifs qufallègue le D*. P r i e s t l y , pour fe contenter
ainfi de Mots aulieu de Caufes, & lever
toutes les difficultés qui Pont empêché d’être,
entièrement le Disciple, de N e w t o n , donc
il prend lçs Principes, philofophiques pour
r è —.
„ & tendance ; augmenteront,: à mefure'que les Corps
,, s’approcheront davantage; parce qiie par là ils occa-
„ Sonneront une raréfaftion toujours plus grande de l ’Ether
„ entr’eux. Mais enfin, quîind iis viendront fi près,
„ l’un de l’autre , que l’excès de prçfiùon de YEther en-,
,, vironnant fur celle de YElher raréfié qui eft entre-
„ deux, deviendra très grand, il pouffera les deux
„ Corps l’un vers l ’autre avec violence, & produira une
„ très forte adhèfion. ” je ne fais qu’énoncer les Propo-
fitisns, pour les oppofer à celles du Dr, P r i e s t l y ; &
montrer que N e w t o n étoit bien loin de trouver
comme lui dans les Phénomènes , qu’il n’y avoit ni
Corps ni contai de Corps, Quant à l’explication phy-
fique qu’il donne ici des attraiions & répu f :ns, pour
les rapporter toute* à des impulfdns méchaniques; R
prétindoit feulement montrer par là , qu’on pouvoît les
concevoir ainfi, & que c ’étoit ainfi qu’il les coneevo«. ’
QG 5