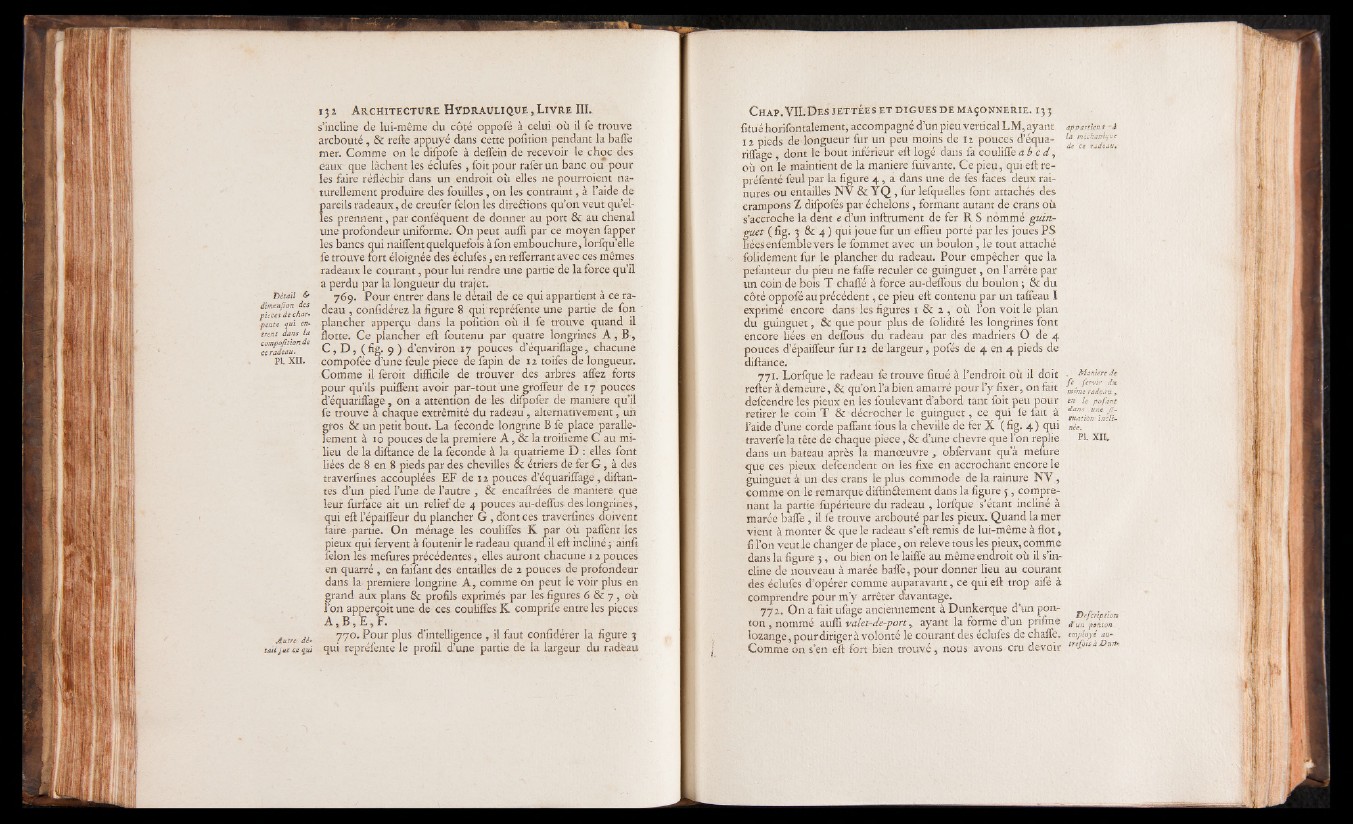
Détail &
dîmenfion des
pièces de char•
è.pente qui entrent
dans la
cotnpofition de
ce radeau.
PI. XII.
Autre•. détail
J uz ce gui
s’incline de lui-même du côté oppofé à celui où il fe trouve
arcbouté , & refte appuyé dans cette pofition pendant la baffe
mer. Comme on le difpofe à deffein de recevoir le choc des
eaux que lâchent les éclufes , foitpour raferun banc ou pour
les faire réfléchir dans un endroit où elles ne pourraient naturellement
produire des fouilles, on les contraint, â l’aide de
pareils radeaux, de creufer félon les direftions qu’on veut qu’elles
prennent, par conféquent de donner au port & au chenal
une profondeur uniforme. On peut auffi par ce moyen fapper
les bancs qui naiffentquelquefois àfon embouchure, lorfqu’elle
fe trouve fort éloignée des éclufes , en refferrant avec ces mêmes
radeaux le courant, pour lui rendre une partie de la force qu’il
a perdu par la longueur du trajet.
769. Pour entrer dans le détail de ce qui appartient à ce radeau
, confidérez la figure 8 qui repréfente une partie de fon
plancher apperçu dans la pofition où il fe trouve quand il
flotte. Ce plancher eft foutenu par quatre longrines À , B ,
C , D , ( fig. 9 ) d’environ 17 pouces d’équariffage, chacune
compofée d’une feule piece de fapin de 12 toifes de longueur.
Comme il ferait difficile de trouver des arbrés allez forts
pour qu’ils puiffent avoir par-tout une groffeùr de 17 pouces
d’équariffage, on a attention de lés difpofer de maniéré quil
fe trouve à chaque extrémité du radeau , alternativement, un
gras 8e un petit bout. La fécondé longrine B fe place parallèlement
à 10 pouces de la première A , & la troilieme C au milieu
de la diftance de la fécondé à la quatrième D : elles font
liées de 8 en 8 pieds par des chevilles & étriers de fer G , à des
traverfines accouplées EF de 12 pouces d’équariffage, diftan-
tes d’un pied l’une.de l’autre , & encadrées de maniéré que
leur furface ait un relief de 4 pouces au-deffus des longrines,
qui eft l’épaiffeur du plancher G , dont ces traverfines doivent
faire partie. On ménage les couliffes K par où paffent les
pieux qui fervent à foutenir le radeau quand il eft incliné ; ainfi
lelon les mefures précédentes, elles auront chacune 12 pouces
en quarré , en faifant des entailles de 2 pouces de profondeur
dans la première longrine A , comme on peut lé voir plus en
grand aux plans & profils exprimés par les figures 6 & 7 , où
l’on apperçoit une de ces couliffes, K comprife entre les pièces
A , B , E , F.
770. Pour plus d’intelligence , il faut confidérer la figure 3
qui repréfente le profil, d’une partie de la. largeur du radeau
C h a p .V I I .D es j e t t é e s e t d ig u e s d e m a ç o n n e r ie . 13 3
fitué horifontalement, accompagné d’un pieu vertical LM, ayant appartient -à
12 pieds de longueur fur un peu moins de 12 pouces d’équa- ^
riffage , dont le bout inférieur eft logé dans fa couliffe a b c d ,
où on le maintient de la maniéré fuivante. Ce pieu, qui eft re-
préfenté feul par la figure 4 , a dans une de fes faces deux rainures
ou entailles N V 8e Y Q , fur lefquelles font attachés des
crampons Z difpofés par échelons , formant autant de crans où
s’accroche la dent e d’un infiniment de fer R S nommé guin-
guet ( fig. 3 8e 4 ) qui joue fur un effieu porté par les joues PS
liées enfemble vers le fommet avec un boulon, le tout attaché
folidement fur le plancher du radeau. Pour empêcher que la
pefanteur du pieu ne faffe reculer ce guinguet, on l’arrête par
un coin de bois T chaffé à force au-deffous du boulon ; 8e du
côté oppofé au précédent ,c e pieu eft contenu par un taffeau I
exprimé encore dans les figures 1 8c 2 , où l’on voit le plan
du guinguet, 8e que pour plus de folidité les longrines font
encore liées en deffous du radeau par des madriers O de 4
pouces d’épaiffeur fur 12 de largeur, pofés de 4 en 4 pieds de
diftànce.
771. Lorfque le radeau fe trouve fitué à l ’endroit où il doit - Maniéré.h
relier à demeure, 8e qu’on l’a bien amarré pour l’y fixer, on fait mtmï7àL,iu,
defcendre les pieux en les foulevant d’abord tant foit peu pour en h pofimt
retirer le coin T 8e décrocher le guinguet, ce qui fe fait à
l’aide d’une corde paffant fous la cheville de fer X (fig. 4 ) qui née.
traverfe la tête de chaque piece, 8e d’une chevre que l’on replie El. xil.
dans un bateau après la manoeuvre , obfervant qu’à mefure
que ces pieux defeendent on les fixe en accrochant encore le
guinguet à un des crans le plus commode de la rainure N V ,
comme on le remarque diftinûement dans la figure 5, comprenant
la partie fupérieure du radeau , lorfque s’etant incline à
marée baffe , il fe trouve arcbouté par les pieux. Quand la mer
vient à monter 8c que le radeau s’eît remis de lui-même à flo t,
fi l’on veut le changer de place, on releve tous les pieux, comme
dans la figur.e 3, ou bien on le laiffe au même endroit où il s’incline
de nouveau à marée baffe, pour donner lieu au courant
des éclufes d’opérer comme auparavant, ce qui eft trop aifé à
comprendre pour m’y arrêter davantage.
772. On a fait ufage anciennement à Dunkerque d’un pon- f t ( i . ^
ton , nommé auffi yalet-de-port,. ayant la forme d’un prifme j un ,„nt0n
lozange, pour dirigera volonté le courant dès éclufes de chaffe. employé au-
Comme on s’en eft fort bien trouvé , nous avons cru devoir