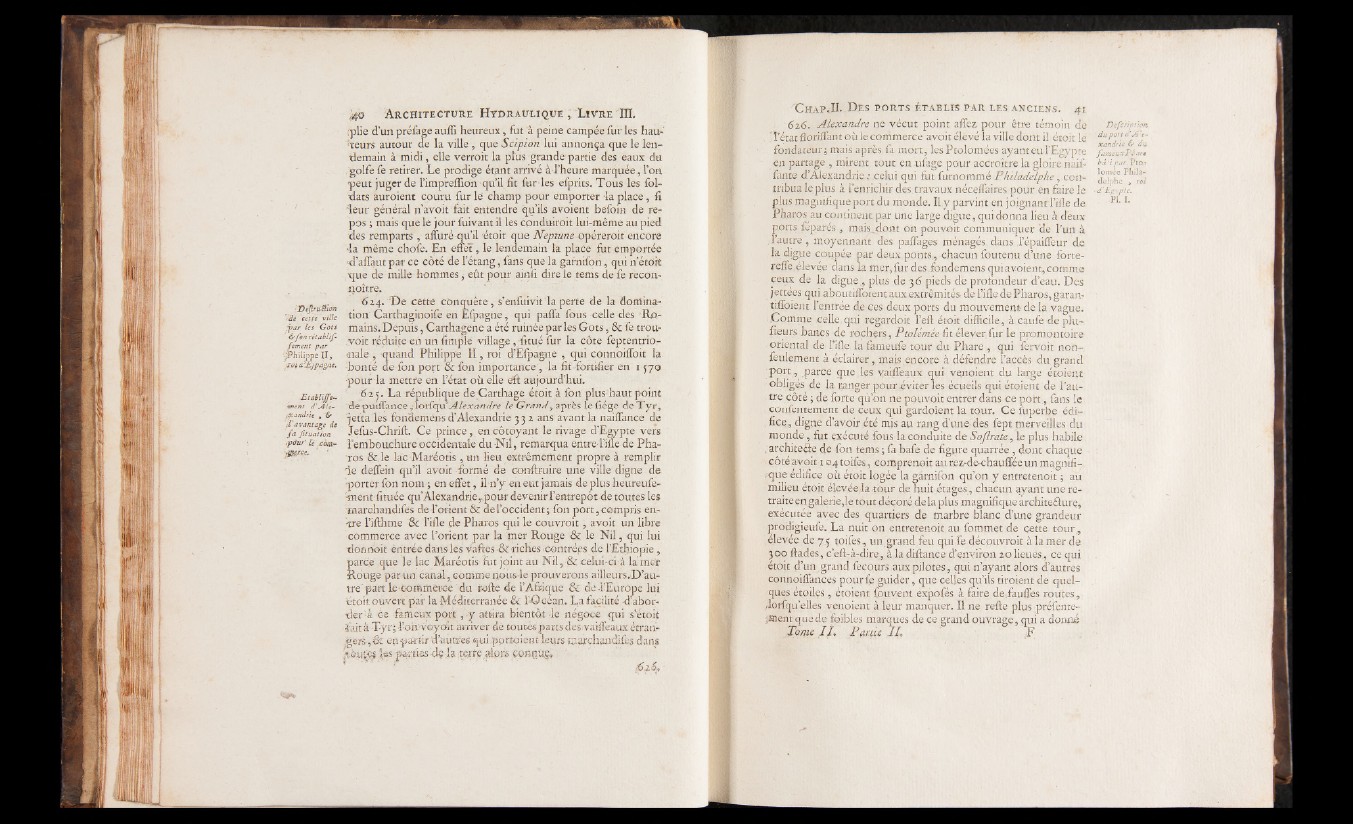
-Dejîruêîlon
i'âe cetfre ville
.par les Gots
& fon rètablif-
fement par
^Philippe II,
f o i a^Ejpagne.
JLtabhJfe—
raient d’A le xandrie
, &
d 'avantage de
f a f it nation
.pâtir- le ,cm -
’ ■ ‘
•plie d’un préfage auffi heureux, fut à peine campée fur les hauteurs
autour de la v ille , que Scipiôn lui annonça que le lendemain
à midi, elle verrait la plus grande partie des eaux du
golfe fe retirer. Le prodige étant arrivé à l’heure marquée, l’on
peut juger de Timpreffion-qu’il fit fur ies efprits. Tous les fol-
dats auraient couru fur le champ pour emporter 4a place, fi
ieur général n’avoit fait entendre qu’ils avoient befoin de repos
; mais que le jour fuivant il les conduirait lui-même au pied
des remparts , affuré-qu’il étoit que Neptune opérerait encore
4a même chofe. En effet, le lendemain la place fut emportée
•d’alfaut par ce côté de l’étang, fans que la garnifon, qui n’étoit
que de mille hommes; eût pour ainfi dire le tems de fe recon-
noître.
614. D e cette conquête, s’enfuivit la perte de la domination
Carthaginoife en Efpagiie, qui paffa fous celle des -Romains.
Depuis, Carthagene a été ruinée par les Gots , & fe trou-
,-voit réduite en un fimple village ,;fitué fur la côte feptentrio-
<nale , quand Philippe B , roi d;Efpagne , qui connoilloit la
-bonté de-fon port & fon importance , la fit fortifier en 1570
■ pour la mettre en l’état où elle eft aujourd’hui.
625. La république de Carthage étoit à fon plus haut point
depuiffance Alexandre lé Grand, après le fiége de T y r ,
■ jetta les fonàemens d’Alexandrie 332 ans avant la naiffance de
Jefus-Chrift. Ce prince, en côtoyant le rivage d’Egypte vers
l ’embouchure occidentale du-Nil , remarqua ent-reTifle de Pha-
-ros &.le lac Maréotis , un lieu extrêmement propre à remplir
4e deffein qu’il avoit formé de eonftruire une ville digne de
•porter fon nom ; en effet, il-n’y en eut jamais de plus heureufer
'ment-fituée qu’Alexandrierpour devenirl’entrepôt de toutes les
rnarehandifes de l’orient & de l’occident; fon port,compris entre
l’ifthme & l’ifle de Pharos qui le cou v ra it, avoit un libre
commerce avec l’orient par la mer Rouge & le Ni l , qui lui
donnbit entrée dans les vaftes -& riches ■ contrées de l’Ethiopie,
parce que le' lac Maréotis fut joint au Nil, & celui-ci à la mer
•Rouge par un canal, comme nôus le prouverons.ailleurs.D’autre'pan
le-Commerce du rofte de l’Afrique & de-i’Europe lui
’étoit ouvert par la Méditerranée & 1-Océan. La facilité d’aborder
’-a ce -fameux port , -y attira bientôt -le négoce qui s’étoif
fait à T y r ; -Ifon-voypit arriver dé toutes parts des vaiifeaux étrangers,
& en partir 'd’autresqui.pprtoieiit- leurs marchandifes dans
\tts parties d ç fa xette alors eoniiùg,
C h a p J I . D es p o r t s é t a b l i s p a r l e s a n c ie n s . 41
616. Alexandre ne vécut point affez pour être témoin de
. T’étatfloriffant où le commerce avoit élevé la ville dont il étoit lé
fondateur; mais après fa mort, les Ptolomées ayant eu l’Egypte
en partage., mirent tout en ufage pour accroître la gloire naif-
fante d’Alexandrie : .celui qui fut furnommé Philadelphe, contribua
le plus à l’enrichir des. travaux néceffaires pour en faire le
plus magnifique port du monde. Il.y parvint en joignant l’ifle de
Pharos .au continent, par une large,digue, qui donna lieu à deux
ports féparés, mais_doat on pouv-oit communiquer de l’un â
.1 autre, moyennant des paffages ménagés.dans l’épaiffeur de
la digue coupée par deux,ponts.,, chacun foutenu d’une forte-
reffe.élevée dans.la mer,fur des.fondemens qui avoient, comme
ceux de la digue., plus de 36 pieds de profondeur d’eau. Des
jettées qui aboutiffoient aux,extrémités de l’ifle de Pharos, garan-
tiffoient l’entrée de ces deux ports du mouvement de la vague.
..Comme celle,qui regardoit l’eft étoit difficile, à.caufe de plu-
fieurs bancs de rochers, Ptolémée fit élever.fur le promontoire
- oriental de Fille la fameufe tour du Phare., qui. fervoit non-
feulement à éclairer, mais.encore à défendre l’accès du.grand
'Port 5 ..parce que,les vaiifeaux qui venoient du large étoient
obligés de la ranger pour éviter les écueils qui étoient de l ’autre
côte ; de forte qu’on ne pouvoit entrer dans ce por t, fans le
confentement de ceux qui gardoient la tour. Ce fuperbe édi—
fice, digne d’avoir été mis au rang d’une des fept merveilles du
monde, fut exécuté fous la conduite de Sojlrate., le plus habile
. architeéfe de fon tems ; fa bafe de figure quarrée , dont chaque
, côté avoit 104toifes , eomprenoit auÈez-de-chaulfée un magnifiq
u e édifice où étoit logée la garnifon qu’on y entretenoit ; au
milieu étoit élevée,la tour de huit .étages, chacun ayant une re-
traite engalerie,le tout décoré.dela plus magnifique archite&ure,
executéè avec des quartiers de marbre blanc d’une grandeur
prodigieufe. La nuit on entretenoit.au fommqt de cette tour.,
, élevée de 7.5 toifes, un.grand feu quife découvrait à la mer de
300 ftades, c’efl-à-dire., à.la diftance d’environ 20lieues., ce qui
. étoit d’un grand fecours aux pilotes, qui n’ayant alors d’autres
connoiffances pour fe guider, que celles qu’ils tiraient de quelquesétoiles.,
étoient fouvent expofés à faire de,fauffes routes.,
,lorfqu’elles venoient à leur manquer. Il ne refte plus préfente-
jaient que de faibles marques de ce grand ouvrage, qui a donné
Tome I J . Partie .II. -F
Defcriptlon
du port d 'A lexandrie
& du
fameuxPlare
bâ‘i par, Pto.-«
lomée. Philadelphe
3 roi
■ d'Egypte.