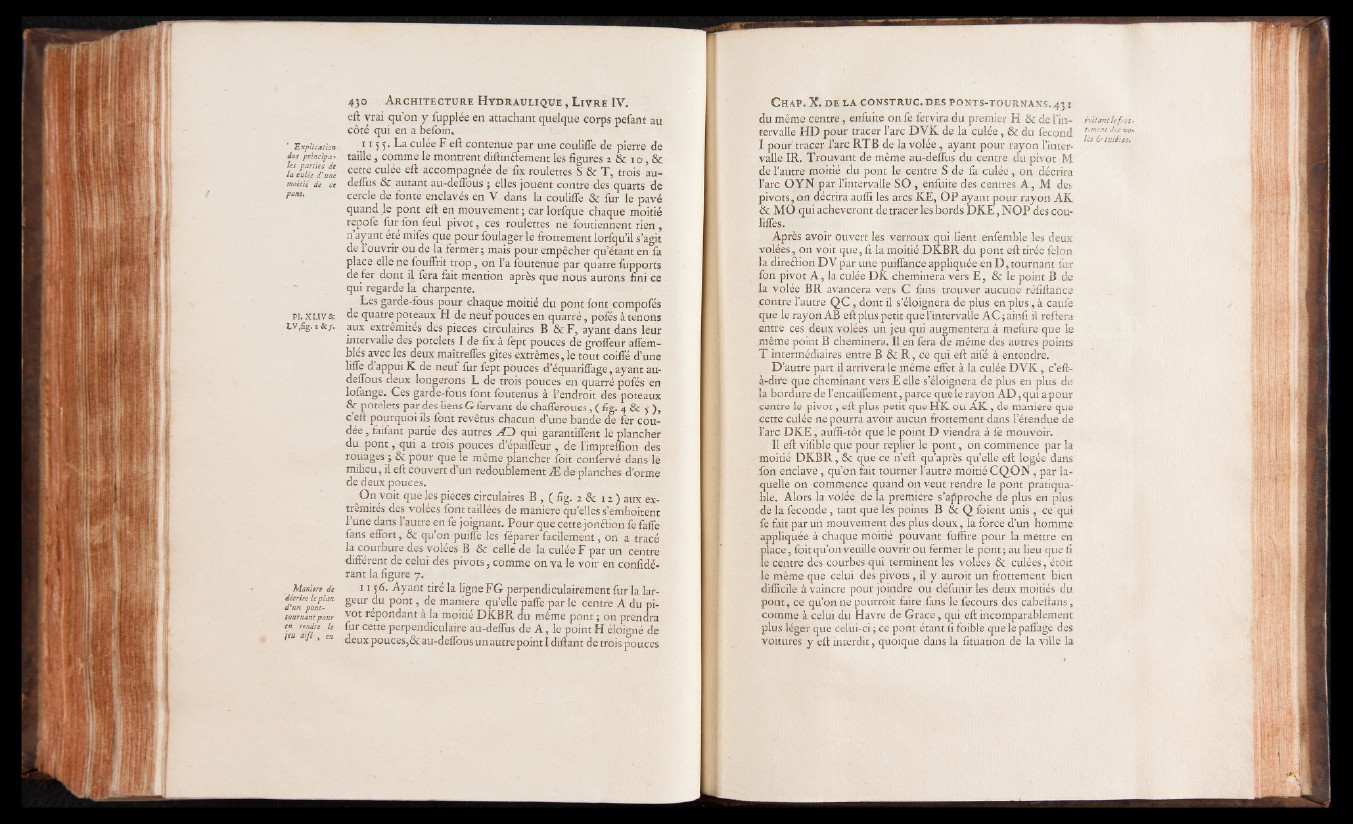
Explication
des principales
parties de
la culée d'une
moitié de ce
pont*
P1.XLÏV&
LV,fig. i & ƒ.
Maniéré de
décrire le plan
d'un pont-
tournant pour
en rendre le
jeu aifè , en
eft vrai qu’on y fupplée en attachant quelque corps pefant au
côté qui en a befoin.
115 5. La culée F eft contenue par une couliffe de pierre de
taille, comme le montrent diftin&ement les figures 2 & 1 o , &
cette culée eft accompagnée de fix roulettes S & T , trois au-
deftiis & autant au-deffous ; elles jouent contre des quarts de
cercle de fonte enclavés en V dans la couliffe & fur le pavé
quand le pont eft en mouvement ; car lorfque chaque moitié
repofe fur fan feul p ivot, ces roulettes ne foutiennent rien ,
n ayant ete mifes que pour foulager le frottement lorfqu’il s’agit
de l’ouvrir ou de la fermer; mais pour empêcher qu’étant en fa
place elle ne fouffrit trop , on l’a foutenue par quatre fupports
de fer dont il fera fait mention après que nous aurons fini ce
qui regarde la charpente.
Les garde-fous pour chaque moitié du pont font compofés
de quatre poteaux H de neuf pouces en quarré, pofés à tenons
aux extrémités des pièces circulaires B & F, ayant dans leur
intervalle des potelets I de fix à fept pouces de groffeur affem-
blés avec les deux maîtreffes gîtes extrêmes, le tout coiffé d’une
liffe d’appui K de neuf fur fept pouces d’équariffage, ayant au-
deffous deux longerons L de trois pouces en quarré pofés en
lofange. Ces garde-fous font foutenus à l’endroit des poteaux
& potelets par des liens G fervant de chafferoues, ( fig. 4 & 5 ),
c’eft pourquoi ils font revêtus chacun dune bande de fer coudée
, faifant partie des autres yî ) qui garantiffent le plancher
du p on t, qui a trois pouces d’épaiffeur , de l’impreffion des
rouages ; & pour que le même plancher foit confefvé dans le
milieu, il eft couvert d’un redoublement Æ dé planches d’orme
de deux pouces.
On voit que les pièces circulaires B , ( fig. 2 & 1 a ) aux extrémités
des volées font taillées de maniéré qu’elles s’emboitent
l ’une dans l’autre en fe joignant. Pour que cette jon&ion fe faffe
fans effort, & qu’on puiffe les féparer facilement, on a tracé
la courbure des volées B & celle de la culée F par un centre
différent de celui des pivots, comme on va le voir en confidé-
rant la figure 7.
1156. Ayant tiré la ligneFG perpendiculairement fur la largeur
au pon t, de maniéré qu’elle paffe par le centre A du pivot
répondant à la moitié D K B R du même pont ; on prendra
fur cette perpendiculaire au-deffus de A , le point H éloigné de
deux pouces,& au-deffous un autre point I diftant de trois pouces
C H A P . X . D E L A C O N S T R U C . D E S P O N T S -T O U R N A N S .4 3 1
du même centre, enfuite 011 fe fervira du premier H & de l’intervalle
HD pour tracer l’arc D V K de la culée, & du fécond
I pouf tracer l’arc R T B de la v o lé e , ayant pour rayon l’intervalle
IR. Trouvant de même au-deffus du centre du pivot M
de l’autre moitié du pont le centre S de fa culée, on décrira
l’arc O Y N par l’intervalle SO , enfuite des centres A , M des
pivots, on décrira aufli les arcs K E, O P ayant pour rayon A K
& M O qui achèveront detracer les bords D K E , N O P des cou-
liffes.
Après avoir ouvert les verroux qui lient enfemble les deux
volées, on voit que, fi la moitié D K B R du pont eft tirée félon
la direction D Vpa r une puiffance appliquée en D ,tournant fur
fon pivot A , la culée D K cheminera vers E , & le point B de
la volée BR avancera vers C fans trouver aucune réfiftaxice
contre l’autre Q C , dont il s’éloignera de plus en plus, à caufe
que le rayon AB eft plus petit que l’intervalle AC;ainfi il reliera
entre ces deux volées un jeu qui augmenter^ à meliire que le
même point B cheminera. Il en fera de même des autres points
T intermédiaires entre B & R , ce qui eft aifé à entendre.
D ’autre part il arrivera le même effet à la culée D V K , c’eft-
à-dire que cheminant vers E elle s’éloignera de plus en plus de
la bordure de l’encaiffement, parce que le rayon A D , qui a pour
centre le p ivot, eft plus petit que H K ou A K , de maniéré que
cette culée ne pourra avoir aucun frottement dans l’étendue de
l’arc D K E , aufli-tôt que le point D viendra à fe mouvoir.
Il eft vifible que pour replier le pont, on commence par la
moitié D K B R , & que ce n’efl qu’après qu’elle eft logée dans
fon enclave, qu’on fait tourner l’autre moitié C Q O N , par laquelle
on commence quand on veut rendre le pont pratiqua-
ble. Alors la volée de la première s’approche de plus en plus
de la fécondé, tant que les points B & Q foient unis , ce qui
fe fait par un mouvement des plus doux, la force d’un homme
appliquée à chaque moitié pouvant fuffire pour la mettre en
place, foit qu’on veuille ouvrir ou fermer le pont ; au lieu que fi
le centre des courbes qui terminent les volées & culées, étoit
le même que celui des pivots, il y auroit un frottement bien
difficile à vaincre pour joindre ou défunir les deux moitiés du
pont, ce qu’on ne pourroit faire fans le fecours des cabeftans,
comme à celui du Havre de Grâce, qui eft incomparablement
plus léger que celui-ci ; ce pont étant fi foible que le paffage des
voitures y eft interdit, quoique dans la fituation de la ville la
évitant le frot
tentent des vo
lés & euléces.