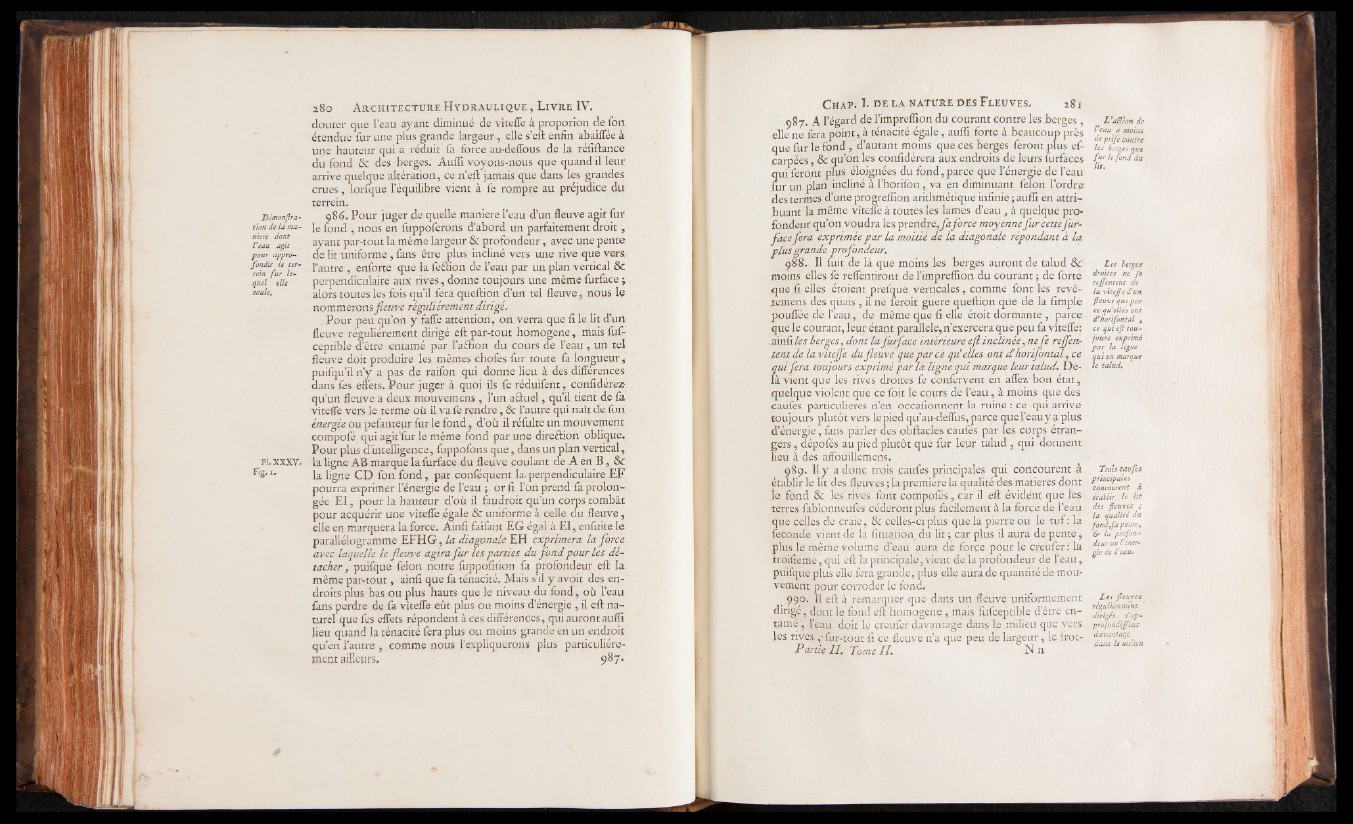
Dêmonftra-
tion de la maniéré
dont
l'eau agit
pour approfondir
le ter-
rein fur lequel
elle
saule.
PU XXXV..
% i-
280 A r c h i t e c t u r e H y d r a u l iq u e , L i v r e IV.
douter que l’eau ayant diminué de vîteffe à proporion de fon
étendue fur une plus grande largeur, elle s’eft enfin abailfée à
une hauteur qui a réduit fa force au-deffous de la réfiftance
du fond & des berges. Auffi voyons-nous que quand il leur
arrive quelque altéradon, ce rieft jamais que dans les grandes
crues, lorfque l’équilibre vient à fe rompre au préjudice du
terrein.
986. Pour juger de quelle maniéré l’eau d’un fleuve agit fur
le fond , nous en fuppoferons d’abord un parfaitement d ro it,
ayant par-tout la même largeur & profondeur, avec une pente
de lit uniforme, fans être plus incliné vers une rive que vers
l’ autre , enforte que la fefîüon de l’eau par un plan vertical &
perpendiculaire aux rives, donne toujours une même furface ;
alors toutes les fois qu’il fera queftion d’un tel fleuve, nous le
nommerons fleuve régulièrement dirige.
Pour peu qu’on y faffe attention, on verra que fi le lit d’urt
fleuve régulièrement dirigé eft par-tout homogène, mais fuf-
ceptible d’être entamé par l’aélion du cours de l’eau , un tel
fleuve doit produire les mêmes chofes fur toute fa longueur,
puifqu’il n’y a pas de raifon qui donne lieu à des différences
dans fes effets. Pour juger à quoi ils fe réduifent, confidérea
qu’un fleuve a deux mouvemens, l’un actuel, qu’il tient de fa
vîtefle vers le terme où il va fe rendre, & l’autre qui naît de fon
énergie ou pefanteur fur le fond, d’où il réfulte un mouvement
eompofé qui agit fur le même fond par une direftion oblique.
Pour plus d’intelligence, fuppofons que, dans un plan vertical,
la ligne AB marque la furface du fleuve coulant de A en B , &
la ligne CD fon fond, par conféquent la.perpendiculaire EF
pourra exprimer l’énergie de l’eau ; or fi l’on prend fa prolongée
E l , pour la hauteur d’où il faudrait qu’un corps tombât
pour acquérir une vîtefle égale & uniforme à celle du fleuve,
elle en marquera la force, Ainfi faifant EG égal à E l, enfuite le
parallélogramme E FH G , la diagonale EH exprimera la force
avec laquelle le fleuve agira fu r les parties du fo n d pour les détacher
, puifque félon notre fuppofition fa profondeur eft la
même par-tout, ainfi que fa ténacité. Mais s’il y avoit des endroits
plus bas ou plus hauts que le niveau du fond, où l’eau
fans perdre de fa vîteffe eût plus ou moins d’énergie , il eft naturel
que fes effets répondent à ces différences, qui auront auffi
lieu quand la ténacité fera plus ou moins grande en un endroit
qu’en l’autre , comme .nous l’expliquerons plus particuliérement
pilleurs.. 987.
987. A l’égard de l’impreffion du courant contre les berges ,
elle ne fera point, à ténacité égale, auffi forte à beaucoup près
que fur le fon d , d’autant moins que ces berges feront plus ef-
carpées, & qu’on les confidérera aux endroits de leurs furfaces
qui feront plus éloignées du fond, parce que l’énergie de l’eau
fur un plan incliné à l’horifon ,.ya en diminuant félon l’ordre
des termes d’une progreffion arithmétique infinie; auffi en attribuant
la même vîteffe à toutes les lames d’eau , à quelque profondeur
qu’on voudra les prendre, fa force moyenne fu r cettefur-
ftç e fera exprimée par la moitié de la diagonale répondant à la
plus grande profondeur.
988. II fuit de là que moins les berges auront de talud &
moins elles fe reffentiront de l’impreffion du courant ; de forte
que fi elles étoient prefque verticales, comme font les revê-
temens des quais , il ne ferait guere queftion que de la fimple
pouffée de l’eau, de même que fi elle étoit dormante , parce
que le courant, leur étant parallèle, n’exercera que peu fa vîteffe:
ainfi les berges, dont la furface intérieure eft inclinée ,n efe reflen-
tent de la vîtefle du fleuve que par ce q d elles ont dhorifontal, ce
qui fera toujours exprimé parla ligne qui marque leur talud. Delà
vient que les rives droites fe confervent en affezr bon état,
quelque violent que ce foit le cours de l’eau, à moins que des
caufes particulières n’en occafiùnnent la ruine : ce qui arrive
toujours plutôt vers le pied qu’au-deffus, parce quel’eàuya plus
d’énergie, fans parler des obftacles caufes par les corps étrangers
, aépofés au pied plutôt que fur leur talud, qui donnent
lieu à des affotiillemens,
989. Il y a donç trois .caufes principales qui concourent à
établir le lit des fleuves ; Ja première la qualité des matières dont
le fond & les rives font compofés, car il eft évident que les
terres fablonneufes céderont plus facilement à la force de l’eau
que celles de craie, & celles-ci plus que la pierre ou le tuf : la
fécondé vient de la fituation du lit ; car plus il aura de pente,
plus le même volume d’eau aura dé force pour le creùier : la
troifiemè, qui eft la principale, vient de la profondeur de l’eau,
puifque plus elle fera grande, plus elle aura de quantité de mouvement
pour corroder le fond.
990. Il eft à remarquer que dans un fleuvè uniformément
dirigé, dont le fond eft homogène , mais fufceptible d’être entamé
, l’eau doit le çreufer davantage dans le milieu que vers
les rives ,-fur-tout fi ce fleuve n’a que peu de largeur, le frot-
Partie I I . Tome I I . N n
L ’aSîion de
l’eau a moins
de prife contre
les berges que
fur le fond du
lit,
Les berges'
droites ne fe
reffentent de
la vUeJJed’un
fleuve que par
ce qu'elles ont
d'horifontal ,
ce qui eft toujours
exprimé
par la ligne
qui en marque,
le talud.
Trois caufes
principales
concourent à
établir le lit
des fleuves ;
la qualité du
fond,fa pente,
& la profon-
\ deur ou l’éner*
gie de Veau.
Les fleuves
régulièrement
dirigés s'ap-
profondijfent
davantage
dans le milieu