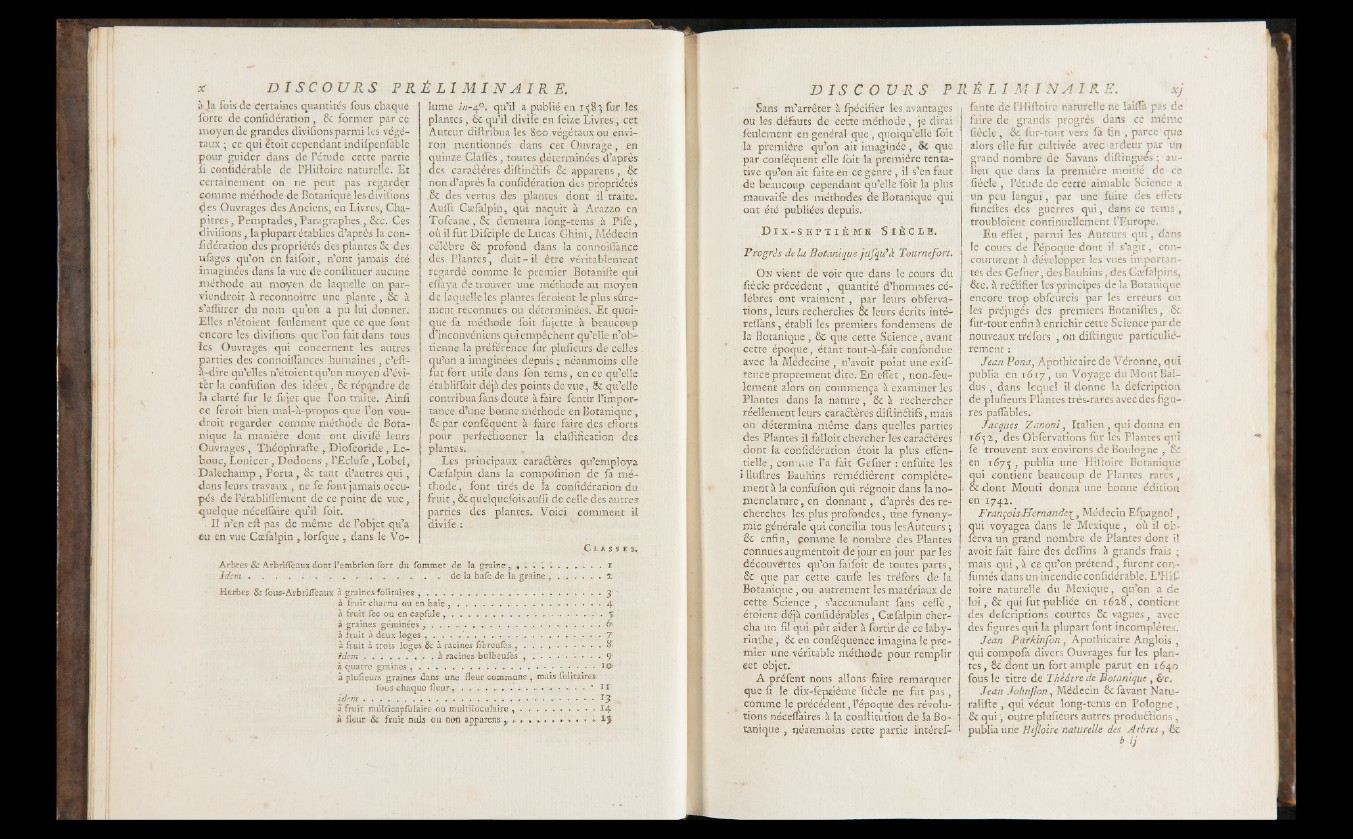
à .la fois de certaines quantités fous chaque
forte de confidération , & former par ce
moyen de grandes divifions parmi les végétaux
; ce qui ëtoit cependant indilpenfable
pour guider dans de l’étude cette partie
fi confidérable de l’Hiftoire naturelle. Et
certainement on ne peut pas regarder
comme méthode de Botanique les divifions
des Ouvrages des Anciens, en Livres, Chapitres,
P emptades, Paragraphes.r 8cc. Ces
divifions, la plupart établies d’après la confidération
des propriétés des plantes & des
ufages qu’on en faifoit, n’ont jamais été
imaginées dans la vue de conftituer aucune
méthode au moyen de laquelle on par-
viendroit à reconnoître une plante , & à
s’aiïurer du nom qu’on a pu lui donner.
Elles n’étoient feulement que ce que font
encore les divifions que l’on fait dans tous
les Ouvrages qui concernent les autres
parties des connoiffarïces humaines, c’eft-
S-dire qu’elles n’étoient qu’un moyen d’éviter
la confufion des idées, & répandre de
la clarté fur le fujet que l’on traite. Ainfi
ce feroit bien mal-à-propos que l’on vou-
droit regarder comme méthode de Botanique
la manière dont ont divifé leurs
Ouvrages , Théophrafte , Diofcoride , Le-
bouc, Lonicer, Dodoens, l’Eclufe, Lobel,
Dalechamp , Porta, & tant d’autres q u i,
dans leurs travaux , ne fe font jamais occupés
de l’ établiffement de ce point de vue,
quelque nécefiaire qu’il foit.
Il n’en eft pas de même de l’objet qu’a
eu en vue Cæfalpin , Iorfque , dans le Volume
qu’il a publié en 1383 fur les
plantes, & qu’il divife en feize Livres, cet
Auteur diftribua les 800 végétaux ou environ
mentionnés dans cet Ouvrage, en
quinze Claffes, toutes déterminées, d’après
des caraâères d.iftinôtifs & apparent, 6e
non d’après la confidération des propriétés
.& des vertus des plantes dont il traite.
Auffi Cæfalpin, qui naquit à Arazzo en
Tofcane , & demeura .long-tems à Pife,
où il fut Difciple de Lucas Ghini, Médecin
célèbre 8e profond dans la connoiflànce
des Plantes, doit - il être véritablement
regardé comme le premier Botanifte qui
eflàya de trouver une méthode, au moyen
de laquelle les plantes feroient le plus sûrement
reconnues ou déterminées. E t quoique
fa méthode foit fujette. à beaucoup
d’inconvéniens qui empêchent qu’elle n’obtienne
la préférence fur plufieurs de celles
qu’on a imaginées depuis ; néanmoins elle
fut fort utile dans Ion tems, en ce qu’elle
établiffoit déjà des points de vue, 8c qu’elle
contribua fans doute à faire fentir l’importance.
d’une bonne méthode en Botanique,
8c par conféquent à faire faire des efforts
pour perfeâionner la claffification des
plantes.
Les principaux caraâères qu’employa
Cæfalpin dans la compofition de fa méthode
, font tirés de la confidération dit
fruit, 8c quelquefois auffi de celle des autres
parties des plantes. Voici comment iî
divife ;
C l a s s e s .
Arbres & Arbrifteaux dont l’embrîcm fort du ionrmet de la graine. . . . . . . . . . . r
Idem............................. .... '.. . . .. . . . de la bafe .de la graine . . £.
Herbes. & feus-Aïbrideaux à graines folitaires , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
à fruit charnu ou en baie , . . .................................... .................4.
à fruit fec ou en capfule ,. . . . . .- . . . . . . . . - . . . .. . %
à graines-géminées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
à fruit à deux loges , . . . . ’ . . .................................... . . . . 7'
à fruit à trois loges & à racines f i b r e u f è s . 8:
rdcm . . . , . . . . .. à racines bulbeufès . . . . . . . . . . 9’
à quatre graines , . . . . . . . .. ................................ ■ • • 1er
à plufieurs graines dans une fleur commune-, mais folitaires.
fous chaque fleur r . . . . . . . . . . . . . . . • . . . ■ i r
idem . . , . . . ., . . . . . , .- . . , - . . • . . . IJa
fruit mùlticapfufaire ou multiloculaire r . . . . . . . . . . . 14.
à fleur & fruit nuis ou non ar parent, . . . . . . . . . . . . i f
Sans m’arrêter à fpécifier les, avantages
Ou les défauts de cette méthode, je dirai
feulement en général que, quoiqu’elle foit
la première qu’on ait imaginée, & que
par conféquent elle foit la première tentative
qu’on ait faite en ce genre, il s’en faut
de beaucoup cependant qu’elle foit la plus
mauvaife des méthodes de Botanique qui
ont été publiées depuis.
D i x - s e p t i ê m b S i è c l e .
Progrès de la Botanique jufquèèt Tournefort.
On vient dé voir que' dans le cours du
ftècle précédent , quantité d’hommes célèbres
ont vraiment, par leurs obfêrva-
tions, leurs recherches oc leurs écrits inté-
reffans, établi les premiers fondemens de
la Botanique , 8c que cette Science, avant
cette époque, étant tout-à-fait confondue
avec la Médecine , n’avoit point une -existence
proprement dite. En effet, non-fêu-
lernent alors on commença à examiner les
Plantes dans la nature -, 8c à rechercher
réellement leurs caraâères diftinâifs, mais
on détermina même dans quelles parties
des Plantes il falloit chercher les caraâères
dont la confidération étoit la plus eflèn-
tielle, comme l’a fait Gefner : enfuite les
i Uuftres Bauhins remédièrent complètement
à la confufion qui régnoit dans la nomenclature
, en donnant, d’après des recherches
les plus profondes, une fynony-
mie générale qui concilia tous lesAuteurs ;
8c enfin, comme le nombre des Plantes
connues augmentoit de jour en jour parlés
découvertes qu’on faifoit de toutes parts,
8c que par cette caufe les tréfors de la
Botanique, ou autrement les matériaux de
cette Science , s’accumulant fans ceffe ,
étoient déjà confidérables, Cæfalpin chercha
un fil qui pût aider à fortir de ce labyrinthe
, 8c en conféquence imagina le premier
une véritable méthode pour remplir
eet objet.
A préfent nous allons faire remarquer
que fi le dix-feptièmeTiède ne fut pas,
comme le précédent, l’époque des révolutions
néceffaires à la conftitution de la Botanique
, néanmoins cette partie intéreffante
de l’Hiftoire naturelle ne laiflà pas de
faire de grands progrès dans ce même
fièclé , 8c fur-tout vers fa fin , parce que
alors elle fut cultivée avec ardeur par un
grand nombre de Savans diftingués ; au-
lieu' que dans la première moitié de ce
fiècle , l’étude de cette aimable Science a
■ un peu langui, par une fuite des effets
funeftes des guerres qui, dans ce tems ,
troubloient continuellement l’Europe.
En effet, parmi les Auteurs q u i, dans
le cours de l’époque dont iî s’a g it, concoururent
à développer les vues importantes
des Gefner , des Bauhins , des Cæfalpins,
8tc. à reâifier les principes de la Botanique
encore trop obfcurcis par les erreurs où
les préjugés des premiers Botaniftes, 8c
fur-tout enfin à enrichir cette Science par de
nouveaux tréfors , on diftingue particuliérement
:
Jean Pona, Apothicaire de Véronne, qui
publia en 16 17 , un Voyage duMontBal-
d us, dans lequel il donne la defeription
de plufieurs Plantes très-rares avec des fi gu- •
res paflàbles.
Jacques Zanonî, Italien , qui donna en
idhjz, des Obfervations fur les Plantes qui
fe trouvent aux environs de Boulogne , &
en 16y< , publia une Hiftoire Botanique
qui contient beaucoup de Plantes rares ,
8c dont Mouti donna une bonne édition
en 1742.
François Hcrnandeç_, Médecin Efpagno!,
qui voyagea dans le Mexique, où il ob-
ferva un grand nombre de Plantes dont il
avoit fait faire des deffins à grands frais ;
mais q u i, à ce qu’on prétend, furent confit
niés dans un incendie confidérable, L’H if
toire naturelle du Mexique, qu’on a de
lu i, 8c qui fut publiée en 1628, contient
des defcriptioHs courtes 8c vagues, avec
des figures qui la plupart font incomplètes.
Jean Parkinjon , Apothicaire Anglois ,
qui compofa divers Ouvrages fur les plantes
, & dont un fort ample parut en 1640
fous le titre de Théâtre de Botanique, &c.
Jean Johnjion, Médecin 8c favant Natu-
ralifte , qui vécut long-tems en Pologne,
8c q u i, outre plufieurs autres produâions,
publia une Hijloire naturelle des Arbres, 6c
b ij