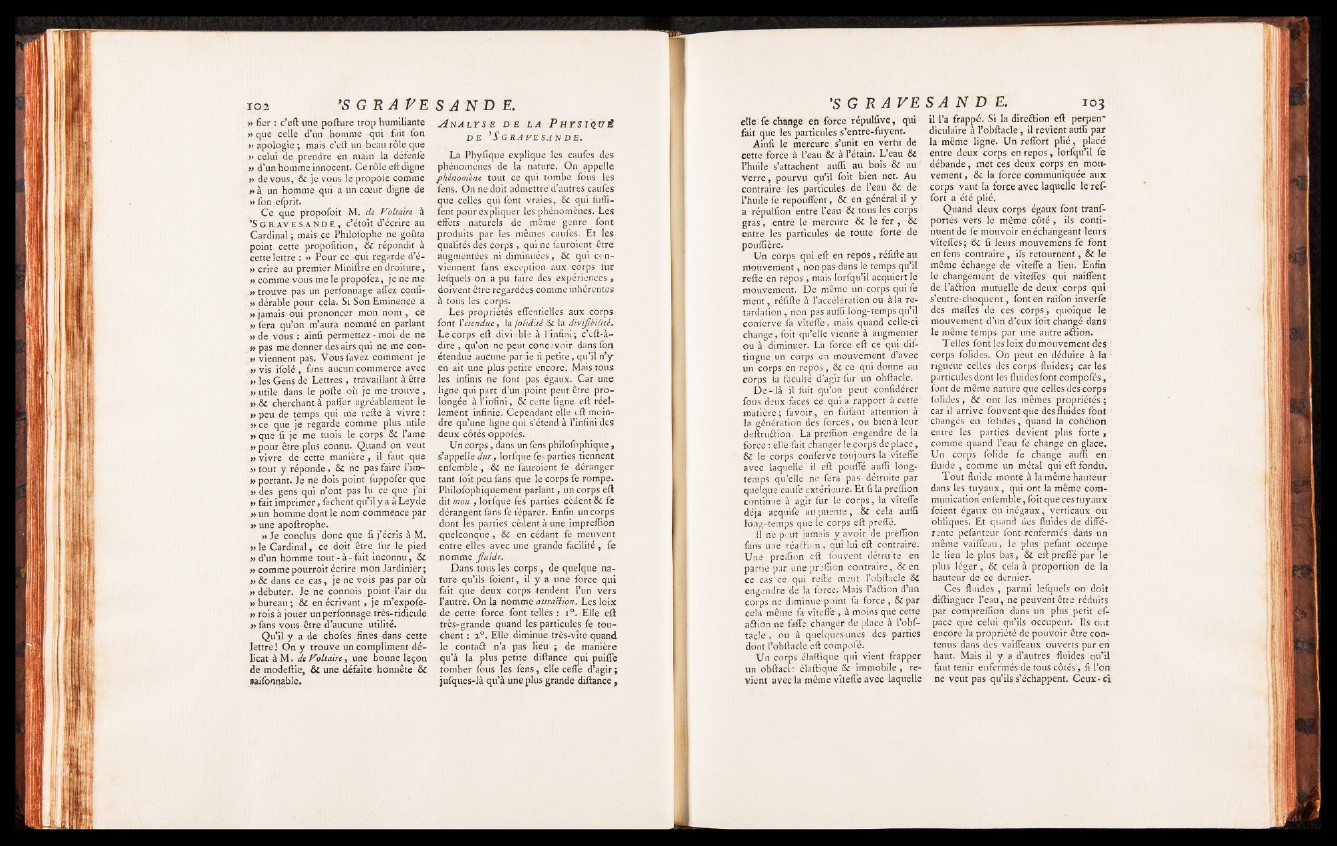
lo i ‘S GRA VE
» fier : c’eft une pofture trop humiliante
» que celle d’im homme qui fait fon
» apologie ; mais c'clt un beau rôle que
» celui de prendre en main la défenle
» d’un homme innocent. Ce rôle eft digne
» de vous, & je vous ,le propofe comme
» à un homme qui a un coeur digne de
» fon efprit.
C e q u e p rop o foit M. de Voltaire
’S g r a v e s a n d e , c’ é to it d’éc r ire au
C a rd in a l ; mais ce Philofop he ne goûta
point ce tte p ro p o fitio n , & répondit à
ce tte lettre : » P o u r ce q ui regarde d’é -
» c r ire au premier Miniftre en d ro itu re ,
» comme v o u s me le propofez , je ne me
» t ro u v e pas un perfonnage a lle z confi-
» dérable pour ce la . Si Son Eminence a
» jamais o u i pron on ce r mon nom , c e
» fera qu’on m’aura nommé en parlant
» de v o u s : ainfi permettez - moi de ne
» pas me donner des airs q ui ne me con-
» viennent pas. V o u s fa v e z comment je
» v is ifo lé , fans aucun comme rce a v e c
» les G en s de L e t t r e s , travaillant à être
» utile dans le p o lie o h je me t r o u v e ,
» & cherchant à pa lie r agréablement le
» peu de temps qui me re lie à v iv r e :
» c e que je regarde, com m e plus u tile
» qu e li je me tuais le corps & l’ame
» pour ê tre plus connu. Quand on v eu t
» v iv r e de ce tte m an iè r e , il faut que
» tou t y r é p o n d e , &C ne pas faire l ’irn-
» portant. Je ne dois point fuppofer que
. » des gens q u i n’ ont pas lu ce que j’ai
» fait im p rim e r , fâchent qu’i l y a à L e y d e
» u n homme dont le nom commence par
» une apoftrophe.
»Je conclus donc que fi j’écris à M.
» le Cardinal, ce doit être fur le pied
» d’un homme tout - à - fait inconnu, &
» commepourroit écrire mon Jardinier;
» & dans ce cas, je ne vois pas par oh
» débuter. Je ne connois point l’air du
»bureau; & en écrivant, je m’expofe-
» rois à jouer un perfonnage très-ridicule
» fans vous être d’aucune utilité.
Qu’il y a de chofes fines dans cette
lettre ! On y trouve un compliment délicat
à M. de Voltaire, une bonne leçon
de modellie, & une défaite honnête &
laifonoable.
S AND E.
A na l y s e d e la P hy s iqu ê
D E ’ S g R A V E S A N D E .
La Phyfique explique les caufes des
phénomènes de la nature. On appelle
phénomène tout ce qui tombe fous les
fens. On ne doit admettre d’autres caufes
que celles qui font vraies, & qui fuffi-
fent pour expliquer les phénomènes. Les
effets naturels de même genre font
produits par les mêmes caufes. Et les
qualités des corps , qui ne fauroient être
augmentées ni diminuées, & qui conviennent
fans exception aux corps fur
lefquels on a pu faire des expériences ,
doivent être regardées comme inhérentes
à tous les corps.
Les propriétés effentielles aux corps
font l’étendue , la folidité 6c la divifibilité.
Le corps eft divisible à l’infini; c’eft-à-
dire , qu’on ne peut concevoir dans fon
étendue aucune pariie fi petite, qu’il n’y
en ait une plus petite encore. Mais tous
les infinis ne font pas égaux. Car une
ligne qui part d’un point peut être prolongée
à l’infini, & cette ligne eft réellement
infinie. Cependant elle eft moindre
qu’une ligne qui s’étend à l’infini des
deux côtés oppofés.
Un corps, dans un fens philofophique,
s’appelle dur, lorfque fes parties tiennent
enfemble , & ne fauroient fe déranger
tant foit peu fans que le corps fe rompe.
Philofophiquement parlant, un corps eft
dit mou , lorfque fes parties cèdent & fe
dérangent fans fe féparer. Enfin un corps
dont les parties cèdent à une imprefîion
quelconque, & en cédant fe meuvent
entre elles avec une grande facilité , fe
nomme fluide.
Dans tous les corps , de quelque nature
qu’ils foient, il y a une force qui
fait que deux corps -tendent l’un vers
l’autre. On la nomme attraction. Les loix
de cette force font telles : i°. Elle eft
très-grande quand les particules fe touchent
: 2°. Elle diminue très-vîte quand
le contaft n’a pas lieu ; de manière
qu’à la plus petite diftance qui puiffe
tomber fous les fens, elle ceffe d’agir ;
jufques-là qu’à une plus grande diftance,
’S G R AVE
etle fe change eh force répulfive, qui
fait que les particules s’entre-fuyent.
Ainfi le mercure s’unit en vertu de
cette force à l’eau & à l’étain. L’eau 8c
l’huile s’attachent auffi au bois & au
v e rre , pourvu qu’il foit bien net. Au
contraire les particules de l’eau & de
l’huile fe repouffent, 8c en general il y
a répulfion entre l’eau 8c tous les corps
gras, entre le mercure 8c le f e r , 8c
entre les particules de toute forte de
pouffière.
Un corps qui eft en repos, réfifte au
mouvement, non pas dans le temps qu’il
refte en repos, mais lorfqu’il acquiert le
mouvement. D e même un'corps qui fe
m eut, réfifte à l’aaêélération ou à la retardation
, non pas aufîi long-temps qu’il
conferve • fa vîteffe, mais quand celle-ci
change, foit qu’elle vienne à augmenter,
ou à diminuer. La force eft' ce qui dif-
tingue un corps on mouvement d’avec
un corps en repos, 8c ce qui donne au
corps la faculté d’agir fur un obftacle.
D e - là il fuit qu’on peut confidérer
fous deux faces ce qui a rapport à cette
matière; fa voir, en faifant attention à
là génération des forces, ou bien à leur
deftruâion. La préffion engendré de la
force : elle fait changer le corps de place,
8c le corps conferve toujours là vîteffe
avec laquelle il eft pouffé auffi longtemps
qu’elle ne fera pas détruite par
quelque caufe extérieure. Et fi la préffion
continue à agir fur le corps, la vîteffe
déjà acquife augmente,' 8c cela auffi
long-temps que le corpS eft preffé.
H ne peut jamais y avoir de préffion
fans une réa&ion , qui lui eft contraire.
Une préffion eft fouvent détru'te en
partie par une préffion contraire, 8c en
ce cas ce qui refte meut l’obftacle 8c
engendre de la force. Mais l’aftiôn d’un
corps ne diminue point fa force , 8c par
cela même fa vîteffe , à moins que cette
aftion ne faffe changer de place à l’obf-
tâcle , ou à quelques-unes des parties
dont l’obftacle eft compofé.
Un corps diadique qui vient frapper
un obftacle élaftique & immobile, revient
avec la même vîteffe avec laquelle
SA N D E. 103
il l’a frappé. Si la direction eft perpen"
diculaire à l’obftacle, il revient auffi par
la même ligne. Un reffort plié, placé
entre deux corps en repos, lorfqu’il fe
débande, met ces deux corps en mouvement
, ÔC la force communiquée aux
corps vaut la force avec laquelle le reffort
a été plié.
Quand deux corps égaux font tranf-
portés vers le même cô té , ils continuent
de fe mouvoir en échangeant leurs
vîteffes ; & fi leurs mouvemens fe font
en fens contraire, ils retournent, & le
même échange de vîteffe a lieu. Enfin
le changement de vîteffes qui naiffent
de l’a&ion mutuelle de deux corps qui
s’entre-choquent, font en raifon inverfe
des maffes de ces corps, quoique le
mouvement d’un d’eux foit changé dans
le même temps par une autre aâion.
Telles font les loix du mouvement des ’
corps folides. On peut en déduire à la
rigueur celles des corps fluides ; car les
particules dont les fluides font compofés,
font de même nature que celles des corps
folides, & ont les mêmes propriétés ;
car il arrive fouvent que des fluides font
changés en folides, quand la cohéfion
entre les parties devient plus forte >
comme quand l’eau fe change en glace.
Un corps folide fe change auffi en
fluide , comme un métal qui eft fondu.
Tout fluide monte à la même hauteur r
dans les tuyaux, qui ont la même communication
enfemble, foit que ces tuyaux
foient égaux ou inégaux, verticaux ou
obliques. Et quand des fluides de différente
pefanteur font renfermés dans un
même vaiffeau, le plus pefant occupe
le lieu le plus bas, & eft preffé par le
plus léger, & cela à proportion de la
hauteur de ce dernier.
Ces fluides , parmi lefquels on doit
diftinguer l’eau, ne peuvent être réduits
par compréffion dans un plus petit ef-
pace que celui qu’ils occupent. Ils ont
encore la propriété de pouvoir être contenus
dans des vaiffeaux ouverts par en
haut. Mais il y a d’autres fluides qu’il
faut tenir enfermés de tous côtés, li l’on
ne veut pas qu’ils s’échappent. C eux-ci