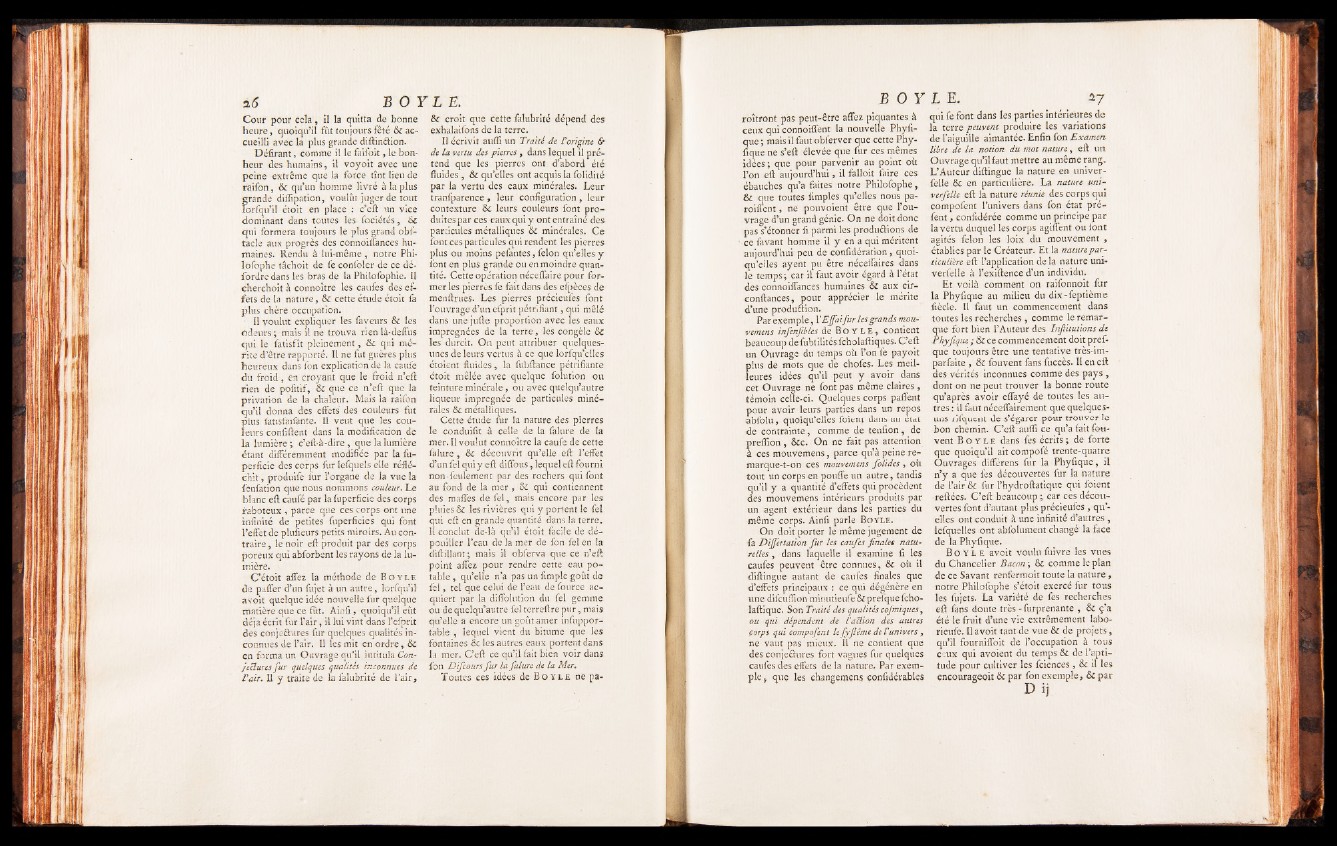
Cour pour cela, il la quitta de bonne
heure, quoiqu’il fut toujours fêté 6c accueilli
avec la plus grande diftin&ion.
D élirant, comme il le faifoit, le bonheur
des humains, il voyoit avec une
peine extrême que la force tînt lieu de
raifon, & qu’un homme livré à la plus
grande diflîpation, voulût juger de tout
lorfqu’il étoit en place : c’eft un vice
dominant dans toutes les fociétés, 6c
qui formera toujours le plus grand obf-
tacle aux progrès des connoiffances humaines.
Rendu à lui-même , notre Phi-
lofophe tâchoit de fe confoler de ce dé-
fordre dans les bras de la Philofophie. Il
cherchoit à connoître les caufes des effets
de la nature, 6c cette étude étoit fa
plus chère occupation.
Il voulut expliquer les faveurs 6c les
odeurs ; mais il ne trouva rien là-deffus
qui le fatisfît pleinement, 6c qui mérite
d’être rapporté. Il ne fut guères plus
heureux dans fon explication de la caufe
du froid, en croyant que le froid n’eft
rien de pofitif, 6c que ce n’eft que la
privation de la chaleur. Mais la raifon
qu’il donna des effets des couleurs fut
plus fatisfaifante. Il veut que les couleurs
confident dans la modification de
la lumière ; c’effà-dire , que la lumière
étant différemment modifiée par la fu-
perficie des corps fur lefquels elle réfléchit
, produife lur l’organe de la vue la
fenfation que nous nommons couleur. Le
blanc eft caufé par la fuperfide des corps
raboteux , parce que ces corps ont une
infinité de petites fuperficies qui font
l’effet de plusieurs petits miroirs. Au contraire
, le noir eft produit par des corps
poreux qui abforbent les rayons de la lumière.
C’étoit affez la méthode de B o y l e
de paffer d’un fujet à un autre, lorfqu’il
avoit quelque idée nouvelle fur quelque
matière que ce fut. Ain fi, quoiqu’il eût
déjà écrit fur l’a ir, il lui vint dans l’efprit
des conje&ures fur quelques qualités inconnues
de l’air. Il les mit en ordre, 6c
çn forma un Ouvrage qu’il intitula Conjectures
fur quelques qualités inconnues de
Voir. Il y traite de la falubrité de l’air,
6c croit que cette falubrité dépend des
exhalaifons de la terre.
Il écrivit aufli un Traité de Vorigine &
de la vertu des pierres, dans lequel il prétend
que les pierres ont d’abord été
fluides , & qu’elles ont acquis la folidité
par la vertu des eaux minérales. Leur
tranfparence , leur configuration, leur
contexture 6c leurs couleurs font produites
par ces eaux qui y ont entraîné des
particules métalliques 6c minérales. Ce
font ces particules qui rendent les pierres
plus ou moins pefantes, félon qu’elles y
font en plus grande ou en moindre quantité.
Cette opération néceffaire pour former
les pierres fe fait dans des efpèces de
menftrues. Les pierres précieufes font
l’ouvrage d’un efprit pétrifiant, qui mêlé
dans une jufte proportion avec les eaux
imprégnées de la terre, les congèle 6c
les durcit. On peut attribuer quelques-
unes de leurs vertus à ce que lorfqu’clles
étoient fluides, la fubftance pétrifiante
étoit mêlée avec quelque folution ou
teinture minérale, ou avec quelqu’autre
liqueur imprégnée de particules minérales
& métalliques.
Cette étude fur la nature des pierres
le conduifit à celle de la falure de la
mer. Il voulut connoître la caufe de cette
falure, 6c découvrit qu’elle eft l’effet
d’un fel qui y eft diffous, lequel eft fourni
non-feulement par des rochers qui font
au fond de la mer , 6c qui contiennent
des maffes de fel, mais encore par les
pluies 6c les rivières qui y portent le fel
qui eft en grande quantité dans la terre.
H conclut de-là qu’il étoit facile de dépouiller
l’eau de la mer de fon fel en la
diftillant; mais il obferva que ce n’eft
point affez pour rendre cette eau potable
, qu’elle n’a pas un fimple goût de
fel, tel que celui de l’eau de fource acquiert
par la diffolution du fel gemme
ou de quelqu’autre fel terreft re pu r, mais
qu’elle a encore un goût amer infuppor-
table , lequel vient du bitume que les
fontaines 6c les autres eaux portent dans
la mer. C’eft ce qu’il fait bien voir dans
fon Difcours fur la falure de la Mer.
Toutes ces idées de B o y l e ne paroîtront
pas peut-être affez piquantes à
ceux qui connoiffent la nouvelle Physique
; mais il faut obferver que cette Phy-
fique ne s’eft élevée que fur ces mêmes
idées ; que pour parvenir au point où
l’on eft aujourd’h u i, il falloit faire ces
ébauches qu’a faites notre Philofophe,
& que toutes limples qu’elles nous pa-
roiflent, ne pouvoient être que l’ouvrage
d’un grand génie. On ne doit donc
pas s’étonner fi parmi les productions de
ce favant homme il y en a qui méritent
aujourd’hui peu de confidération, quoiqu’elles
ayent pu être néceffaires dans
le temps; car il faut avoir égard à l’état
des connoilfances humaines & aux cir-
conftances, pour apprécier le mérite
d’une production.
Par exemple, XEffaifur Us grands mou-
vemens infenfibles de Bo y l e , contient
beaucoup de fubtilités fcholaftiques. C’eft
un Ouvrage du temps où l’on fe payoit
plus de mots que de chofes. Les meilleures
idées qu’il peut y avoir dans
cet Ouvrage ne font pas même claires,
témoin celle-ci. Quelques corps paffent
pour avoir leurs parties dans un repos
abfolu, quoiqu’elles foicnt dans un état
de contrainte, comme de tenfion, de
preffion, &c. On ne fait pas attention
à ces mouvemens, parce qifà peine remarque
t-on ces mouvemens folides, ou
tout un corps en pouffe un autre, tandis
qu’il y a quantité d’effets qui procèdent
des mouvemens intérieurs produits par
un agent extérieur dans les parties du
même corps. Ainfi parle Boyle.
On doit porter le même jugement de
fa Dijfertation fur Us caufes finales natu-
relies, dans laquelle il examine fi les
caufes peuvent être connues, & où il
diftingue autant de caufes finales que
d’effets principaux : ce qui dégénère en
une difcufiion mirmtieufe & prefque fcho-
laftique. Son Traité des qualités cofmïques,
ou qui dépendent de Vaclion des autres
corps qui compofent le fylléme de Vunivers,
ne vaut pas mieux. Il ne contient que
des conjectures fort vagues fur quelques
caufes des effets de la nature. Par exemple,
quç les changement çonfidérables
qui fe font dans les parties intérieures de
la terre peuvent produire les variations
de l'aiguille aimantée. Enfin fon Examen
libre de la notion du mot nature, eft un
Ouvrage qu’il faut mettre au même rang.
L’Auteur diftingue la nature en univer-
felle 6c en particulière. La nature uni-
verfelle eft la nature réunie des corps qui
compofent l’univers dans fon état pré-
fent, confidérée comme un principe par
la vertu duquel les corps agiflènt ou font
agités félon les loix du mouvement ,
établies par le Créateur. Et la nature particulière
eft l’application de la nature uni-
verfelle à l’exiftence d’un individu.
Et voilà comment on raifonnoit fur
la Phyfique au milieu du dix-feptième
fiècle. Il faut un commencement dans
toutes les recherches , comme le remarque
fort bien l’Auteur des Injlitutions de
Phyjîque ; 6c ce commencement doit prefque
toujours être une tentative très-imparfaite
, 6c fouvent fans fuccès. II en eft
des vérités inconnues comme des pays ,
dont on ne peut trouver la bonne route
qu’après avoir effayé de toutes les autres
: il faut néceffairement que quelques-
uns rifquent de s’égarer pour trouver le
bon chemin. C’eft aufli ce qu’a fait fou-
vent B o y l e dans fes écrits ; de forte
que quoiqu’il ait compofé trente-quatre
Ouvrages différens fur la Phyfique, il
n’y a que fes découvertes fur la nature
de l’air 6c fur l’hydroftatique qui foient
reftées. C’eft beaucoup ; car ces découvertes
font d’autant plus précieufes , q u elles
ont conduit à une infinité d’autres ,
lefquelles ont abfolument changé la face
de la Phyfique.
Bo y l e avoit voulu fuivre les vues
du Chancelier Bacon ; 6c comme le plan
de ce Savant renfermoit toute la nature,
notre Philofophe s’étoit exercé fur tous
les fujets. La variété de fes recherches
eft fans doute très - furprenante , 6c ç’a
été le fruit d’une vie extrêmement labo-
rieufe. Il avoit tant de vue & de projets,
qu’il fourniffoit de l’occupation à tous
c:ux qui avoient du temps 6c de l’aptitude
pour cultiver les fciences , 6c il les
encourageoit 6c par fon exemple, 6c par