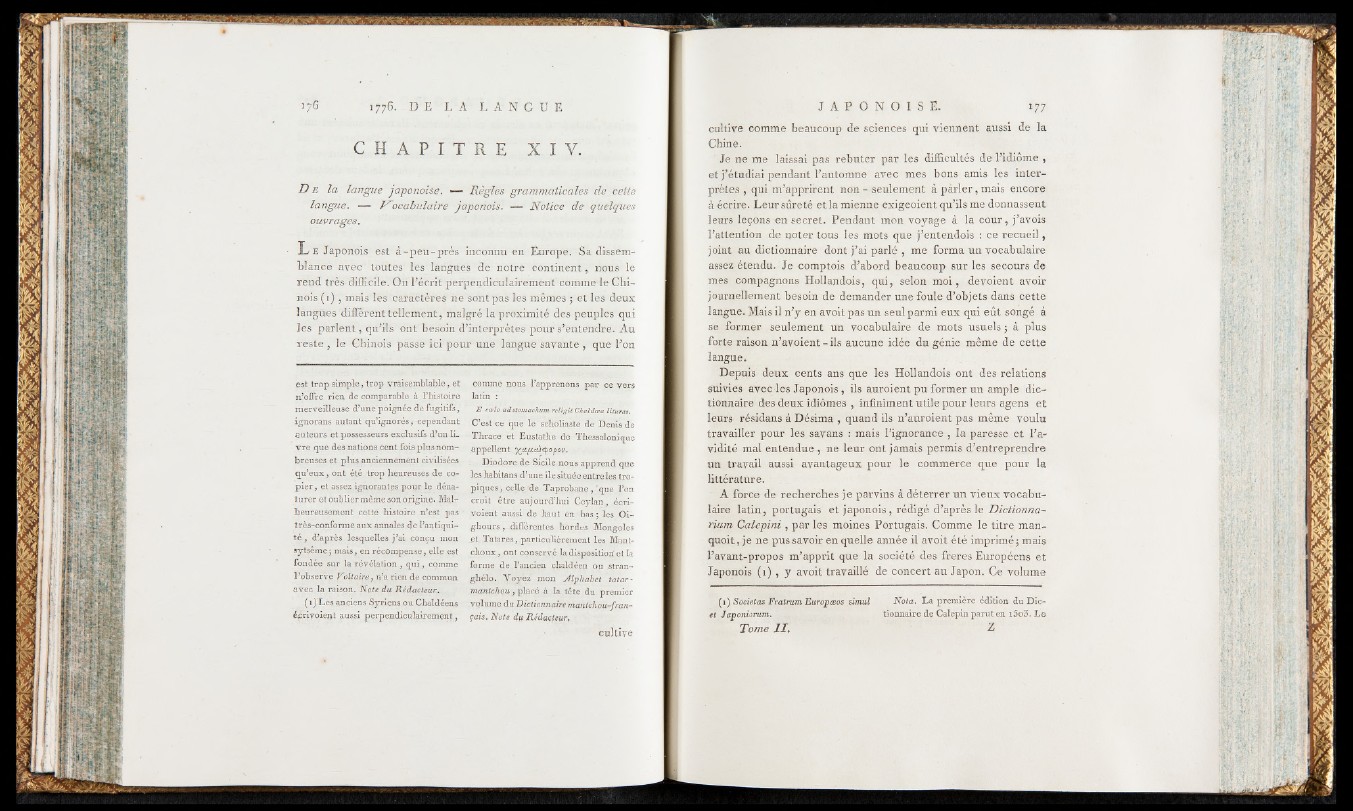
176
C H A P I T R E XI V.
D e la langue japonaise. — Règles grammaticales de cette
langue. — V~ocabulaire japonais. — Notice de quelques
ouvrages.
L e Japonois est à-peu-près inconnu en Europe. Sa dissemblance
avec toutes les langues de notre continent, nous le
rend très-difficile. On l’écrit perpendiculairement comme le Chinois
(1) , mais les caractères ne sont pas les mêmes 5 et les deux
langues diffèrent tellement, malgré la proximité des peuples qui
les parlent, qu’ils ont besoin d’interprètes pour s’entendre. Au
reste , le Chinois passe ici pour une langue savante , que l’on
est trop simple, trop vraisemblable, et
n’offre rien de comparable à l ’histoire
merveilleuse d’une poignée de fugitifs,
ignorans autant qu’ignorés,- cependant
auteurs et possesseurs exclusifs d’un livre
que des nations cent fois plus nombreuses
et plus anciennement civilisées
qu’eux, ont été trop heureuses de cop
ier, et assez ignorantes .pour le dénaturer
et oublier même son origine. Malheureusement
celte histoire n’est pas
très-conforme aux annales de l’antiquité
, d’après lesquelles j ’ai conçu mon
sytsême; mais, en récompense, elle est
fondée sur la révélation , qui, comme
l ’observe V o l t a i r e , n’a rien de commun
avec la raison. N o t e d u R é d a c t e u r .
(1) Les anciens Syriens ou Chaldéen.s
é.cri voient aussi perpendiculairement,
comme nous l ’apprenons par ce vers
latin :
E c.oelo ad stomachum religit Chaldoea lituras.
C’est ce que le scholiaste de Denis de
Thrace et Eustathe de Thessalonique
appellent j^cc/xcùcpopov.
Diodore de Sicile nous apprend que
leshabitans d’une île située entre les tropiques
, celle de Taprobane, "que l’on
croit être aujourd’hui Ceylan, écri-
voient aussi de haut en bas ; les Oi-
ghours, différentes hordes Mongoles
et Tatares, particulièrement les Mant-
choux, ont conservé la disposition et la
forme de l’ancien chaldéen ou stran-
ghélo. Yoyèz mon A l p h a b e t ta ta r -
m a n t c h o u , placé à la tête du premier
volume du D i c t io n n a i r e m a n t c h o u - f r a n -
ç a i s . N o t e d u R é d a c t e u r ,
c u ltiv e
cultive comme beaucoup de sciences qui viennent aussi de la
Chine.
Je ne me laissai pas rebuter par les difficultés de l’idiome ,
et j’étudiai pendant l’automne avec mes bons amis les interprètes
, qui m’apprirent non - seulement à parler, mais encore
à écrire. Leur sûreté et la mienne exigeoient qu’ils me donnassent
leurs leçons en secret. Pendant mon voyage à la cour, j’avois
l’attention de noter tous les mots que j’entendois : ce recueil,
joint au dictionnaire dont j’ai parlé , me forma un vocabulaire
assez étendu. Je comptois d’abord beaucoup sur les secours de
mes compagnons Hollandois, qui, selon moi, dévoient avoir
journellement besoin de demander une foule d’objets dans cette
langue. Mais il n’y en avoit pas un seul parmi eux qui eût songé à
se former seulement un vocabulaire de mots usuels $ à plus
forte raison n’avoient - ils aucune idée du génie même de cette
langue.
Depuis deux cents ans que les Hollandois ont des relations
suivies avec les Japonois , ils auroient pu former un ample dictionnaire
des deux idiomes , infiniment utile pour leurs agens et
leurs résidans à Désima , quand ils n’auroient pas même voulu
travailler pour les savans : mais l’ignorance , la paresse et l’avidité
mal entendue , ne leur ont jamais permis d’entreprendre
un travail aussi avantageux pour le commerce que pour la
littérature.
A force de recherches je parvins à déterrer un vieux vocabulaire
latin, portugais et japonois, rédigé d’après le Dictionna-
rium Calepini , par les moines Portugais. Comme le titre man-
quoit, je ne pus savoir en quelle année il avoit été imprimé $ mais
l’avant-propos m’apprit que la société des freres Européens et
Japonois (1) , y avoit travaillé de concert au Japon. Ce volume 1
(1) Sôcietas Fratrum Ruropoeos simul N o t a . La première édition du Dic-
t i J a p o n io r um . tionnaire de Calepin parut en i 5o3. L e
Tome I I . Z