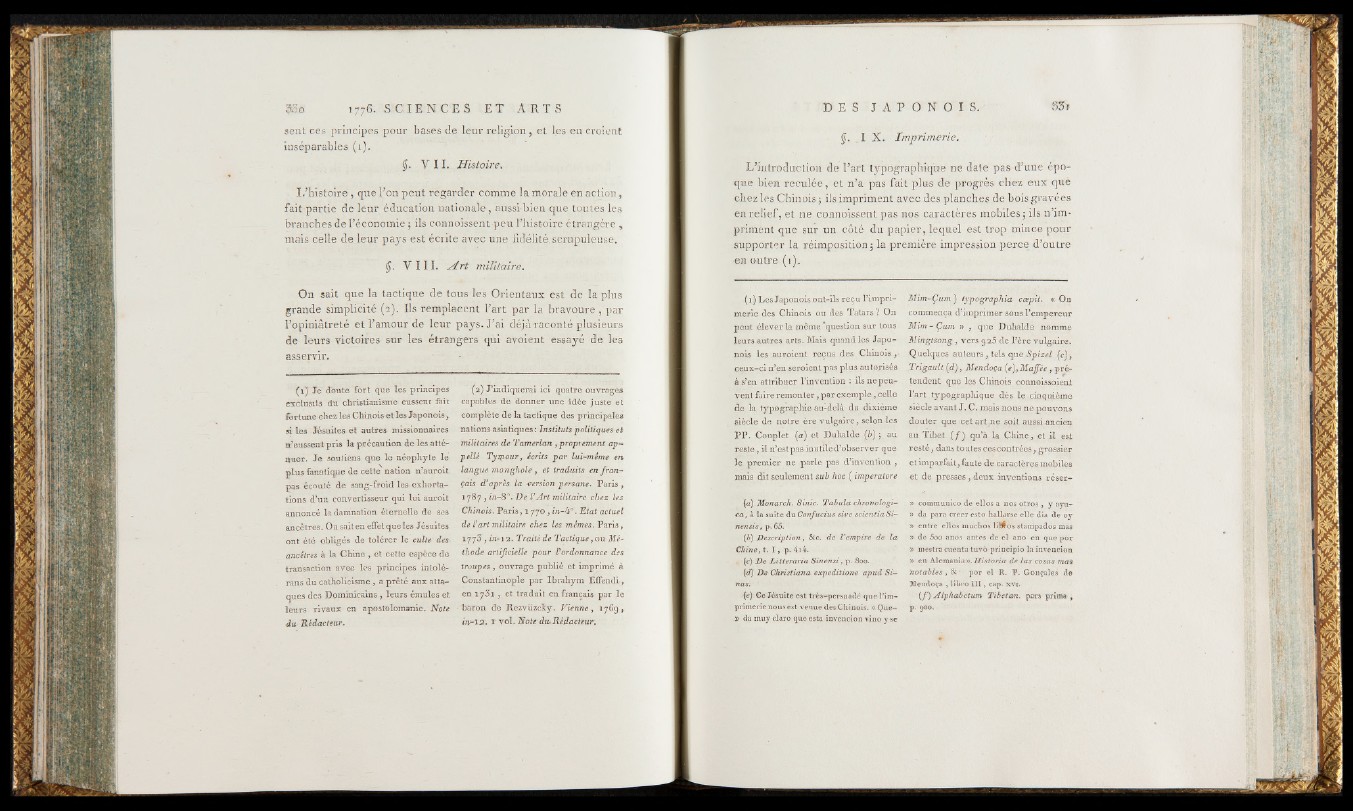
sent ces principes pour bases de leur religion, et les en croient
inséparables (1).
J. Y 11. Histoire.
I/histoire , que Ton peut regarder comme la morale en action,
fait partie de leur éducation nationale, aussi-bien que toutes les
branches dePéconomie 5 ils commissent peu Phist-oire étrangère ,
mais celle de leur pays est écrite avec une fidélité,scrupuleuse.
J. V I I I . ^4rt militaire.
On sait que la tactique de tous les Orientaux est de la plus
grande simplicité (2). Ils remplacent Part par la bravoure, par
Popiniâtreté et Pamour de leur pays.Pai déjà raconté plusieurs
de leurs victoires sur les étrangers qui avoient essayé de les
asservir.
(1) Je doute fort que les principes
exclusifs du christianisme- eussent fait
fortune chez les Chinois et les Japonois,
si les Jésuites et autres missionnaires
n?eussent pris la précaution de les atténuer.
Je soutiens que le néophyte le
plus fanatique de cette nation n’auroit
pas écouté de sang-froid les- exhortations
d’un convertisseur qui lui auroit
annoncé la damnation étemelle de ses
ancêtres. On sait en effet que les Jésuites
ont été obligés de tolérer le culte des
ancêtres à la Chine, et cette espèce de
transaction avec les principes in Loi é-
rans du catholicisme, a prêté aux attaques
des Dominicains , leurs émules et
leurs rivaux en aposfolomanie, Note
du Rédacteur.
(2) J’indiquerài ici quatre ouvrages
capables de donner une idée juste et
complète de la tactique des principales
nations asiatiques: Instituts politiques et
militaires de Tamerlan , proprement ap-
pellê Tyrpour, écrits par lui-même en
langue monghole , et traduits en fran-
çais d’après■ la version persane. Paris ,
1787, in-8°. De l’Art militaire chez les
Chinois. Paris, 1770, i/i-4°. Etat actuel
de Z’art militaire chez les mêmes. Paris,
17 73, inr\2. Traité de Tactique, ou Méthode
artificielle pour Vordonnance des
troupes, ouvrage publié et imprimé à
Constantinople par Ibrahym Effendi-,
en 1731, et traduit en français par le
baron de Rezviizclcy. Vienne, 17691
in-12. r vol. Note du*Rédacteur.
§. I X. Imprimerie.
L ’introduction de Part typographique ne date pas d’une époque
bien reculée, et n’a pas fait plus de progrès chez eux què
chez les Chinois 5 ils impriment avec des planches de bois gravées
en relief, et ne connoissent pas nos caractères mobiles 5 ils n’im*
priment que sur un côté du papier, lequel est trop mince pour
supporter la réimposition 5 la première impression perce d’outre
en outre (1).
(1) Les Japonois ont-ils reçu l ’imprimerie
des Chinois ou des Talars ? On
peut élever la même ’question sur tous
leurs autres arts. Mais quand les Japonais
les auroient reçus des Chinois ,•
ceux-ci n’en seroient pas plus autorisés
à s’en attribuer l ’invention : ils nepeu-
vent faire remonter, par exemple, celle
de la typographie au-delà du dixième
siècle de notre ère vulgaire, selon les
PP. Couplet (a) et Duhalde (b) ; au
reste, il n’estpas inutile d’observer que
le premier ne parle pas d’invention ,
mais dit seulement suh hoc ( imperalore
{a) Monarch. Sinic. Tabula chronologi-
ta, à la suite du Confucius si-ve scientiaSi-
nensis, p. 65.
■ (b) Description, &c. de Vempire de la
Chine, t. I , p. 4x4.
,(;c) De Litterària Sinensi, p. 800.
(#) De Christiana expeditione apud Si-
nas:
lie) Ge Jésuite est très-persuadé que l’imprimerie
nous est venue desChinois. « Que-
» da muy claro que esta invencion vino y se
Mim-Çum) typographia ccepit. «On
commença d’imprimer sous l ’empereur
Mim - Çum » , que Duhalde nomme
Mingtsong, vers 9 a5 de Père vulgaire.
Quelques auteurs, tels que Spizel (c),
Trigault (d), Mendoça (<?)., Maffée , prétendent
que les Chinois çonnoissoient
l ’art typographique dès le cinquième
siècle avant J. C. mais nous ne pouvons
douter que cet art ne soit aussi ancien
au Tibet ( f ) qu’à la Chine, et il est
resté, dans toutes ces contrées, grossier
et imparfait, faute de caractères mobiles
et de presses, deux inventions réser-
» communico de ellos a nos otros , y ayu-
» da para creer esto hallarse elle dia de oy
» entre ellos muchos liWos stampados mas
» de 5oo anos antes de el ano en que por
» mestra cuenta tu-vô principio la inveneion
» en Alemania». Historia de las cosas mas
notables, &- por el R. P. Gonçales de
Mendoça , libro I I I , cap. xvi.
(ƒ) Alphabetum Tibetan. pars prima ,
p. 900.