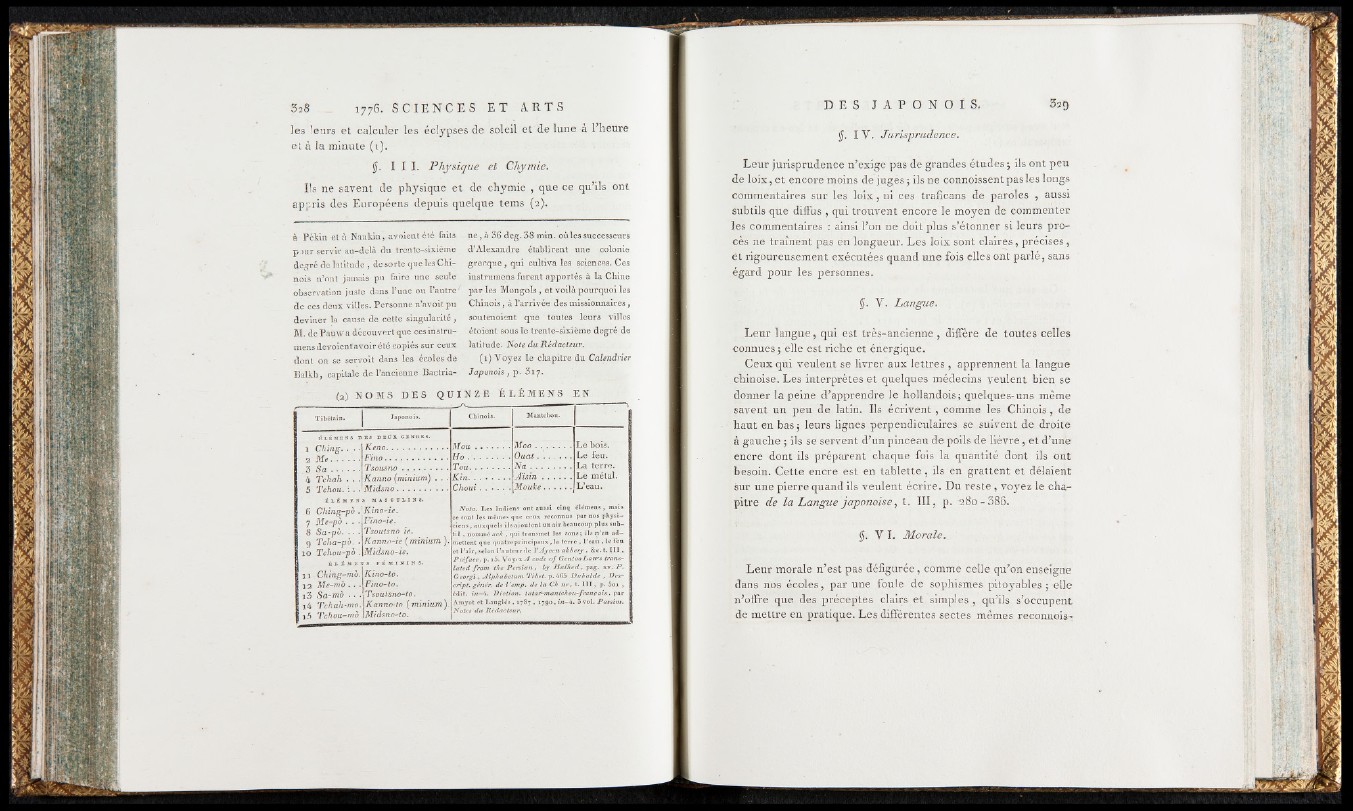
les leurs et calculer les éclypses de soleil et de lune-a l’heure
et à la minute (1).
§. I I I . Physique et Chymie.
Ils ne savent de physique et de chymie , que ce qu’ils ont
appris des Européens depuis quelque tems (2).
à Pékin et à Nankin ; avoient été faits
p iur servir au-delà du trente-sixième
degré de lalitude , de sorte que les Chinois
n’ont jamais pu faire une seule
observation juste dans l’une ou 1 autre'
de ces deux villes. Personne n’avoit pu
deviner la cause de cette singularité ,
M. de Paùwa découvert que ces instru-
mens devoienfavoir été copiés sur ceux
dont on se servoit dans les écoles de
Balkh, capitale de l ’ancienne Bactrian
e , à 36 deg. 38 min, oùles successeurs
d’Alexandre établirent une colonie
grecque, qui cultiva les sciences. Ces
inslrumens furent apportés à la Chine
par les Mongols, et voilà pourquoi les
Chinois, à l ’arrivée des missionnaires ,
soutenoient que toutes leurs villes
étaient sous le trente-sixième degré de
latitude. Note du Rédacteur.
(î) Voyez le chapitre du Calendrier
Japonois } p; 317 .
(2) N O M S D E S Q U I N Z E É L É M E N S EN
T ibétain. Japonois.
É1ÉMENS DBS DEUX GENRES.
l Ching. . . . Keno..........................
KÏitiVJ
4 Tchah . . . K anno (minium) . . .
5 Tchou. : . . Midsno. ....................
É l É M I S MASCULINS.
6 Ching-pb . Kino-ie.
7 Meypà . . . Fino-ie.
8 Sa-pb. . . . Tsoutsno ie.
9 Tcha-pb. . Kanno-ie ( minium ).
10 Tchou-po . Midsno-ie.
A X A M E S FÉMININS.
i l Ching-mo. Kirio-to.
12 Me-mo . . . Fino-lo.
i 3 Sa-mo . . . Tsoulsno-to.
i 4 Tchah-mo. Kanno-to (minium).
i 5 Tchou-mb Midsno-to. ,
Chinois. Man tchou.
H o ............................ Ouat............... Lé feu.
Kin.................. A'isin . . . . . . Le métal.
Choui.......... ... Mouke............ L ’eau.
Nota. Les Indiens ont aussi cinq élémens , m ais
ce sont les mêmes ue ceux reconnus par nos phy sicien
s, auxquels ils ajoutent un air beaucoup plus su b -
til , nommé a c li, ui transm et les son s ; ils n ’en a d -
m ettent que quatre p rin cipa ux ,la terr , l ’eau , le feu
et l ’air, selon l ’a ut sur de VAyeen ah bery , &c. t. II.I.,
Préface, p. i5 . Voyez A code o f Gent ooLarrs transla
ted from the P ersian, by Halhe d , pag. xv. P .
, A lp h ahetum Tibet, p. 465. Duliàlde , Des-
ri.pt. génér. de l ’ ernp. de la Ch ne, t. I I I , p. 5oi ,
édit, in—h. Diction. tatai<-mantchou-français, par
Amyot et Langlés , 1787 , 1790, in - 4. 3 vol. Passim.
Notes'du R édacteur.
§. I V. Jurisprudence.
Leur jurisprudence n’exige pas de grandes études; ils ont peu
de loix, et encore moins déjugés; ils ne connoissent pas les longs
commentaires sur les lo ix , ni ces traficans de paroles , aussi
subtils que diffus , qui trouvent encore le moyen de commenter
les commentaires : ainsi l’on ne doit plus s’étonner si leurs procès
ne traînent pas en longueur. Les loix sont claires, précises,
ét rigoureusement exécutées quand une fois elles ont parlé, sans
égard pour les personnes.
V. Langue.
Leur langue, qui est très-ancienne , diffère de toutes celles
connues,; elle est riche et énergique.
Ceux qui veulent se livrer aux lettres , apprennent la langue
chinoise. Les interprètes et quelques médecins veulent bien se
donner la peine d’apprendre le hollandois; quelques-uns même
savent un peu de latin. Ils écrivent , comme les Chinois , de
haut en bas ; leurs lignes perpendiculaires se suivent de droite
à gauche ; ils se servent d’un pinceau de poils de lièvre, et d’une
encre dont ils préparent chaque fois la quantité dont ils ont
besoin. Cette encre est en tablette , ils en grattent et délaient
sur une pierre quand ils veulent écrire. Du reste, voyez le chapitre
de la Langue japonaise, t. III, p. 280-386.
$. V I . Morale.,
Leur morale n’est pas défigurée, comme celle qu’ on enseigne
dans nos écoles, par une foule de sophismes pitoyables ; elle
n’offre que des préceptes clairs et. simples , qu’ils, s’occupent
de mettre en pratique. Les différentes sectes mêmes reconnois