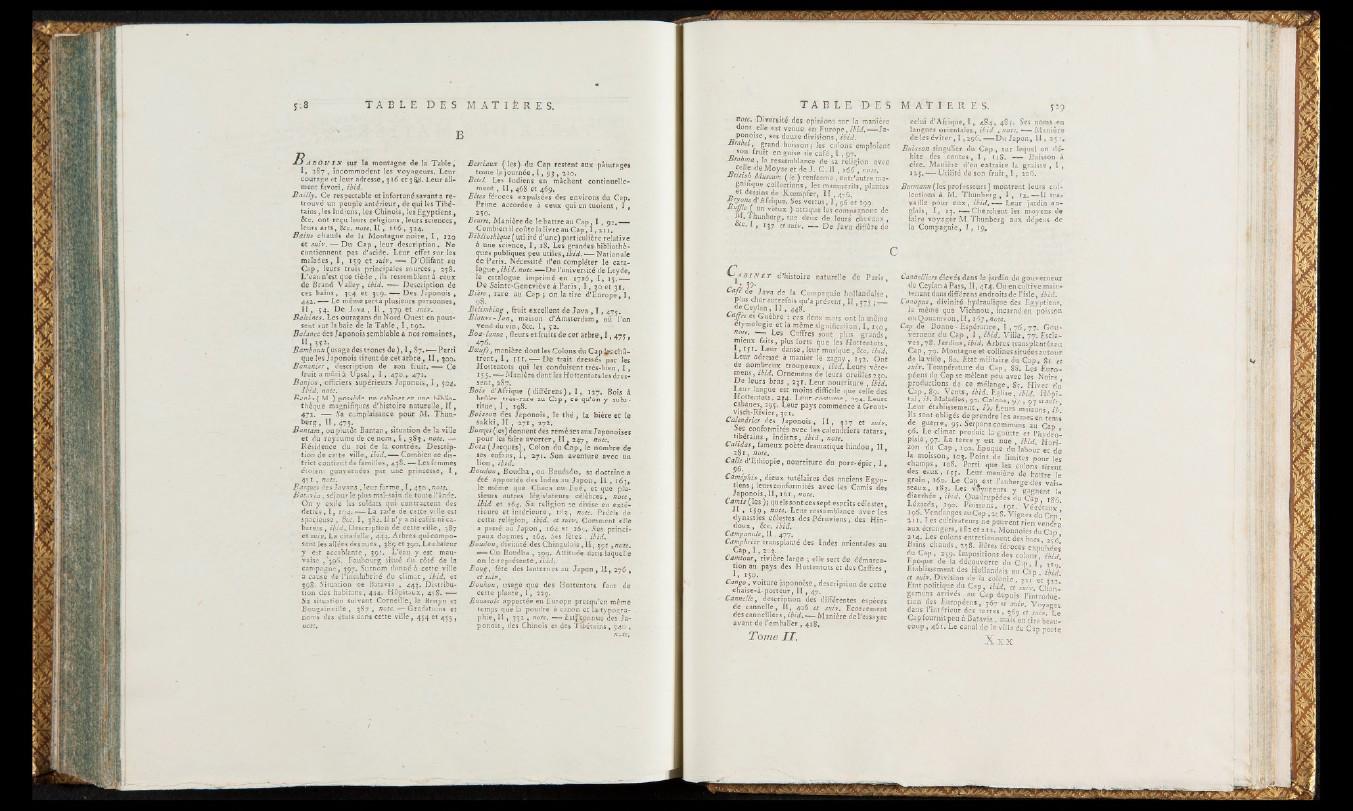
B
Xj a b o u i n sur la montagne de la Table,'
I , 287 , incommodent les voyageurs. Leur
courage et leur adresse, 316 et 3&S. Leur aliment
favori, ib id .
B a i l l y . Ce respectable et infortuné savant a retrouvé
un peuple antérieur, de qui les Tibétains
, les Indiens, les Chinois, les Egyptiens ,
&c. ont reçu leurs religions , leurs sciences,
leurs arts, &c. n o t e . II, 166, 324.
B a in s chauds de la Montagne noire, I, 120
et s u iv . - r - Du Cap , leur description. Ne
contiennent pas d’acide. Leur effet sur les
malades, I, 159 et su iv . —— D’Olifant au
Cap, leurs trois principales sources, 258.
L’eau n’est que tiède , ils ressemblent à ceux
de Brand Valley, i b id . <— • Description de
ces bains, 304 et 3.09. — Des Jrponois ,
442. — ■ Le même sert à plusieurs personnes,
II, 54. De Java , II, 379 et s u iv .
B a le in e s . Les ouragans du Nord-Ouest en poussent
sur la baie de la Table, 1 ,192.
B a la n c e des Japonois semblable à nos romaines,
11, 332.
B am b o u x ( usage des troncs de ), I , S7. — Parti
que les Japonois tirent de cet arbre , II, 300.
B a n a n i e r , description de son fruit. — Ce
fruit a mûri à Upsal, I , 470., 471.
B a n j o s , officiers supérieurs Japonois, I, 304,
I b i d . n o te .
B a n k s ( M . ) possède un cabinet et une bibliothèque
magnifiques d’histoire naturelle, II,
472. —— Sa complaisance pour M. Thun-
_berg, If > 473* .... , , . B a n t a m , o u plutôt Bantan ,. situation de la ville
et du royaume d'e ce nom, 1 , 383 . nette. —
Résidence du ro,i de la contrée. Description
de cette ville, ib id .— Combien ce district
contient de familles, 43S. — Les femmes
étoient gouvernées par une princesse, I ,
4S1 , noté .
B a rq u e s des Javans , leuj forme, 1, 430 ,n o tç .
B a t a v i a , séjour le plus mal-sain de toute l’Inde.
On y exile les soldats qui contractent des
. dettes , I, 104.----La rade de cette ville est
spacieuse , &c. I, 384. il n’y a ni cafés ni ca>-.
barets , i b i d ..Description de cette ville,. 387
et su iv . La citadelle, 444. Arbres qui compo-
sent les allées des rues , 3S9 et 390; La chaleur
y est accablante , 39t. L'eau y est mauvaise
,*396. Faubourg situé du côté de la
campagne, 397. Surnom donné à-cette ville
- à cause de l'insalubrité du climat, i b i d . et
398. Situation ce Batavia , 443. Distribution
des habitans , 444. Hôpitaux, 458. •
Sa situation suivant Corneille, le Bruyjn et
Bougainville , 387 , n o te . — Gradations et
noms des états dans cette ville, 454 et 455 ,
note .
B e s t ia u x (les) du Cap restent aux pâturages
toute la journée, 1 ,93,210.
B e t e l. Les Indiens en mâchent continuellement
, II, 468 et 469.
B ê t e s féroces expulsées des environs du Cap,
Prime accordée à ceux qui en tuoient, I ,
236.
Beurre. Manière de le battre au Cao, I , 92.-—
Combien il coûté la livre aü Cap*, 1 ,211.
B ib lio th è q u e ( utilité d’une) particulière relative
à une science, I, 18. Les grandes bibliothèques
publiques peu utiles, ib id . — Nationale
de Paris. Nécessité d’en compléter le catalogue
, ib id . «oie.— De l’université de Leyde,
le catalogue imprimé en 171-6, I, 15.— .
De Sainte-Geneviève à Paris, 1 ,30 et 31.
B iè r e , rare au Cap ; on la tire d’Europe, I ,
?B.
B i l im b in g , fruit excellent de Java , 1 ,475. .
B l a u v e - J a n , maison d’Amsterdam, où l’on
vend du vin, &c. I., 32.
B o a - l a n s a , fleurs et fruits de cet arbre, 1,473,
; 476.
B oe u f s , manière dont les Colons du Cap Jps châ- '
trent, 1 , n i .— - De trait dressés par les
Hottentots qui les conduisent très-bien, I ,
155. —- Manière dont les Hottentots les dressent,
287.
B o is^ d’Afrique (différens), I, 127. Bois à
brûler très-rare au Cap, ce qu’on y substitue
, I , 198.
B o i s s o n des Japonois, le thé, la bière et le
sakki, H , 271, 272.
B o n n e s (les) donnent des remèdes aux Japonoises
pour les faire avorter, II, 247, note .
B o t a (.Jacques) , Colon du Cap, le nombre de
ses enfons, 1 , 271. Son aventure avec un
. lion, ib id .,
B o u d o u , Boudha , ou Beudsdo, sa doctrine a
été apportée des Indes au Japon, II , i6j,
le même que Chaca ou Eoé, et que plusieurs
autres Iégis’ateurs célèbres, n o t e ,
i b i d et 164. Sa religion se divise en extérieure
et intérieure , 163!, note.. Précis de
cette: religion,, ib id . e t s u iv . Comment elle
■ a passé au Japon, 164 et 165 . Ses- principaux
dogmes , 164. Ses fêtes ib id .
B o u d o u , divinité desChingulais ,II, 393 ,n c t e .
— Ou Boudha , 399; Attitude dans laquelle
on le.représente, ib id .,
B o u g , fête des lanternes au-Japon, II, 276,
e t sjsiv^:
B o u b o u , usagé que des Hottentots font de
cette plante , 1, 229.
B o u s s o le apportée en Europe presqu’en même
temps que la poudre à canon et la-typographie,
II, 332 , n o te . •—• £stf]cpnnue des Japonois,
des Chinois et des Tibétains , 340 ,
note .
n o t e . Diversité des opinions sur la manière
dont elle est venue en Europe, ibid.>— Japonaise
, ses douze divisions , ib id .
B r a b e i , grand buisson; les colons emploient
son fruit en guise de café , I , 97.
B r a hm a , la ressemblance de sa religion avec
celle de Moyse et de J. C. II, 166 , note .
B r u t s h Mu s éum ( le ) renferme, entr’autre magnifique
collections, les manuscrits, plantes
et dessins de Kcempfer, Il ,476.
'd’Afrique. Ses vertus, I, 96 et 199.
iwt’^iUn,vieux ) attacfue les compagnons de
I bunberg, tue deux de. leurs chevaux ,
^ » 1 ?7 et s n iv . —— De Java diffère de
celui d’Afrique, 1 , 484, 483. Ses noms en
langues orientales, i b i d , n o te . ----Manière
, de les éviter, 1 ,296. — Du Japon, II, 25
B u i s s o n singulier du'Cap, sur lequel on débite
des contes, I , 118. — Buisson à
cire. Manière d’en extraire la graisse , I ,
125.— -Utilité de son fruit , 1 , 206.
Bu rm an n (les professeurs ) montrent leurs collections
à M. Thunberg , I , 12. —II travaille
pour eux, i b id .— Leur jardin anglais,
I, 13. —- Cherchent les moyens de
: faire voyager M. Thunberg aux dépens de
la Compagnie, 1 , 19. 1
c
a b i n e t d’histoire naturelle de Paris,
r * i ü de Java de la Compagnie hollandaise,
plus cher autrefois qu’à présent II . 37 c •
deCeylan, II, 44$. ’ , i n ’
Caffi-e et Guèbre : ces deux mots ont la même
étymologie et la même signification, 1 ,150,
• n o *e' “— Les Caffres sont plus grands,
mieux faits, plus forts que les Hottentots,
1 ,151. Leur danse ; leur musique, &c. ib id .
Leur adresse à manier le zagay, 152. Ont
de nombreux troupeaux, ib id . Leurs vête-
mens, ib id . Ornemens de leurs oreilles 230.
De leurs bras , 231. Leur nourriture , i b id .
Leur langue est moins difficile que celle des
Hottentots, 234. Leur costume, 294. Leurs
cabanes, 293. Leiir pays commence à Groot-
visch-Rivier, 301.
C a len d r ier des ^ Japonois, II, 317 et s u iv .
Ses conformités avec les calendriers tatars,*
tibétains , indiens, i b i d , n o te .
C a l id a s , fameux poète dramatique hindou II
281, n o te .
C a lle d'Ethiopie, nourriture du porc- épie, I , 96.
C a m é p h is , dieux tutélaires des anciens Egyptiens
; leurs conformités avec les Camis des
Japonois, II, 161, n o te .
C am is (les ); quels sont ces sept esprits célestes,
H , 159 , «oie./Leur ressemblance avec les
dynasties célestes des péruviens, des Hin-
doùx, &c. ib id .-
C am p a n u le , II, 477.
C am p h r ie r transplanté des Indes orientales au
' Cap, I, 203. .
C am to u r , rivière large ; elle sert de démarcation
au pays des Hottentots et des Caffres 1, Mo.’- '
Ca n g o , voiture japonoise, description de cette
chaise-à-porteur, II, 47.
C a n n e lle , description des différentes espèces
de cannelle, II, 406 et s u iv . Ecorce ment
des canneiliers, ib id . — Manière de t’essayer
avant de l’emballer , 418.
Tome I I .
C a n n eilier s élevés dans le jardin du gouverneur
’ de Ceylan à Pass, II, 414. On en cultive maintenant
dans différens endroits de I’isle, ib id .
Ç a n o p u s , divinité hydraulique des Egyptiens,
la même que Vichnou, incarné, en poisson
ouQouamvon,Il, 167, n o te .
C a p de Bonne • Espérance , 1 ,76,77. Gouverneur
du Cap , 1 , ib i d . Ville, 77. Esclaves,
78. Jardins, ib id . Arbres transplantésau
Cap, 79. Montagne et collines situées autour
de la ville , 80. Etat militaire du Cap, 8 1 e t
s u iv . Température du Cap, 88. Les Européens
du Cap se mêlent peu avec les Noirs ■
productions de ce mélange, 83. Hiver du
Cap, 89. Vents, ib i d . Eglise, ib id . Hôpital,
ib . Maladies, 90; Colons, 97 , 03 et s u iv
Leur établissement, i ' j .-Leurs maisons, iA!
lis sont obligés de prendre les armes eh tems
de guerre, 95. Serpsns communs au Cap
9?\ Le climat produit la goutte et l’hydrov
PIsie > 97- La terre y est nue -, i b id . Horizon
du Cap , 102. Epoque du labour et de
la moisson, 103. Point de limites pour les
champs, 108. Parti que les colons tirent
des eaux, 1-53. Leur manière de battre le
grain, 160. Le Cap est l’auberge des vaisseaux,;
183..Les; voyageurs y gagnent la
diarrhée , t b id . Quadrupèdes du Cap, 186
Lézards, t90. Poissons, 191. Végétaux*
196. Vendanges au Cap , 2cS. Vignes du Cap ’
211. Les cultivateurs ne peuvent rien vendre*
aux étrangers, 18 2 e t 2 1 2 . Monnoies du Cap
214. Les colons entretiennent des bacs 2 k6
Bains chauds i;S. Bêtes féroces expulsées
du Cap , 239. Impositions des colons, i b i d
Epoque de la découverte du Cap, I *Tg’
Etablissement des Hollandais au Cap [ i b id ’
e t s u iv . Division de la colonie, 3.21 et 322*
Etat politique du Cap, ib id . e t s u iv . Chan-
gemeps arrives au Gap depuis' l’introduction
des Européens, 367 et s u iv . Voyais
dans_Pintéricur des terres , 369 et s id v . L e
Cap fournit peu à Batavia, mais enjire
çoup, 461; Le canal de la ville du
X x x
beau-
p porte